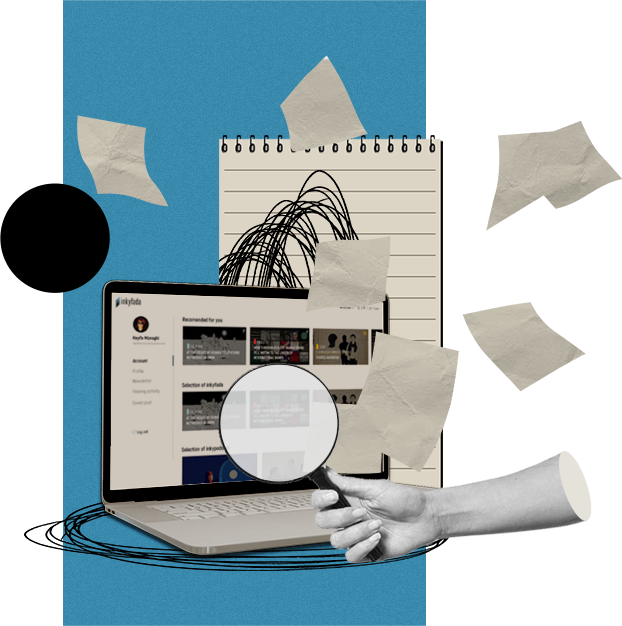“Dehors, je peux discuter, mais au stade, il y a des règles de hiérarchie entre nous”, explique Ahmed. À trente ans et sans emploi, la vie de l’ultra est guidée par sa passion sportive : “mon père était lui-même un joueur, et dès l’âge de quatre ans, il m’a inscrit dans un club”, retrace-t-il, “mais à seize ans, j’ai quitté les terrains pour les gradins.”
Dans les années 2000, avec quelques supporters, Ahmed cofonde un groupe local d’ultra pour soutenir son équipe. S’il ne compte que quelques membres au démarrage, “aujourd’hui, c’est devenu une affaire de famille, avec des générations entières impliquées, du grand-père au petit-fils”, assure-t-il. Après des années à organiser le fonctionnement et la vie de son groupe, le trentenaire continue de s’impliquer entièrement.
“Être ultra, c’est une vie à part entière, à chaque match, c’est toujours comme la première fois.”
La cohésion des ultras contre l’hostilité policière
En Tunisie, la passion footballistique des ultras transcende les catégories socio-économiques : “il y a autant des médecins, des ingénieurs, des éboueurs ou des étudiants”, liste Inès Ben Othman, réalisatrice de plusieurs documentaires sur le phénomène ultra. “Même si c’est impossible de nous catégoriser, on est tous réunis par l’amour du foot”, confirme Ahmed. Du dévouement au club à la hiérarchie des membres, en passant par une solidarité totale, les règles strictes de ces groupes exclusivement masculins sont similaires du Maghreb à l’Europe, où le phénomène est né en Italie dans les années 1960*.
Mais à l’heure des réseaux sociaux, la règle de réserve à laquelle tiennent les groupes est plus facilement négligée : “pour les plus jeunes, ce n’est plus pareil, ils ont du mal à ne pas prendre d’images, il faut sans cesse les surveiller”, souligne l’ultra, “alors que nous, on supporte notre équipe à l’ancienne (...). Même mes propres parents ne savent pas que je suis un ultra”, dévoile Ahmed.
Si pour ces supporters complices au-delà des gradins, l’anonymat est une règle sine qua non, Ahmed accepte de partager certaines facettes de cette vie. “En tant qu’ultra, j’ai des choses à dire et je connais nos problématiques”, explique-t-il. Face au traitement médiatique et politique du phénomène, souvent cantonné à un angle sécuritaire, il veut mettre en lumière les valeurs de solidarité et d'entraide qu’il juge constitutives de ces mouvements. “Par exemple, s’il faut de l’argent pour le club ou les membres, on vend tout : nos chaussures, nos télévisions, nos voitures”, affirme Ahmed.
“Pour l’Aïd ou d’autres fêtes, on fait aussi des dons anonymes ou des collectes et c’est important de le dire, être ultra est toute une culture de valeurs.”
Mais il est vrai qu’en Tunisie comme ailleurs, ces supporters du ballon rond sont notamment connus pour leurs rapports conflictuels avec les forces de l’ordre. “Se souder autour d’un rejet de la police est à la fois une manière de faire groupe pour rejeter les dominations par les forces policières, une façon de canaliser une frustration collective et un moyen d’affirmer une identité sociale”, explique une chercheuse en sciences politiques ayant requis l'anonymat.
Une logique assumée par les supporters : “être ultra, c’est accepter la violence face aux policiers”, explique Ahmed, “l’idée de la solidarité concerne aussi la violence, si l’un des nôtres est agressé par la police, peu importe la situation, on doit tous intervenir.” Anis*, jeune supporter d’un club de foot de la capitale tunisienne, témoigne lui aussi de l’ambivalence des rapports entre ultras et forces de sécurité.
“Ma relation avec la police commence dès que je vais au stade. Les premières personnes que je vois après mes amis du quartier avec qui je vais, ce sont les policiers.”
Anis explique que cette relation est “un conflit permanent et que tant que l’État policier existera”, elle continuera d’être vécue ainsi. Le jeune homme dénonce des provocations policières “constantes, chaque semaine et à chaque match (...). On ne quitte jamais le stade dans le même état que lorsqu’on y est entré.”

Le siège du Club Africain, marqué par des tags de supporters. Juillet 2024.
Omar Laâbidi ou le symbole de l’impunité policière
C’est sans nul doute le 31 mars 2018 que ces tensions entre ultras et police ont atteint leur paroxysme. À l’issue d’un match entre le Club Africain et le Club Olympique de Médenine à Radès, des violences éclatent entre ultras et forces de l’ordre. Omar Laâbidi, 19 ans, est poursuivi par une douzaine de policiers jusqu’à l’Oued Melian. Selon des témoins présents sur les lieux, encerclé par plusieurs agents à proximité du cours d’eau, l’adolescent prévient les forces de l’ordre qu’il ne sait pas nager, avant de tomber. Son frère affirme avoir entendu un policier lui lancer : “Vas-y, apprends à nager, saute !”. Le lendemain, son corps sans vie est retrouvé. À la suite du drame, le visage du jeune homme devient le symbole de l’impunité policière et suscite une vague de contestations à travers le pays, amplifiée par le hashtag #تعلم_عوم (#apprend_à_nager).
Sur le même sujet
En juillet 2024, six ans après les faits, 12 policiers ont été condamnés par la Cour d’appel de Tunis à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le dossier a cependant été renvoyé en cassation. Le traitement judiciaire des concernés est jugé par l’ensemble des supporters tunisiens en deçà du drame. “Entre groupes, nous sommes adversaires, c’est certain, mais là, c’est une question d’humanité. La mort d'Omar a ébranlé le pays du sud au nord”, explique amèrement Ahmed. “Même si la condamnation ne satisfait pas les ultras, elle marque néanmoins un tournant”, analyse la chercheuse en sciences politiques, “ce procès révèle une crainte du pouvoir politique face aux affaires qui deviennent des enjeux de société”.
Sur le même sujet
Malgré une condamnation rare dans les affaires de violences liées à une rencontre sportive, “suite à ce meurtre, il n’y a eu aucune remise en question de l’usage de la force par la police”, témoigne Mohammed Jouili, sociologue à l’Université de Tunis. “Lors des matchs, ce sont les mêmes moyens, les mêmes mécanismes et les mêmes réflexes qui sont utilisés”. L’État tunisien a pourtant un rôle prépondérant dans la gestion sécuritaire des rencontres sportives, via le déploiement de forces de police à l’intérieur des stades : “le fait que ce ne soit pas relayé à des entreprises de sécurité privée, comme c’est généralement le cas à l’étranger, montre la centralité du rôle du ministère de l'Intérieur”, détaille la chercheuse en sciences politiques.
"Quant à la violence, en réalité, il y a des périodes plus ou moins difficiles (...), mais après la révolution comme après la mort d’Omar, il n'y a jamais eu de réel tournant dans la gestion des ultras en Tunisie.”
Selon Oumaya Jabnouni, ancienne membre de la direction de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) ayant piloté un projet sur la jeunesse et les violences extrémistes, la première cause des violences policières dans les stades réside dans l’absence de sanctions hiérarchiques. “L’impunité de la police est un problème structurel en Tunisie, enraciné de la police à l’administration, et un jeune Tunisien a dû en payer le prix fort”, dénonce-t-elle, “il n’y a pas d’équilibre de pouvoir entre la police et les supporters, car elle sait qu’elle peut agir en toute impunité”.
En avril 2019, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International alertait sur “la perméabilité entre la police et les services chargés des enquêtes, ainsi que l’absence de transparence dans le processus décisionnel”, dans un rapport sur la mort de quatre jeunes, dont Omar Laâbidi, intitulé “Quand fuir la police peut être mortel”.
“De manière générale, il y a très peu de dossiers d'inspection sur l’usage excessif de la force, que ce soit dans les stades ou ailleurs”, appuie la chercheuse en sciences politiques. Si en toute vraisemblance les affaires de violences policières sont nombreuses, les cas d’impunité sont difficilement quantifiables en raison de “la quasi-impossibilité d'obtenir des données du ministère”, note le centre de recherche Arab Reform Initiative, “les demandes d'accès à l'information [étant] systématiquement rejetées”.
Sur le même sujet
Tensions et violences persistantes
Au-delà des violences flagrantes, l’hostilité entre police et ultras se manifeste également par des pressions du quotidien. Dans un post Facebook publié en mai 2022, les supporters de la “Curva Nord” du Club Africain dénoncent le harcèlement policier dont ils se disent victimes. “Régulièrement, on observe des détentions préventives ou des intimidations des ultras sur les familles”, note la chercheuse en sciences politiques. Ahmed affirme quant à lui faire l'objet d’une surveillance particulière des forces de l’ordre, notamment en amont d’un match : “quand on va au stade, la police technique prend des photos, nos noms et prénoms, ils savent tout”, assure l’ultra.
Anis confirme les dires du leader : toute action en dehors de ce qui est attendu par les forces de l’ordre expose les supporters à la violence. Selon lui, celles-ci exigent un comportement de “supporter ordinaire” : assister au match, porter le maillot de son équipe, chanter uniquement les chants approuvés et utiliser les mots acceptés. Tout écart par rapport à ce cadre, explique-t-il, est réprimé par la violence et des arrestations.
"Ils ont toutes nos informations, comme si nous étions des criminels : photos, empreintes, adresses, déplacements… Ils savent tout de nous."
Dans le cadre de son enquête de terrain sur les violences extrémistes en 2016, la LTDH s’est rendue à plusieurs reprises à des rencontres sportives dans la capitale. Objectif : analyser le comportement des parties et dénombrer les possibles violences policières lors des matchs. “Même si, en raison de notre présence affichée, nous n’avons pas recensé de violences graves, nous avons pu observer des rapports conflictuels latents, avec des provocations verbales, des conditions d'attente longues et difficiles ou des humiliations répétées de la part des forces de l’ordre”, liste Oumaya Jabnouni. “Avant de faire de la répression, il faudrait commencer par lutter contre cette violence à l’accueil des stades ou le marché noir des tickets”, avise Mohammed Jouili.
Une politique coercitive pour contenir le phénomène
Quotas de places, stades interdits aux mineurs, matchs à huis clos… depuis la révolution, les autorités tunisiennes décrètent régulièrement des mesures pour endiguer le phénomène ultra. Des dispositifs perçus comme liberticides par les supporters : “certains travaillent toute la semaine, du lundi au samedi, d’autres vont en discothèque se défouler, pourquoi nous, on n’a pas le droit d’aller au stade ?”, s’indigne Ahmed. Alors quand son groupe ne peut pas être dans les gradins, ils tentent tout de même de montrer leur indignation.
“On va aux abords des stades pour faire travailler la police, car c’est notre liberté”, s’amuse-t-il.
Sans éléments de preuves ou de résultats tangibles, la réussite des dispositifs visant à contenir le phénomène ultra est difficilement démontrable. “On ne peut pas endiguer le phénomène par des interdictions”, observe Mohammed Jouili, “mais du moment où l'État ne tente pas de comprendre les valeurs ultra, leur seul recours est le réflexe sécuritaire”. Plus que cela, la répression peut paradoxalement renforcer la mobilisation : “ces moments de répressions intenses préparent à un accroissement de la violence, y compris en dehors des stades”, explique la chercheuse en sciences politiques, “car la répression policière vient nourrir les contestations contre les violences”.
Une analyse qu’illustre directement l’expérience d’Ahmed. Entre 2007 et 2009, alors qu’il raconte avoir été incarcéré à six reprises pour avoir allumé des fumigènes lors de matchs, ses passages en prison deviennent une motivation supplémentaire. “C’était une aventure, on n’avait tué personne et être enfermé ensemble nous rassemblait”, raconte-t-il, “on savait que dehors, le reste du groupe se battait pour nous, et quand on sortait, on était encore plus remonté pour défendre les autres”.
Les jeunes, le stade et les défaillances de l’État
Selon Mohammed Jouili, au-delà de galvaniser les groupes ultras, la gestion répressive de ces mouvements illustre une défaillance de l’État dans la prise en considération des jeunes adultes. “La naissance des groupes locaux dans les années 2000 coïncide avec un déclin des institutions d’accompagnement des jeunes”, explique le sociologue, “les jeunes [trouvant] dans le supportérisme une manière de s’afficher et de se positionner dans l’échiquier social, le foot [devenant] chez eux une cause nouvelle et collective”.
En 2024, la jeune génération fait face de plein fouet à la crise socio-économique. Avec un taux de chômage de 40 %, des inégalités sociales marquées et un manque de perspectives d’avenirs, selon une récente étude du réseau de recherche Arab Barometer parue en août 2024, 71 % des 18/29 ans souhaitent dorénavant émigrer. “Ces dernières années, la jeunesse ne figure toujours pas parmi les objectifs du gouvernement, il n’y a ni vision, ni changement, ni intérêt manifesté pour les jeunes [...] Ils sont donc portés à trouver leurs propres solutions et leurs saluts sont désormais individuels.”, détaille le rapport.
Cette absence d’inclusion contribue les jeunes à chercher des formes d’affirmation ailleurs, notamment à travers le supportérisme. “Le constat est simple : les jeunes ne sont jamais invités ou sollicités pour échanger et s’exprimer”, regrette Oumaya Jabnouni.
“Les groupes ultras ne sont pas pris en considération, ni ne sont pas reconnus alors que le mouvement existe, il est bien là et il est bouillant”.
Dans ce contexte, le stade devient donc un espace privilégié d'expression et de contestation. “Si j’écris un statut Facebook, 300 personnes environ vont le voir, si tu vas manifester à l’avenue Bourguiba avec une banderole, il y aura 20 personnes et une caméra, alors qu’au stade, il peut y avoir 30 000 personnes, il y a des politiques, des médias, des visiteurs…”, explique Ahmed. Le leader ultra voit dans ce lieu une tribune parfaite pour y dénoncer tant “les problèmes de transports, de chômage, que de pauvreté… c’est là qu’on peut s’exprimer” . Les tifos, les chants et les processus de réalisation de cette expression démontrent l'importance du stade pour les ultras tunisiens. “Les stades ne sont que le reflet de la société”, résume Inès Ben Othman.
Symbole de leur rôle dans la société tunisienne, les ultras représentent “une partie de la mémoire nationale”, analyse Oumaya Jabnouni. En cause, en avril 2010, à l’aube de la révolution, “ils sont les premiers à avoir cassé la barrière de la peur de la police”, retrace Mohammed Jouili. À l’époque, un supporter est brutalement malmené au stade olympique d’El-Menzah, provoquant une réaction violente qui a pris une dimension politique.
Quatorze ans après la révolution, ni la rancœur des ultras vis-à-vis de l’appareil policier ni les problématiques de société qu’ils dénoncent ne semblent s’apaiser. Surtout, à l’image d’Ahmed, leur passion totale pour le supportérisme est loin de s'éteindre, “parce que c’est comme une drogue, à chaque match, c’est toujours la première fois”, raconte celui qui a vu des générations de joueurs défiler dans son club.