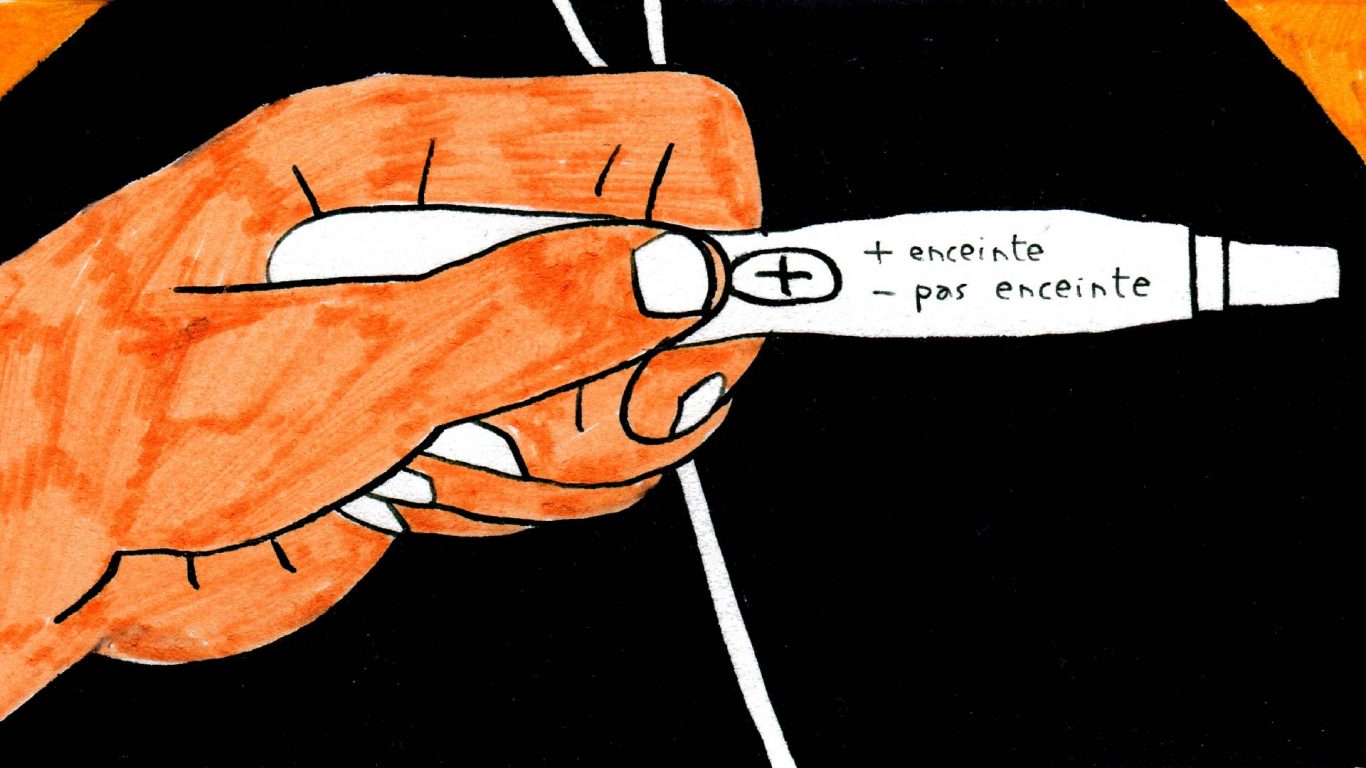Un média indépendant à la pointe de l’innovation éditoriale
Créez votre compte aujourd’hui et profitez d’accès exclusifs et des fonctionnalités avancées. Devenez membre et contribuez à renforcer notre indépendance.
Devenir membreAucun établissement n’est en mesure de lui fournir les médicaments nécessaires pour réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG), faute de stocks suffisants. Zeineb réussit finalement à avorter grâce à une connaissance, qui lui fournit le traitement en cachette. “S’il n’y avait pas eu cette sororité, je n'aurais pas pu le faire”, raconte-t-elle.
“Que la loi le permette ou pas, c’est mon droit. Je suis prête à l’arracher s’il le faut”.
Figure d’exception dans la région, la Tunisie a légalisé la pratique de l’IVG dès 1973. Toute femme est censée pouvoir avorter gratuitement au cours du premier trimestre de grossesse soit par aspiration (IVG chirurgicale) soit par IVG médicamenteuse*.
Près de cinquante ans après l’entrée en vigueur de cette loi, les femmes font toujours face à de nombreux obstacles. Pénuries de médicaments, dissuasion par le corps médical, inégalités régionales… L’avortement est un parcours de combattantes pour de nombreuses femmes. Sa légalité est même parfois remise en cause dans le débat public. En 2013, la députée Najiba Berioul de l’Assemblée Nationale Constituante, proposait de criminaliser l’IVG au sein de la future Constitution.
“L’accès à l’avortement se restreint, de plus en plus, sans qu’il n’y ait jamais d’interdits”, résume Selma Hajri, fondatrice de l’association Tawhida Ben Cheikh, qui œuvre pour la promotion des droits sexuels et reproductifs. Alors qu’aux Etats-Unis et ailleurs, le droit à l’avortement est aujourd’hui remis en cause par la Cour suprême, qu’en est-il de la Tunisie ? Ce droit est-il réellement garanti ?
Un droit à géographie variable
Théoriquement, l’IVG devrait être accessible gratuitement à toutes les femmes dans tous les établissements sanitaires publics. En 2010, 72 établissements - une cinquantaine d’hôpitaux ainsi que les 24 plannings familiaux présents dans chaque gouvernorat - réalisaient des IVG chirurgicales selon un rapport de l’UNFPA (Le Fonds des Nations unies pour la population) . Aujourd’hui, seulement “deux [hôpitaux]: l’un à Tunis et l’autre à Sousse, offrent l’IVG chirurgicale”, affirme Fatma Temimi, sous-directrice de l’Office national de la Famille et la Population (ONFP). Quelques plannings familiaux le pratiqueraient également, sans qu’il n’ait été possible d’obtenir des statistiques claires.
Ainsi, lorsque l’IVG médicamenteuse n’est pas possible en raison d’une pénurie de médicaments ou que les délais sont dépassés, les femmes n’ont que très peu de moyens de se faire avorter dans le public.
“Quand il y a une rupture de stock [des médicaments pour l’IVG] les femmes ne peuvent plus avoir accès à l’avortement”, résume Selma Hajri, directrice de l’association Tawhida.
Zeineb l’a directement vécu. Lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte, la jeune femme n’avait plus que deux semaines pour recourir à une IVG médicamenteuse. “Je suis allée voir le chef de service [d’un hôpital]”, se souvient-elle, mais celui-ci lui demande d’attendre en raison de l’absence de comprimés. Sauf que Zeineb est dans une situation d’urgence : pour des raisons médicales, elle ne peut pas avoir recours à une IVG chirurgicale. “Je ne pouvais pas attendre” réagit-elle.
Au-delà des pénuries de médicaments, les établissements publics souffrent aussi d’une insuffisance de personnel.
“Si quelqu’un part à la retraite ou déménage, il n’est jamais remplacé”, témoigne une sage-femme exerçant dans la région de Gafsa.
Ces manquements sont encore plus criants dans les régions défavorisées. À Tunis, il existe huit médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique pour 10.000 femmes contre moins d’un·e médecin pour 10.000 femmes à Tataouine ou Siliana.
Densité de gynécologues pour 10 000 femmes en âge de procréer
De plus, dans les régions rurales, le manque d’anonymat pousse les femmes à parcourir de grandes distances pour pouvoir avorter selon un autre rapport de l'UNFPA. “Le personnel habite souvent sur place, c’est un problème, c’est mauvais pour l’intimité des patientes”, estime une sage-femme exerçant dans un Centre de santé de base (CSB) du Nord-Est.
Le privé, une solution par défaut
Face aux nombreux manquements rencontrés dans le service public, certaines femmes se tournent plutôt vers le secteur privé, comme en témoigne les chiffres : trois fois plus d’avortement seraient pratiqués dans les cliniques privées selon des estimations de 2011.
Sur le même sujet
Pour un avortement par aspiration dans une clinique privée, les patientes doivent débourser en moyenne entre 300 et 500 dinars d’après plusieurs médecins. Cette pratique chirurgicale est généralement privilégiée par rapport à l’IVG médicamenteuse.
Les praticien·nes interrogé·es expliquent avoir recours à cette méthode en raison des pénuries de médicaments. “Parfois j’envoie des patientes pour prendre des médicaments dans les cliniques et il n’y en a plus”, témoigne la gynécologue Cyrine Ben Miled.
Le constat est le même pour le Dr. Skander Ben Alaya. “Depuis deux années nous avons une pénurie de médicaments pour l’avortement, donc je ne fais plus que des IVG chirurgicaux”. Le gynécologue impute cette situation notamment à l’épidémie de Covid-19 et précise que cela concerne les IVG “à l’échelle mondiale”.
De son côté, Selma Hajri estime que les raisons derrière cette pratique sont avant tout financières. “L’IVG médicamenteuse ne fait pas gagner d’argent, ni aux médecins, ni aux cliniques”, commente-t-elle. La gynécologue Cyrine Ben Miled concède que l'IVG chirurgicale est plus "lucrative pour les médecins”, tout en précisant que cette procédure est aussi “plus confortable car il y a peu ou pas d’échecs”.
Malgré l'existence de quelques statistiques, ces activités dans le privé restent très opaques. Il est difficile d'accéder à des données précises dans le secteur.
“Je n’ai jamais eu à rendre de comptes à personne. Les suites, les échecs etc.. Ce n’est pas du tout comptabilisé, il n’y a pas de registre”, explique ainsi Cyrine Ben Miled.
Ce manque de contrôle du secteur privé a des conséquences néfastes. “Il y a probablement des abus”, dénonce la gynécologue Cyrine Ben Miled. Ces interruptions sont parfois réalisées jusqu’au cinquième ou sixième mois de grossesse. Cette pratique est illégale sauf si la grossesse menace la santé physique ou mentale de la femme ou si le foetus présente de vrais risques d’une maladie grave ou d’un handicap. On parle alors d’un avortement thérapeutique ou interruption médicalisée de grossesse (IMG).
De plus, le coût de l’opération n’est pas toujours respecté, notamment lorsqu'il s'agit de patientes étrangères - telles que des Marocaines, Libyennes, Algériennes ou encore de la région du Golfe - qui ne peuvent pratiquer d’avortement dans leur pays d’origine. Une recherche rapide sur internet permet en effet de facilement trouver des agences proposant des offres “all-inclusive” moyennant au moins 600 euros et plus de 1000 euros pour certaines.
Sur le même sujet
“Revenez dans une semaine ou deux"
Dans une étude réalisée par Selma Hajri, il est apparu qu’un quart des femmes interrogées se sont vues refuser un avortement. Plusieurs professionnel·les de santé interrogé·es par Inkyfada admettent décourager leurs patientes d’avoir recours aux IVG. Ahmed*, gynécologue depuis une vingtaine d’années dans le secteur public, insiste sur l’importance d’avoir une longue discussion avec la femme pour comprendre sa situation. “Je ne dis pas oui à toutes les femmes. Parfois, je ne le conseille pas”, renchérit-il.
Sur le même sujet
Asma, une sage-femme, considère de son côté que l’IVG est une procédure invasive, nocive pour la santé de la femme, à utiliser en dernier recours. “Nous essayons toujours de convaincre [les femmes] d’éviter d’en arriver à l’IVG. Nous l'envoyons [au centre de planning] si elles insistent”, explique-t-elle. Mais pour Selma Hajri, cette diabolisation de l’avortement n’a pas lieu d’être. Dans certains cas, “c'est beaucoup plus risqué de mener une grossesse jusqu'au bout que de faire un avortement”, commente Selma Hajri.
Comme dans le cas d’Asma, des raisons médicales non-valables sont en général invoquées pour dissuader les femmes souhaitant réaliser une IVG. Selma Hajri raconte qu’une femme diabétique s’est vue refusée un avortement en raison de son taux de glycémie élevé. D’autres témoignages mentionnent une bureaucratie pesante ou encore la demande d'examens non-exigés par la loi, comme des tests d’anémie qui peuvent retarder l’opération.
Le respect des délais dépend également du praticien·ne. Un certain flou entoure en effet l’article 214. L’avortement est autorisé pendant “les trois premiers mois de grossesse”, d’après le Code pénal. À l’échelle internationale, les délais d’avortement sont généralement comptabilisés en nombre de semaines d’aménorrhée, c’est-à-dire en nombre de semaines sans règles.
Cette absence de limite précise laisse libre cours à l'interprétation des médecins. “Certains refusent de faire des IVG après 9 semaines d’aménorrhée, d’autres 10 et beaucoup de cliniques refusent après 12 semaines”, déplore la gynécologue Cyrine Ben Miled. Or, une grossesse de trois mois correspond à 14 semaines d’aménorrhée et non 12.
Autant d’éléments qui entravent la réalisation d’IVG, multipliant les risques pour les femmes de grossesses non-désirées. “On fait perdre beaucoup de temps aux femmes. On les fait aller et venir pour n’importe quelle raison”, commente la présidente de l’association Tawhida.
“Il y a une grève. Le médecin n’est pas là. L'appareil est en panne. Revenez dans une semaine ou deux…”.
La plupart des membres du personnel de santé interrogés estime que le droit d’avorter a été remis en cause à partir de 2011, suite à la montée en puissance du parti politique islamiste Ennahdha. Même s’il est vrai que des représentant·es du parti ont témoigné leur hostilité contre cette législation, à l’image de la députée Najiba Berioul, l’opposition à l’IVG est bien plus ancienne.
“Déjà dans les années 1980. il y avait des formes d'humiliation assez importantes de la part du personnel de santé à l'égard des femmes”, décrit Irene Maffi, anthropologue spécialisée en études de genre. D’après elle, l’émergence d’un discours moralisateur après 2011 tient plus d’une libération de la parole que d’un changement idéologique. “On peut s'exprimer publiquement et agir librement, sans trop craindre d'être licencié", résume-t-elle.
Un manque de volonté politique
Au-delà des discours anti-IVG, beaucoup soulignent la dégradation des services publics après la révolution. Selma Hajri dénonce ainsi un manque de formation du personnel soignant de l’Office nationale de la Famille et de la Population (ONFP), l’organisme responsable des plannings familiaux.
Cet établissement souffre de nombreuses autres défaillances. Anouar El Ouafi, secrétaire général du syndicat de l’ONFP, évoque une mauvaise gestion financière et des nominations arbitraires qui font que l’établissement est géré par “une sorte de mafia”. “On a nommé des gens à la tête qui n'avaient rien à voir”, s’indigne Ahmed, gynécologue dans le secteur public. En 10 ans, plus de neuf PDG se seraient succédé, dont le dernier en date aurait démissionné ce 29 avril d’après les membres du personnel. D’après Anouar El Ouafi, cette situation impacte le fonctionnement des plannings familiaux et par conséquent, le respect du droit à l’avortement.
Le syndicat de l’ONFP prévoit ainsi d’organiser une grève en juillet pour alerter les autorités sur l’urgence d’une intervention, suite à plusieurs demandes adressées au ministère de la Santé, ainsi qu’à l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption. “On revendique seulement que cette institution soit dotée d’une stratégie, qu’un PDG soit nommé, et qu’elle soit nettoyée de tous ceux ayant des affaires de corruption en cours, tant qu’ils n’ont pas été jugés innocents”, énumère Anouar El Ouafi.
Un profond besoin de réforme
Ainsi, alors que le pays était précurseur en légalisant l’avortement dès 1973, la Tunisie montre aujourd’hui plusieurs défaillances dans l’application de ce droit. Pour Nessryne Jelalia, activiste féministe, il existe un manque de “redevabilité” de la part du personnel soignant.
“Aucune femme n’a porté plainte contre un médecin qui lui a refusé son avortement.”
Pour elle, il serait temps de soulever la question de la pénalisation. “C’est le moment”, insiste-t-elle.
Contrairement à d’autres pays, les professionnels de santé refusant de réaliser cet acte médical ne s’exposent en effet à aucune sanction.
"Ça devrait être pénalisé”, défend elle aussi Cyrine Ben Miled. A minima, les médecins refusant de réaliser cet acte devraient avoir l’obligation
“d'adresser la patiente à un confrère qui le pratique”, commente la gynécologue.
“Personne ne fait une IVG de gaieté de cœur […] donc plutôt que d’accabler les femmes, il faut les aider et les accompagner”.