“On a tout essayé pour le rapatrier au pays, mais c’est impossible pour ceux qui sont décédés du Covid-19”, déplore-t-il.
En Tunisie, les autorités ont annoncé le 18 mars la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes ainsi que la suspension de tous les vols commerciaux. Les corps des Tunisien·nes décédé·es autrement que par le virus peuvent être rapatriés par vol de fret, mais c’est chose impossible pour les victimes du Covid-19. Dans l’ombre de cette décision politique, une réalité difficile à vivre pour de nombreuses familles pour lesquelles c’est la double peine. À la perte d’un·e proche s’ajoute l’impossibilité d’honorer ses dernières volontés : être inhumé·e au pays.

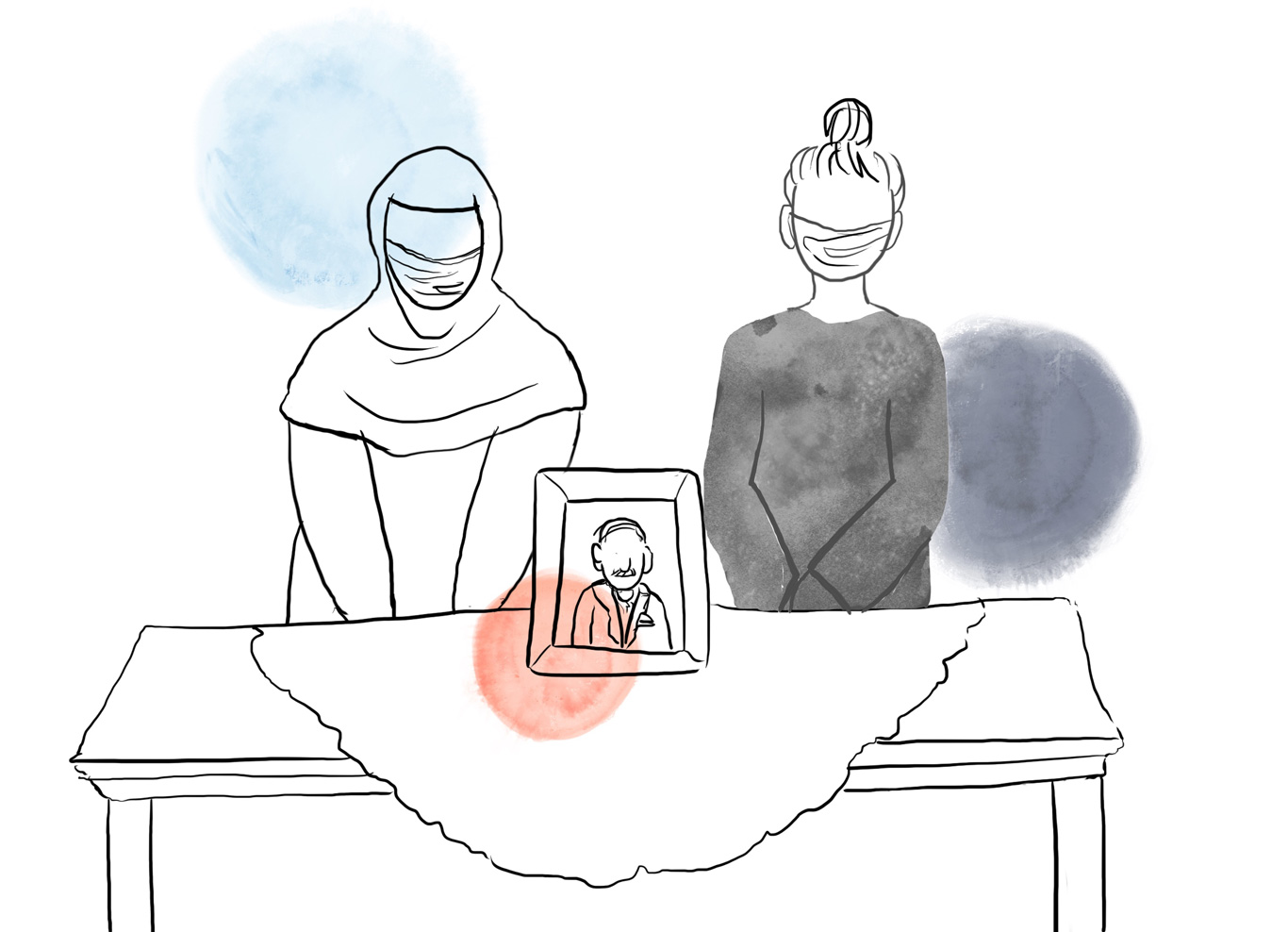
Enterrer en urgence
D’après les autorités, cette décision est due à des règles sanitaires strictes. “Toute opération de rapatriement nécessite un certificat de non-contagion. C’est une procédure exigée aussi par les transporteurs aériens. Il est impossible de délivrer cette attestation pour quelqu’un qui est décédé du Covid-19 et qui serait à priori contagieux”, informe Bouraoui Limam, directeur de l’information et de la communication au ministère des Affaires étrangères tunisien.
Le rapatriement de ces corps est toutefois pratiqué ailleurs, comme en Turquie depuis le début de la crise. Un collectif sénégalais s’est quant à lui monté pour réclamer le retour des dépouilles des Sénégalais·es décédé·es du Covid-19, arguant qu’aucune directive de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne l’interdit.
Au 18 mai, 134 Tunisien·nes ont succombé au nouveau virus en France depuis la déclaration de l’épidémie, selon les chiffres communiqués par le ministère des Affaires étrangères. “La plupart des Tunisiens décédés ici sont des retraités qui vivent en France depuis presque 50 ans et qui avaient entre 60 et 90 ans. Certains étaient en maison de retraite, d’autres étaient venus pour se faire soigner”, informe Naceur Ben Amara, imam référent auprès de la communauté tunisienne en Ile-de-France.
C’est le cas de son ami, M. Aljane, décédé à 80 ans il y a peu. Arrivé en France en 1962, il avait ouvert un des premiers ateliers de pâtisserie tunisienne en France. Atteint du Covid-19 avec sa femme, il n’avait pu être gardé en réanimation, faute de place. Sa veuve, toujours hospitalisée, n’a pas pu assister aux derniers instants de son époux.
Cette crise met donc de nombreuses familles dans une profonde détresse. Au traumatisme du décès et à l’impossibilité de rapatrier les corps s’ajoute celui de ne pouvoir honorer le mort selon l’intégralité des prescriptions religieuses.
Pour des raisons sanitaires - décret du 1er avril sur les dispositions funéraires -, il est interdit de pratiquer le lavage mortuaire, central en islam, et seule la prière peut être récitée. Après le constat du décès, le personnel médical dépose directement le corps dans une housse mortuaire à l’hôpital, en attendant que les pompes funèbres transfèrent le cadavre. “Ce qu’on veut éviter, c’est de maintenir trop longtemps les corps dans les chambres mortuaires. L’urgence est d’enterrer au plus vite”, soutient l’imam Ben Amara.
Pourtant, la contagiosité des cadavres n’est pas avérée à ce jour, et l’OMS considère qu’il est possible de respecter l’ensemble de la pratique, affirmant que "la dignité des morts, leurs traditions culturelles et religieuses et leurs familles doivent être respectées et protégées en tout temps".
En ce qui concerne les procédures, le consulat tunisien prend en charge l’inhumation des victimes. “Nous n’avons eu qu’à fournir le certificat de décès et les papiers de mon père, c’est eux qui ont tout fait”, témoigne le fils Izakri.
L’enterrement s’est fait dans un carré musulman du cimetière de Clichy, en banlieue parisienne, où une quinzaine de personnes étaient présentes. “On a pu s’approcher du cercueil, et le personnel du cimetière nous a aidés. Tout s’est passé comme si on avait été en Tunisie, peut-être même mieux que si on y avait été actuellement”, estime-t-il, faisant référence aux protestations survenues en Tunisie lors d’enterrements de victimes du Covid-19, certain·es habitant·es craignant une contamination.
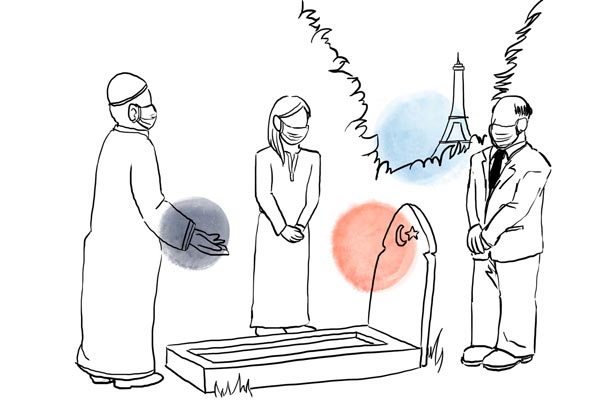
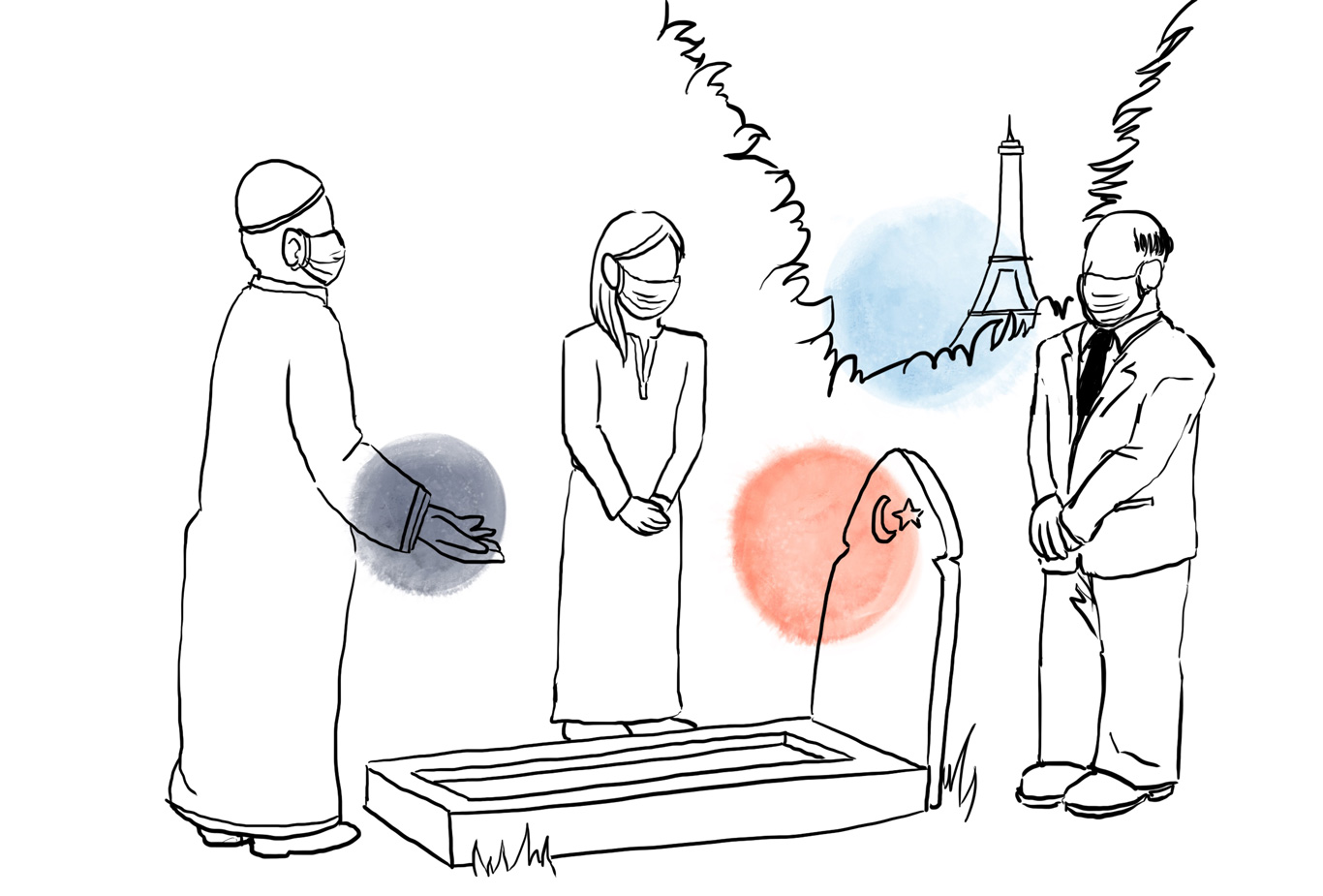
Le manque de carrés musulmans
Depuis le début de la crise, l’imam Naceur Ben Amara a accompagné une vingtaine de familles, dont les défunt·es ont tous·tes, sans exception, pu être enterré·es dans un carré musulman, chose rare dans un pays où le manque de ces espaces funéraires est plus que jamais criant. “Depuis plusieurs années, nous militons avec la Grande mosquée de Paris, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et d’autres autorités religieuses pour avoir un carré musulman dans chaque grande commune française”, commente Naceur Ben Amara.
Mais à ce jour, seules 600 communes sur près de 35.000 en France disposent d’un groupement de sépultures musulmanes.
“C’est trop peu. D’autant plus que certains maires ont pu refuser l’enterrement de musulmans dans leurs cimetières communaux qui ne possèdent pas de carrés musulmans”, déplore l’imam.
Avant l’enterrement, Naceur Ben Amara énonce une douaa* à distance en compagnie des membres de la famille. Puis, le jour des funérailles, le corps est amené par les pompes au cimetière le plus proche du domicile du ou de la défunt·e.
“Pour l’enterrement, je conseille aux malades chroniques, personnes âgées et aux femmes enceintes de ne pas venir”, poursuit-il, “ seules 20 personnes ont le droit d’être présentes”. Lors d’un enterrement à Pantin, 50 personnes se sont présentées et l’imam a dû faire intervenir le service communal et plaider auprès de la famille pour que seul·es les plus proches puissent rester. “C’était un homme originaire de Zarzis qui avait un entourage très solidaire”, commente-t-il.
Pendant la cérémonie, les personnes présentes participent à la mise en bière. “Et à la fin on récite des douaa à côté de la tombe. C’est vite fait, bien fait. L’enterrement dure en moyenne une heure. Personne ne nous presse”.
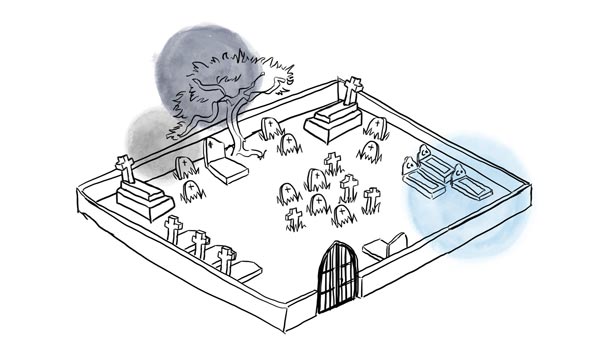
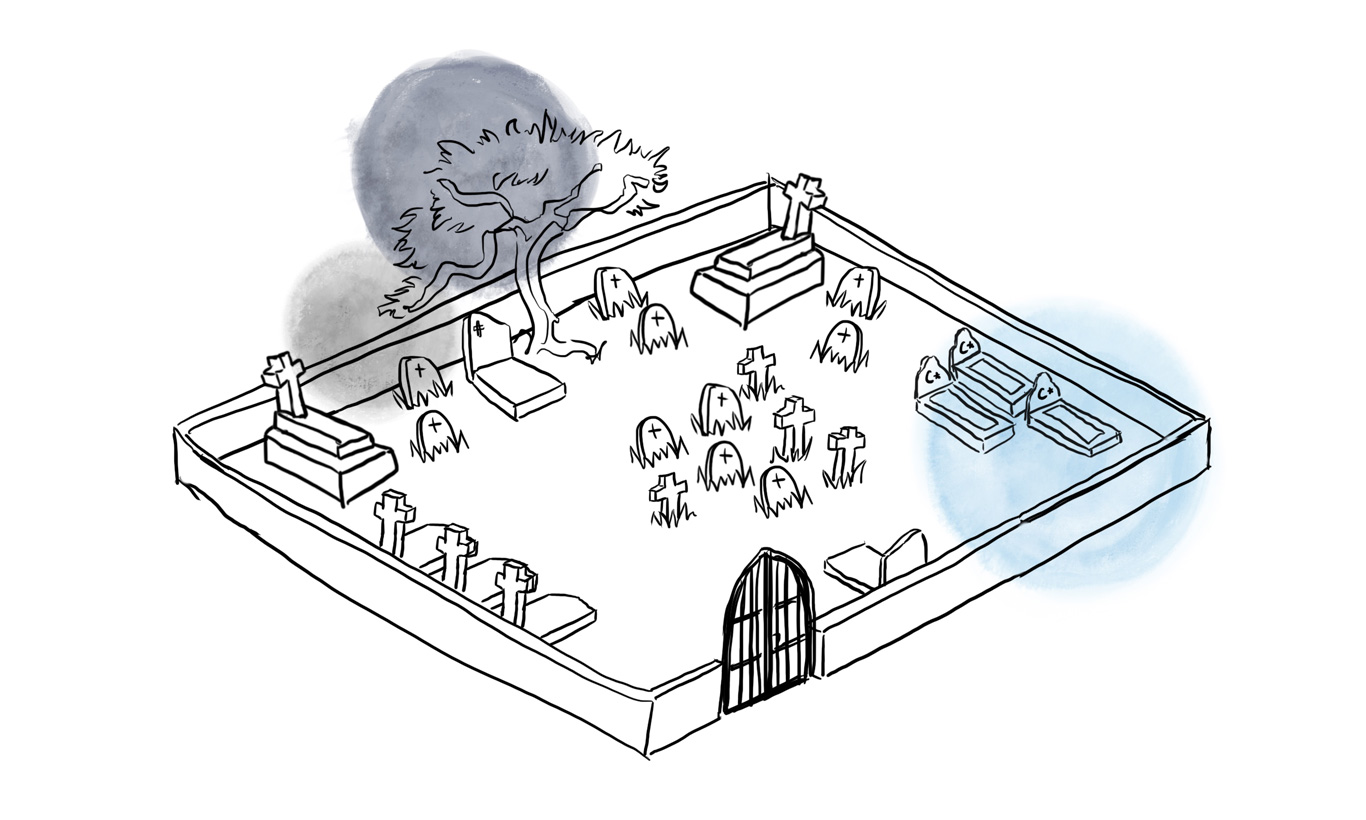
Une rupture des trajectoires familiales
En Tunisie, plusieurs familles désespèrent de ne pas pouvoir assister à l’enterrement de leur proche à l’étranger. C’est le cas des proches d’un diplomate à la retraite âgé d’une soixantaine d’années, originaire de Monastir et décédé en France. “Il avait rejoint sa fille et s’occupait de ses petits-enfants pendant que celle-ci travaillait à l’hôpital”, témoigne une proche. Déjà fragilisé par des maladies chroniques, l’homme a dû être transféré en service de réanimation peu de temps après avoir contracté le virus. Il y décédera une semaine après son admission.
Après sa mort, sa dépouille est restée quatre jours à la morgue, le temps que son fils résidant en Suisse obtienne de justesse les documents nécessaires pour pouvoir assister aux funérailles. “Mais pour sa deuxième fille et les autres membres de la famille vivant en Tunisie, ne pas pouvoir lui dire adieu était une déchirure”, poursuit-elle.
En temps normal, le rapatriement posthume concerne au moins 80% des immigré·es originaires du Maghreb, affirme Valérie Cuzol, chercheuse au centre Max-Weber à Lyon et spécialiste des enjeux de l’inhumation chez les immigré·es originaires du Maghreb et leurs descendant·es.
La Tunisie a quant à elle développé une politique de rapatriement très active, à travers son réseau consulaire, qui prend en charge l’intégralité du processus. Le prix d’un rapatriement peut atteindre 4000 euros, et ce sont chaque année environ 500 dépouilles qui sont acheminées en Tunisie depuis la France.
S’il se peut que ce dispositif étatique encourage les retours posthumes, il s’agit avant tout d’un choix intime. “Le rapatriement post-mortem n’est pas un simple retour en terre natale”, souligne Valérie Cuzol. “Par le rapatriement, on réintègre le défunt dans une filiation. Il y a aussi la volonté de réparer le coût de l’absence et la rupture des trajectoires familiales provoquées par la migration”, soutient-elle.
À noter qu’en France, la concession n’est pas perpétuelle. Dans la situation actuelle, pour les victimes du Covid-19, l’État tunisien y pourvoit pour cinq ans. Au-delà de ce délai, les frais de concession seront à la charge des familles.
Cependant, il devrait être normalement possible d’exhumer et de rapatrier les corps une fois la situation apaisée. À Monastir, la famille du diplomate décédé est décidée à ramener sa dépouille en Tunisie. Même son de cloche du côté de la famille Izakri en France.
“On va tout faire pour rapatrier mon père, une fois le retour à la normale”, assure le fils du défunt.
Mais même si cette procédure est validée théologiquement, “il est très probable que de nombreuses personnes ne soient pas rapatriées”, doute Tarek Toukabri, président de l’association des Tunisiens de France. Car si l’État tunisien s’engage à encadrer les enterrements des victimes du Covid-19 en France, “les frais d’exhumation et de rapatriement, très coûteux, seront toutefois à la charge des familles”, ajoute-t-il, dans un futur qui demeure plus qu’incertain.




