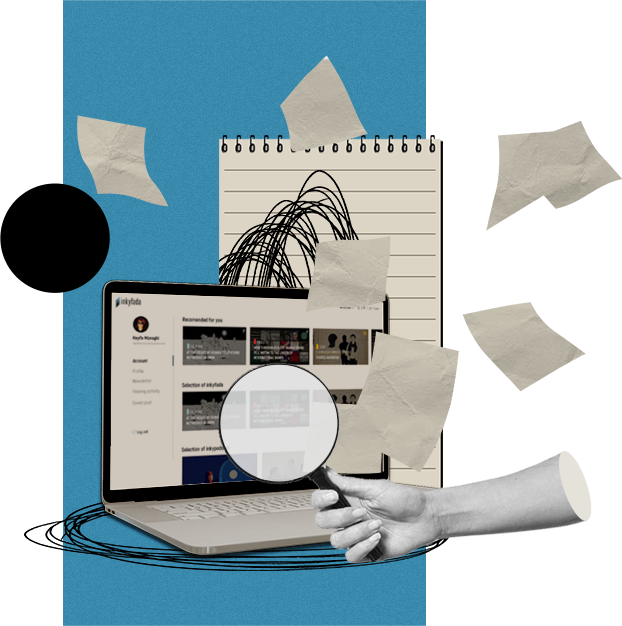À l’entrée du camp, plusieurs groupes de migrant·es s’abritent du soleil sous les zitounes [ndlr: les oliviers]. Derrière eux, des centaines de cabanes, tentes et autres abris de fortune étalés sur environ sept hectares. Un groupe de jeunes Guinéens s’affaire d’ailleurs à couper du bois pour construire un abri.

“Il y a quelques semaines, la police a dit de partir et ils sont venus casser l’ancien camp”, explique l’un des Guinéens, ajoutant que “ce sont les forces de l’ordre qui nous ont dit de nous réinstaller ici, on ne sait pas vraiment pourquoi.”
Officiellement, le kilomètre 22 n’existe plus : il a été rasé à la fin du mois d’avril par les forces de l’ordre tunisiennes, dans le cadre d’une vaste opération sécuritaire lancée à la fin du mois de Ramadan et ciblant beaucoup d’autres campements des environs. Le porte-parole de la garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, avait alors exclu toute possibilité “d’un retour au chaos ni à l’édification de camps anarchiques”.
Pourtant, le campement a été entièrement reconstruit, à quelques mètres seulement de l’ancien emplacement, et selon les migrant·es, avec l’accord tacite des forces de l’ordre. Au-delà du déplacement forcé et de la peur d’être arrêté·es, les migrant·es expliquent surtout que beaucoup de leurs affaires ont été brûlées.



Les migrant·es se plaignent surtout des restrictions croissantes autour des camps. “On ne nous laisse pas aller à Sfax travailler, pas de louage, pas de taxi, et on nous bloque la route [vers l’Europe, NDLR] en mer”, s’insurge Ibrahima, un jeune Malien entré en Tunisie il y a plusieurs mois, qui dit avoir le sentiment de “vivre en prison à ciel ouvert”.
Depuis le début de l’année 2025, les chiffres des arrivées de migrant·es à Lampedusa depuis les côtes tunisiennes ont fortement chuté. Si les forces de l’ordre tunisiennes semblent donc être parvenues à endiguer les flux, les conditions de vie dans les zitounes n’ont cessé de se détériorer depuis leur création à l’été 2023, tandis que l’opinion publique n’a cessé d’être exposée aux rumeurs et à la désinformation sur le sujet.

“Un État dans l’État”
Il est vrai qu’en près de deux ans, le visage des camps a changé à plusieurs reprises. Alors que les migrant·es dormaient au départ à même le sable, après les expulsions massives de Sfax en juillet 2023, certains kilomètres ont très vite vu champignonner les cabanes et abris faits-maison, notamment à l’approche de l’hiver. Malgré les opérations de police récurrentes et de premières opérations de démantèlement de camps, les communautés se sont structurées autour de groupes plus ou moins organisés : tantôt appelées “présidences”, “chefferies” ou “sécurité” — en réalité des structures d’autogestion complètement improvisées.


À El-Amra, les salons de coiffure de fortune dans les ‘zitounes’ illustrent une activité d’autogestion essentielle pour répondre aux besoins quotidiens des migrant·es.
Une situation connue depuis longtemps à El-Amra, mais mise en lumière à l’échelle nationale début mars 2025, lors d’une visite la députée Fatma Mseddi (indépendante) dans le camp du “kilomètre 34”. Dans une vidéo devenue virale, l’élue s’offusquait de la présence d’échoppes improvisées vendant des médicaments et des produits alimentaires, tout en constatant la présence de tentes avec des télévisions.
Dans plusieurs campements, les migrant·es avaient aussi mis en place des formes d’organisation interne, comme des “présidences” autogérées ou des responsables de zones. Certains faisaient payer le “droit” de s’installer dans les zitounes — en général par l’intermédiaire des passeurs. Un moyen de financer la construction de toilettes et de douches, mais aussi d’alimenter ces systèmes internes. Fatma Mseddi dénonçait alors la création d’un “État dans l’État”.
Plusieurs semaines plus tard et malgré les destructions et reconstructions, force est de constater que la situation reste inchangée. Dans les zitounes du “kilomètre 21”, à quelques centaines de mètres du 22, le camp a été reconstruit presque à l’identique, y compris les échoppes de fortune vendant de l’eau et des produits alimentaires de base (achetés aux Tunisien·nes des alentours) et même une “pharmacie” sommaire, sur le même modèle. Selon Chris, un Camerounais présent en Tunisie depuis trois ans et à El-Amra depuis dix mois, ces quelques éléments de confort de fortune sont en réalité absolument dérisoires par rapport aux besoins des migrant·es.
“Changer la composition démographique”
Dans les zitounes d’El-Amra, plusieurs enfants comme Noel ont aussi vu le jour dans des conditions extrêmes. Les maladies infectieuses, les blessures graves et l’absence de prise en charge psychologique sont autant de problèmes récurrents selon les migrant·es. Mais les habitants du 21 savent aussi que la situation pourrait être bien pire. Au " kilomètre 24", les migrant·es n’ont pas reconstruit d’abris après avoir fui en urgence leurs anciens campements. Mohamed*, un Soudanais d’une trentaine d’années, explique que le seul moyen d’obtenir de l’eau est de se fournir, une fois par jour, auprès de la mosquée.

Selon Mohamed, les Tunisien·ns qui tenteraient d’aider les migrant·es d’une manière ou d’une autre s'exposent aussi à des poursuites de la part de la police, ce qui augmente d’autant plus la précarité dans laquelle ils survivent. Reste que de nombreux locaux continuent à proposer certains services dans les camps : transports sur des motocycles, vente d’eau ou de charbon, ou tout simplement de produits de première nécessité.
“Dans l’Islam, il est inscrit qu’il faut aider son prochain, d’autant plus s’il est musulman”, souligne Mohamed, qui s’exprime par ailleurs parfaitement en arabe.


“Une entreprise criminelle”
Les migrant·es sont aussi régulièrement accusé·es d’être responsables d’agressions, de vols ou encore de l’insécurité en général. Au mois d’avril, le porte-parole de la garde nationale, Houssemeddine Jebabli avait d’ailleurs expliqué que “des outils tranchants et d'autres matériaux solides” avaient été confisqués lors des opérations de destructions des camps. Des armes “qui étaient en leur possession dans le but d'attaquer le personnel de sécurité” selon lui. Au " kilomètre 21", Chris veut reconnaître que le comportement d’une minorité de personnes problématiques ou d’actes violents isolés ont pu orienter la perception de la population tunisienne.

Chris est arrivé en Tunisie il y a trois ans et est installé à El-Amra depuis 10 mois. Son fils, Noel ,est né en Tunisie, dans des conditions plus que précaires.
Récemment installé au kilomètre 22, Mamadi Camara assure quant à lui que “la majorité des gens ici sont des jeunes motivés, pour certains avec plein de talents”. Ce jeune Guinéen, bientôt majeur et passionné de journalisme sportif, a fui son pays d’origine après le coup d’État de Mamadi Doumbouya, sans cacher son ambition de rejoindre l’Europe pour un avenir meilleur.


“J’aimerais bien aussi poursuivre les études, en France ou en Italie”, se souhaite le jeune adulte, qui a gagné la Tunisie par ses propres moyens et ne bénéficie d’aucun soutien de sa famille. Selon Mamadi, “beaucoup de jeunes comme moi dans les zitounes ont du talent, c’est une ressource inexploitée”.
Surtout, les migrant·es mettent en avant le fait qu’ils sont les premières victimes de crimes et d’actes violents, lorsqu’ils surviennent. Au "kilomètre 24", beaucoup de Camerounais sont ainsi arrivés ces dernières semaines après que des bagarres entre groupes ou communautés (les “palabres”) ont éclaté dans les autres campements de la région. Francine* se souvient d’une nuit de palabre au 21 où “les Camerounais ont été chassés, frappés et volés”.
“J’ai dû renier ma nationalité pour m’en sortir. Un homme est venu vers moi, je lui ai dit que j’étais Ivoirienne, puis je me suis enfuie”, raconte Francine, qui assure que “sans ça, ils auraient pu me faire n’importe quoi, même me violer.”
Face à ces violences bien réelles, les migrant·es expliquent aussi que les forces de l’ordre ne sont d’aucune aide : “ils arrivent après les événements et cassent les camps”, explique Francine.

La fabrique d’un fantasme de colonisation
En février 2023, avant même l’établissement des camps à El-Amra, Kaïs Saïed avait aussi expliqué dans un discours que la présence de migrant·es en Tunisie s’inscrivait dans un complot visant à “changer la composition ethnique du pays”. Un argument qui laisse les migrant·es abasourdis : selon leurs propres dires, l’immense majorité d’entre eux ne souhaitent absolument pas rester en Tunisie.
Même si les départs se font de moins en moins fréquents, ou sont plus souvent stoppés, au kilomètre 22, des bouées de fortune, que les migrant·es peuvent s’offrir pour 15 dinars, sont encore proposées à la vente.
Face au blocage à El-Amra, d’autres sont aussi nombreux à demander d’être renvoyé·es dans leurs pays par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Ces dernières semaines, l’agence de l’ONU aurait, selon les migrant·es, déployé plusieurs campements mobiles dans les zitounes pour enregistrer des demandes de retours directement auprès des bénéficiaires, puisque ces derniers sont empêchés de se déplacer entre les villes.
L’organisation était fin juin au kilomètre 21, “mais ne prenait les demandes que pour les personnes qui avaient encore leurs passeports, et seulement certains pays”, se souvient un jeune Nigérian qui explique s’être fait “confisquer” ses papiers lors d’un contrôle de police il y a un an.
Surtout, d’autres migrant·es expliquent tout simplement ne pas pouvoir retourner dans leurs pays d’origine.
“Ce n’est pas possible, je risque de me faire tuer si je rentre”, explique Ibrahima, originaire de Tombouctou, une région où s’affrontent aujourd’hui jihadistes maliens et paramilitaires de l’African Corp.
Même histoire pour Noel et son père Chris, qui a été chassé de la ville de Kumba, où la population subit régulièrement des exactions ultra-violentes de la part de groupes armés séparatistes et des forces de défense camerounaises. Selon Chris, “la seule solution pour nous, c’est d’entrer en Europe.”