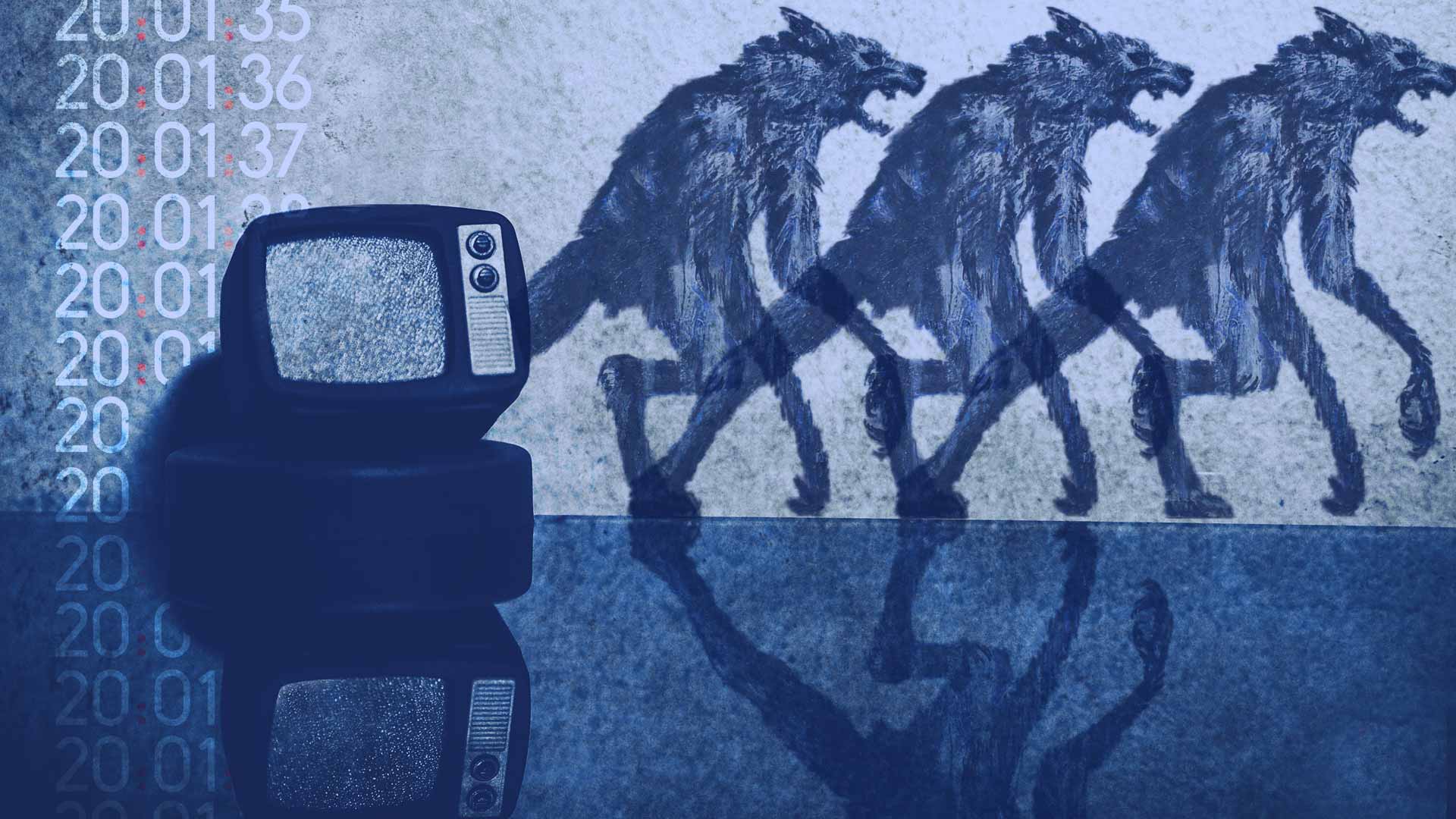L’ambiance était lourde jeudi 17 juillet au Syndicat National des Journalistes Tunisiens. Après une minute de silence en hommage aux militaires morts la veille, les têtes de la profession se sont réunies dans la soirée pour discuter des problèmes de la couverture médiatique des événements.
La dernière attaque du Mont Chaambi a soulevé des questions et des critiques quant au traitement de l’actualité concernant le terrorisme et la situation sécuritaire. Un événement qui a, une fois de plus, fait ressortir les lacunes de la profession sur ces thématiques : rapporter les faits reste le problème majeur des médias à cause du manque d’informations et de l’absence de clarté sur la question terroriste. La nouveauté du phénomène et le manque de formation jouent aussi.
Mercredi 16 juillet, au moment de la rupture du jeûne, les réseaux sociaux et quelques médias locaux rapportent une nouvelle confrontation entre présumés terroristes et militaires à Henchir Ettala sur le mont Chaambi, théâtre d’opérations terroristes depuis plus de deux ans et déclarée zone militaire.
Alors que certaines chaînes de télévision continuent à diffuser leurs programmes ramadanesques, voire même un documentaire sur le lait dans le cas de la Télévision Nationale, les données contradictoires se succèdent, engendrant l’incompréhension et la colère des spectateurs face au manque d’informations.
De 2 morts à 5 morts, le bilan de la soirée s’élève ensuite à 22 morts pour finalement arriver à un bilan définitif de 14, puis 15 morts et 18 blessés. Du côté des assaillants, le ministère de la Défense annonce encore des chiffres « approximatifs » jeudi soir pour confirmer un mort du côté assaillant parmi les 40 à 60 présumés terroristes qui auraient mené l’attaque selon l’AFP.
La première déclaration presse sera diffusée sur la chaîne nationale dans la soirée. Le drame de Chaambi n’annonce pas seulement de nouveaux martyrs mais marque aussi le décalage total entre la couverture médiatique et les faits.
Précipitation, manque d’informations, chiffres erronées, manque de réaction et de préparation pour un flash spécial à une heure de grande audience, certains médias semblent avoir été débordés par les événements.
Entre manque de communication de la part des instances officielles et mauvais traitement de l’information, les médias sont confrontés de plein fouet à des questions de professionnalisme et d’éthique depuis la révolution, surtout en matière de terrorisme.
Traiter du terrorisme : un exercice nouveau
La plupart des journalistes et des rédacteurs en chef interrogés pour cet article s’accordent sur un constat : le terrorisme est pour eux un phénomène nouveau en Tunisie qui nécessite une couverture spécifique et une spécialisation sur les questions sécuritaires souvent absentes dans les formations des journalistes.
Pourtant sous Ben Ali, le phénomène du terrorisme existait comme l’ont montré les attaques de la synagogue de la Ghriba en 2002 et les évènements de Soliman en 2007. Certains journalistes tentaient tant bien que mal d’enquêter. La différence réside aujourd’hui dans la fréquence des attaques terroristes et la présence d’acteurs dont les objectifs sont difficiles à cerner.
Selon Riadh Ferjani, sociologue des médias et membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), il y a toujours eu sous le régime Ben Ali comme sous celui de Bourguiba, une disjonction entre les faits et leur couverture médiatique en Tunisie. Dans le cas des attentats de la Ghriba par exemple le 11 avril 2002, des journaux officiels comme le Renouveau avaient mis prés d’un mois après les faits pour qualifier l’évènement d’attentat et non plus d’accident, suivant ainsi la ligne du régime.
Mohamed Mahdi Jelassi, ancien journaliste du journal d’opposition Al Mawkaf (ancien journal du parti PDP) avait été emprisonné lorsqu’il avait tenté d’enquêter sur les évènements terroristes de Soliman en 2007.
« J’avais essayé d’aller voir les familles victimes du terrorisme et dès mon retour à Tunis, j’ai été questionné au sein du ministère de l’Intérieur et mis en prison pendant plus de cinq mois. A l’époque tout était verrouillé, il fallait aller sur place et être très prudent pour avoir un semblant d’information. »
Arrêté sous le coup de la loi antiterroriste, les services du ministère de l’Intérieur l’avaient soumis à un interrogatoire et torturé pour connaître l’identité de ses sources.
La difficulté d’avoir une source fiable
Aujourd’hui il juge la situation encore plus difficile du fait de la multiplication des sources et des informations contradictoires.
« Avant on savait qu’il fallait contourner l’information officielle car elle était souvent fausse, maintenant il y a toujours un manque de confiance qui s’ajoute aussi à l’explosion de rumeurs et d’informations. Certes on ne risque pas la prison pour avoir enquêté mais on risque de ne jamais avoir une vraie source fiable », dit-il.
Zied Krichen, rédacteur en chef du journal le Maghreb, perçoit le terrorisme comme un nouveau phénomène à couvrir mais rejoint M. Jelassi sur un point : la difficulté de cerner les acteurs et de recouper l’information.
Il admet même que le foisonnement de témoins oculaires dans ces cas ne donne pas forcément une meilleure information:
« Il faut aussi vérifier leurs témoignages et éviter d’aller vers le scoop. Notre problème ce n’est pas le professionnalisme, c’est vraiment l’éthique. Le scoop reste plus important que le reste pour beaucoup de journalistes. »
Le recoupement des sources est primordiale pour s’assurer d’une information. Or, Omar Mestiri, ancien directeur de Radio Kalima, explique qu’il y a eu un réel basculement avec les évènements de Chaambi. "On appelle de plus en plus à n’écouter que les sources officielles et à ne pas gêner le travail de l’armée alors que le domaine du terrorisme doit être réservé à la police et à l’armée, le journaliste n’en fait pas partie. Il n’est pas là pour prendre position."
« A l’occasion de l’opération de Raoued les 3 et 4 février 2014, le ministère de l’Intérieur a multiplié les mises en garde contre l’utilisation des sources non-autorisées. Des agressions avaient été enregistrées pour empêcher les journalistes de s’approcher du thêatre des opérations. Sous couvert d’appel à la vigilance, il y a aussi un verrouillage de l’information », estime Riadh Ferjani.
L’information sécuritaire officielle, entre désinformation et tentative de réforme
Avant épicentre de la sécurité et de la répression, le ministère de l’Intérieur était considéré comme une forteresse dont rien ne filtrait. Aujourd’hui, le nouveau porte-parole Mohamed Ali Laroui tente tant bien que mal de répondre à l’afflux de questions des journalistes, dès qu’un évènement terroriste a lieu. Mais entre points presse et déclarations au compte-gouttes, le ministère reste souvent avare d’informations détaillées au nom de la raison sécuritaire.
En cas de crise, certains médias ont accès exclusivement à des informations du ministère, d’autres doivent attendre le point presse sans jamais pouvoir joindre un interlocuteur. « Pendant les points presse, il est difficile d’insister et de confronter le porte-parole sur des zones d’ombre. Les journalistes n’ont le droit souvent qu’à une question par média, et on ne peut pas insister jusqu’à avoir une réponse claire à cause du temps de parole », déclare Mohamed Mahdi Jelassi.
S’ajoute à cela de vieux réflexes de propagande, comme les vidéos mis sur la page Facebook, filmées par le service de communication et mettant en scène les descentes de la garde nationale et ses exploits.
Il existe toujours un risque de manipulation par les sources, dont les journalistes doivent être conscients. Par exemple, lorque les journaliste sont plus ou moins autorisés à filmer la reconstitution d’une scène d’un crime comme celui de Chokri Belaïd.
Ils devraient s’interroger sur les motivations des forces de l’ordre à leur ouvrir l’accès à ce type de scène.
Parfois, le ministère tombe aussi dans l’information douteuse ou la rumeur. Il n’a jamais donné d’explications claires sur le cas des jeunes jihadistes supposés "s’entraîner dans des camps" à Menzel Ennour près de Monastir. Une information avancée lors d’une conférence de presse et discrédité par les médias.
En 2012, déjà, le ministère n’hésitait pas à nier certaines informations sans justification. Ainsi l’ancien porte-parole, Khaled Tarrouche, avait déclaré qu’il n’y avait pas de camps d’entraînement en Tunisie mais seulement des “sportifs”.
Cette tension entre médias et sources officielles est perceptible aussi dans les rapports de force entre médias et police. Sur le terrain, les policiers intimident plus les journalistes qu’ils ne les protègent et la plupart des agressions envers les journalistes sont commises par des forces de l’ordre comme le confirment les nombreux rapports du Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse.
Selon Lotfi Hidouri, il y a bien eu un effort du côté du ministère de l’Intérieur qui a tenté en partenariat avec l’UNESCO d’adopter un code de conduite pour le rapport entre forces de sécurité et médias.
« Nous y avons mis la loi sur le cadre sécuritaire à respecter en tant de crise mais surtout comment traiter les journalistes sur le terrain afin d’éviter des dépassements comme ceux du 9 avril 2014. Mais la charte n’a jamais vraiment été mise en place au sein du ministère », témoigne Lotfi Hidouri, ancien journaliste reconverti pendant la révolution en attaché de presse au sein du ministère de l’Intérieur.
L’administration a toujours du mal à communiquer
Selon Lotfi Hidouri, changer les mentalités sur l’accès à l’information reste difficile. Il a passé près de deux ans au sein du ministère avant de retourner aujourd’hui dans le journalisme.
« Le problème de la communication sécuritaire depuis la révolution a été lié aussi au fait que le ministère de l’Intérieur a confisqué pendant un temps, le travail du ministère de la justice qui a nommé un vrai porte-parole seulement récemment. »
Les journalistes ont du mal à suivre les dossiers notamment des personnes arrêtées pour terrorisme car il y a souvent un embargo du côté de la justice et du procureur général qui n’a pas d’attaché de presse. Le seul moyen de s’informer reste alors les avocats comme au temps de Ben Ali.
« Aujourd’hui, si le ministère de la Justice s’est muni d’une cellule de communication, d’autres problèmes se posent. La multiplication de sources au sein du ministère induit souvent en erreur. Les agents de police et les syndicats de sécurité n’hésitent plus à parler. Parfois certains syndicats ont eux-mêmes des comptes à régler avec le ministère donc l’information n’est pas toujours fiable », ajoute Lotfi Hidouri.
Problème de définition du terrorisme et manque de connaissances
Pour Mohamed Jelassi, dans le cas du terrorisme, l’un des manques reste la définition même du terrorisme en Tunisie mais aussi une connaissance des groupes salafistes. « Par exemple, quand on parlait des salafistes en Tunisie, tout le monde se focalisait sur la figure d’Abou Iyadh dans les médias dominants alors qu’il y également Khatib Idrissi qui a beaucoup plus d’influence sur le mouvement Ansar Charia. »
Un des dérapages récents qui témoigne d’un manque de connaissances ou de recherches sur les acteurs du salafisme-jihadisme en Tunisie est celui d’un site d’information généraliste qui a relayé qu’un des leaders d’Ansar Charia en Tunisie avait prêté allégeance à l’ISIS ou DAASH (Etat islamique en Irak et le Levant) dans un meeting tenu début juillet en 2014. La journaliste s’est basée sur une vidéo publiée par la page Facebook Kairouan FM. Il s’est avéré après publication, que la vidéo datait d’un meeting d’Ansar Charia en 2013.
Le maintien de l’article en ligne, avec une simple mention « mise à jour », a créé une confusion et un effet boule de neige, l’info ayant été reprise par plusieurs médias numériques et sur les réseaux sociaux.
Pour Lotfi Hidouri, le véritable problème viendrait de la formation des journalistes. Les jeunes journalistes seraient mal entraînés au terrain et surtout en culture générale. « Par exemple dans certains journaux, ce sont les journalistes des faits-divers qui s’occupent de terrorisme », commente-t-il.
Si d’autres journalistes plus spécialisés sur les enjeux politiques et sécuritaires traitent désormais du terrorisme comme Hédi Ahmed du site arabophone Hakaek, c’est grâce à une expérience acquise via la pratique et le terrain. L’homme connaît déjà certaines tendances jihadistes et le phénomène de radicalisation dans les prisons tunisiennes. Il a effectué plusieurs enquêtes sur les lieux de détention et les salafistes emprisonnés sous Ben Ali.
« Cela m’a permis de mieux cibler les enjeux. Par exemple, beaucoup de journalistes ne comprennent pas aujourd’hui que les terroristes se servent aussi des médias pour leur propagande et qu’il faut faire attention avec les informations qu’ils divulguent dans leurs communiqués ou via les réseaux sociaux. »
Dans ce cas là, l’exemple de l’interview d’Abou Iyadh qui devait être diffusée sur Mosaïque FM et qui a été finalement censurée, reste un cas d’école. La question qui se posait était de savoir si l’on peut laisser diffuser une interview d’un homme considéré comme terroriste et surtout, recherché à l’époque par la police tunisienne ? La censure apriori n’a pas servi puisque l’organisation Ansar Charia a ses propres outils de communication et une vidéo de l’interview a été rendue publique sur Youtube, quelques heures après la conférence.
Parfois certaines informations classées confidentielles filtrent dans les médias tunisiens comme lorsqu’un journal a publié une carte des positions de l’armée tunisienne dans la lutte contre le terrorisme.
« Les vrais questions déontologiques se posent à ce moment là, car on ne sait pas si c’est vraiment d’utilité publique de publier ce genre d’information alors que de l’autre côté, les terroristes s’en servent allègrement », déclare Hédi Ahmed.
Le manque de formation
« Le manque de formation au terrain se voit quand par exemple, un journaliste met sa vie en danger dans une opération sécuritaire comme à Raoued. Parfois eux-mêmes ne savent pas où sont leurs limites dans des situations de crise sécuritaire. » L’autre alternative serait donc de proposer une formation spéciale afin de sensibiliser les journalistes au terrain, à leur sécurité comme le fait Zied Dabbar, journaliste et membre du Syndicat des journalistes mais aussi directeur du bureau de la Fédération internationale des journalistes à Tunis. « On essaye de les sensibiliser à leur protection, cela s’est fait avec les gilets de presse par exemple dans de nombreux évènements. Aujourd’hui, il faut former d’avantage à comment agir sur le terrain. » « Il y a des formations en déontologie des médias à l’IPSI et les principes éthiques de la profession sont inscrites au dos de la carte de presse. Donc on ne peut pas dire que les jeunes journalistes ignorent la déontologie. Par contre dès qu’ils arrivent dans les rédactions, ils sont souvent jetés en pâture et victimes d’un manque de moyens. Il est rare de les voir envoyés sur le terrain et on les incite plus au modèle journalistique qui est le nôtre, à savoir le commentaire de l’actualité et non pas la production d’informations » commente Sadok Hammami responsable du département Recherche à l’IPSI (Institut de Presse et des Sciences de l’Information)
Dans le cas de la couverture du terrorisme, ce modèle journalistique d’opinion, inspiré du modèle français, fait défaut car en plus de l’information, le besoin d’explication est nécessaire.
« Il nous manque des journalistes qui expliquent ce qu’il se passe, via des infographies, des schémas. Nous sommes toujours dans ce modèle d’actualité chaude et d’informations en continu mêlés à de l’émotionnel sans réel recul ou analyse » ajoute Sadok Hammami. Ce problème du sensationnalisme est souvent visible dans les Unes des quotidiens qui mettent en scène via des photomontages, les terroristes, toujours présentés kalachnikovs et keffiehs en main.

L’objectivité grande absente du traitement médiatique du terrorisme
Le 10 février 2014, le Syndicat tunisien des journalistes publie un communiqué dans lequel est dit qu’avec le terrorisme, impossible d’être objectif. Une partie de la profession qui approuve sans détours. « Oui, en tant que journaliste et citoyen tunisien, je ne donnerai pas de tribune à un terroriste dans mon journal », commente Zied Krichen.
D’autres vont plus loin dans l’élan patriotique, estimant que dès que l’on parle de terroristes, les mots subjectifs et l’opinion sont autorisés dans un article informatif.
Cette déclaration du syndicat et son interprétation soulèvent pourtant des questions sur le plan déontologique.
Riadh Ferjani, souligne le danger de faire prévaloir l’impératif de sécurité sur ceux de la liberté d’expression et du droit d’accès à l’information. La couverture de ce type d’événements doit tenir compte de ces trois impératifs sur un même pieds d’égalité. « Le droit d’accès à l’information est aussi sacré que la sécurité des personnes et le journaliste se doit d’être le plus objectif possible dans toutes les situations. »
Le communiqué du Syndicat des journalistes était aussi à prendre dans son contexte et semble avoir été mal compris. Le syndicat dénonçait l’émission de l’animateur Samir El Wafi qui avait invité des supposés « terroristes » sur son plateau télévisé. Le communiqué faisait donc office de rappel à l’ordre.
Pour certains médias, c’est l’effet inverse et les dérapages sont aussi fréquents quand au nom de la liberté d’expression, certains présentateurs ne maîtrisent plus leur invité. En 2012, l’animateur Moez Ben Gharbia avait invité en duplex un homme qui en plein milieu de l’émission, appelle au jihad et sort son linceul pour le brandir devant les téléspectateurs.
Les exemples d’invités « douteux » dans la mesure où ils ont été liés à une activité terroriste sont nombreux mais c’est surtout le traitement qui leur est réservé qui pose encore un problème de déontologie. Soit ils sont invités pour avoir un procès en direct soit ils se retrouvent face à des animateurs complaisants qui tentent de leur faire sortir des phrases sensationnalistes sous prétexte de « montrer un autre point de vue ».
A chaque fois, les animateurs semblent négliger la valeur informative de l’interview et préfèrent une certaine subjectivité. La pertinence de ces invités est aussi remise en cause quand ces derniers manquent de crédibilité comme dans le cas du Cheikh Khamis Mejri ou encore celui du présumé jihadiste parti en Syrie, ou encore du supposé « terroriste repenti » invité par la chaîne nationale le 4 juillet 2014 dont les commentateurs se sont allègrement moqués.
Ces interviews donnent en effet plus l’impression de mises en scènes que de réelles confrontation journalistique avec un interlocuteur crédible. L’excès de patriotisme et de populisme est aussi visible dans certains débats comme celui de la chaîne Nessma TV qui a suivi les derniers évènements de Chaambi. Réunissant des invités qui avaient tous le même point de vue, juste après la mort de 14 militaires, le débat en est arrivé à la conclusion qu’il ne fallait plus parler de « droits de l’homme » avec le terrorisme. Manquant d’équilibre dans les intervenants et d’un angle réellement informatif, le débat a répondu à l’émotion populaire qui suit une attaque terroriste.
Face à ces dérapages, les médias se retrouvent pris à leur propre piège et leurs détracteurs utilisent souvent ces dérives pour alimenter un discours anti-média, très fréquent en Tunisie également.
Les médias sont ainsi accusés d’être des « blanchisseurs du terrorisme » et de participer ainsi consciemment ou inconsciemment à la propagande des groupes terroristes comme Al Qaïda qui ont développé une stratégie de communication très rodée.
« Les médias restent aujourd’hui très partisans et liés à des enjeux de pouvoir qui sont visibles dans le cas du traitement du terrorisme, on le voit avec les nombreuses théories du complot par exemple. Il n’y a pas aujourd’hui de vrai pluralisme dans le secteur malgré la multiplication des nouveaux médias », commente Omar Mestiri.
La question de l’atteinte à la dignité humaine et la présomption d’innocence
Pendant la couverture des évènements terroristes qui ont suivi la révolution, une question déontologique a souvent été posée sans avoir été résolue. Faut-il montrer les corps ensanglantés parfois déchiquetés des terroristes de Chaambi où des victimes militaires? L’atteinte à la dignité humaine fait partie des dérapages possibles quand un média choisit de publier ce genre d’images sans flouter la personne.
Les premières images de ce genre ont été montrées l’année dernière quand la Télévision nationale a choisi de diffuser corps des soldats morts à Chaambi en juillet 2013.
"Malgré certaines demandes de diffuseurs, la Haica n’a pas à se prononcer sur les contenus avant leurs diffusion, car cela pourrait réouvrir la porte de la censure préalable. Les sanctions prévues par le décret-loi 116 sont: l’apologie du terrorisme, l’incitation à la haine, l’atteinte à la dignité humaine sont des notions désormais connus de tous les diffuseurs même si certains d’entre-eux feignent encore les ignorer", commente Riadh Ferjani.
Basé sur l’article 5 du décret loi Décret-loi N° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), le respect de la « dignité de l’individu et de la vie privée » font partie des règles qui conditionnent la liberté d’expression.
Aujourd’hui, les images de corps calcinés ou mutilés continuent pourtant de se succéder. Pour son premier numéro, le journal officiel du parti Nida Tounes a choisi de publier la photo du corps calciné du Kamikaze mort à Sousse en octobre 2013.
Dans le nouveau décret 115 relatif à la liberté de la presse de nombreux articles stipulent pourtant tout comme dans le cas de l’audiovisuel que la liberté d’expression s’exerce selon certaines règles:
Décret-loi N°2011-115 Extrait Art 1er
Cette même règle s’applique aussi pour la présomption d’innocence. A l’époque des recherches autour du meurtrier de Mohamed Brahmi, plusieurs journaux avaient publié des photos des personnes recherchées par la police, les accusant directement de terroristes sans respecter la notion de présomption d’innocence.
La nécessité de donner d’avantage de moyens pour réformer le secteur
Aujourd’hui, le secteur médiatique est encore en transition mais certains journalistes affirment le besoin de réforme. La réunion du syndicat des journalistes juste à la suite des évènements de Chaambi le 16 juillet, a montré que la profession a une capacité d’autocritique malgré ses défaillances. De même que la présence de la HAICA dans le paysage audiovisuel a permis de prendre des mesures de sanction contre les émissions ne respectant pas la déontologie du métier.
« Tout en condamnant le terrorisme, le journaliste doit faire son travail et aller au plus proche possible de la vérité et de la réalité des faits. Il faut éviter les copiers-collés de communiqués officiels », déclarait en avril 2014 à Inkyfada, Lotfi Haji, journaliste et directeur du bureau d’ Al Jazeera à Tunis.
L’autre enjeu reste de trouver un équilibre entre la liberté de la presse et la sécurité nationale. Pour Zied Dabbar, du Syndicat, les « journalistes sont encore en phase d’apprentissage et doivent tirer des leçons de ces dérapages. »
Si la liberté d’expression reste un acquis, face au terrorisme, les journalistes sont confrontés à un impératif direct et une nécessité de rigueur qui reste encore fragile pour une partie de la profession victime aussi d’une crise globale du secteur qui réduit les moyens. La moyenne salariale d’un journaliste de presse écrite reste entre 600 et 800 dinars, les déplacements et les notes de frais sont souvent peu ou pas remboursés.
"Tant qu’on donnera pas les moyens matériels et financiers aux journalistes de mener de véritables enquêtes et d’éviter 'un journalisme assis', le secteur stagnera", conclut Sadok Hammami.
Reste aussi l’absence de mécanisme de sanction ou d’autorégulation pour la presse électronique et la presse écrite à la façon de la HAICA pour l’audiovisuel. Jeudi 17 juillet, beaucoup de journalistes ont évoqué ce problème qui n’est pas nouveau. « Aujourd’hui, si un journal se trompe ou donne une fausse information, il est rare qu’il publie un démenti et il n’y a jamais d’excuses réelles », selon Omar Mestiri.