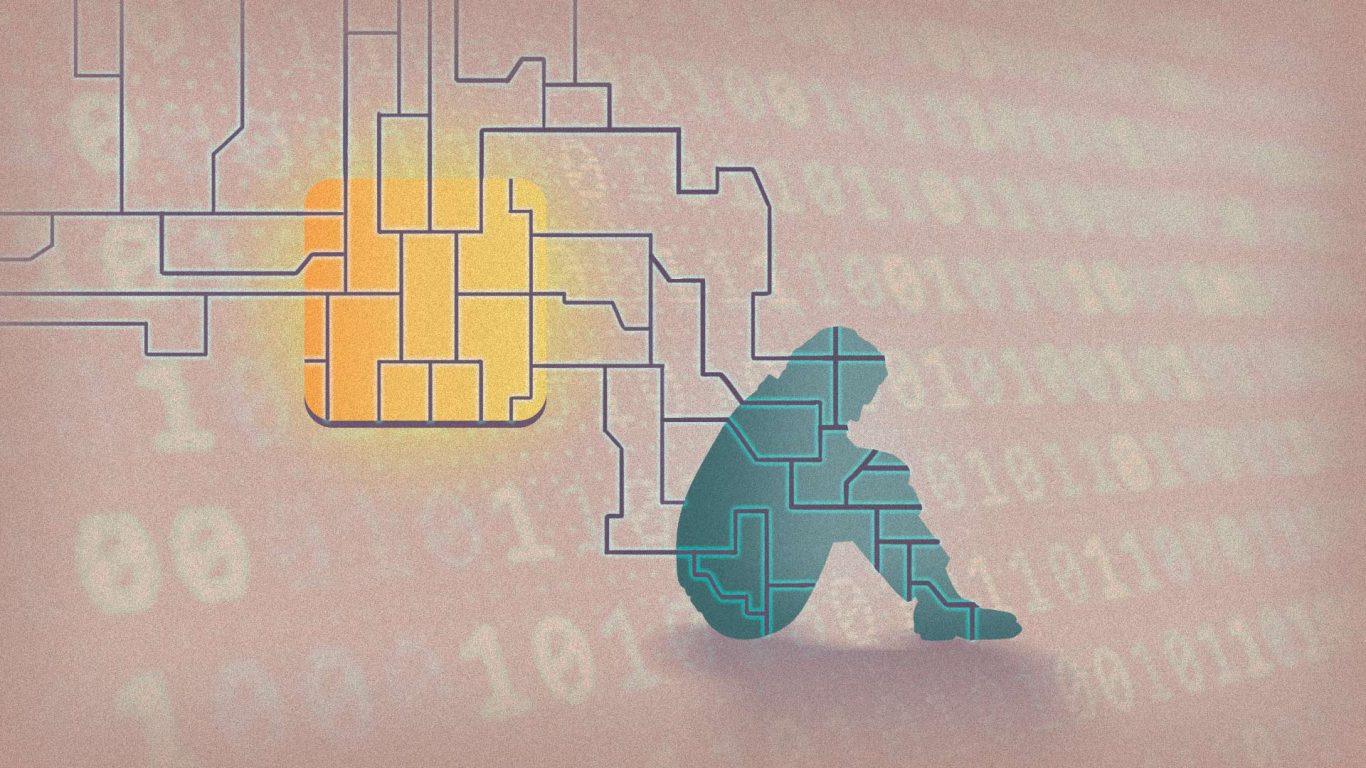Protection digitale et liberté d’expression
Piratage, escroquerie, harcèlement, fraude... La liste des menaces est longue, mais toutes relèvent d’une même réalité : celle de la cybercriminalité, qui continue de s’étendre et de se diversifier.
En Tunisie, quelque 2000 affaires relatives aux crimes électroniques ont été recensées, depuis début 2024. Seules 800 d'entre elles ont été traitées, d'après une déclaration du porte-parole de la direction générale de la Garde nationale (DGGN), accordée à la presse lors d’une journée d’étude organisée le 15 janvier 2025.
Le positionnement important des crimes électroniques à l'échelle internationale a fait que la DGGN a créé en 2017, la cinquième brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, chargée de combattre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, et dont l’activité est entrée en vigueur en 2019.
"Il est important, voire vital, d'avoir une brigade pareille pour appuyer les appareils de l'État, car il faut lutter contre les crimes cybernétiques qui se propagent de façon remarquable. Il relève donc du rôle du ministère de l'Intérieur d'y mettre fin", déclare Chérif El Kadhi, analyste de politiques technologiques à inkyfada.
"Cela découle certainement d'une prise de conscience des dangers que représente l’univers numérique, on ne peut le nier, mais il convient, également, de noter que la Tunisie a été invitée à devenir membre de la convention de Budapest sur la cybercriminalité".
Il s'agit en effet du premier traité international qui tente d'aborder les crimes informatiques et les crimes sur Internet, y compris la pornographie infantile, l'atteinte au droit d'auteur et le discours de haine, en harmonisant certaines lois nationales, en améliorant les techniques d'enquêtes et en augmentant la coopération entre les nations. Il rehausse, en plus, la protection des droits et libertés humains en enjoignant les signataires à l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il promeut une application des lois qui intègre le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, une régulation renforcée contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication est palpable au niveau de l’espace virtuel tunisien, soulevant ainsi la question d’une possible application sans entraver les droits numériques et la liberté d’expression.
En effet, le décret-loi n°2022-54 du 13 septembre 2022, promulgué par le président Kaïs Saïed, composé de 38 articles et visant à lutter contre les fausses informations dans l’espace numérique, incarne une réponse législative aux dérives et abus sur la toile. Il prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour quiconque utilise les réseaux d’information et de communication pour “rédiger, produire, diffuser ou répandre de fausses nouvelles (...) dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou de porter préjudice à la sécurité publique”.
Une telle mesure, en apparence destinée à protéger les individus et à préserver l’ordre public, suscite, toutefois, une controverse grandissante. Plusieurs arrestations et condamnations ont été prononcées sur la base de ce texte, souvent contre des journalistes, des avocat·es, des blogueur·euses ou des personnalités de la société civile.
Les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bessaies qui devaient être libérés, le 11 janvier 2025, après avoir purgé l’intégralité de leurs peines de prison, ont été maintenus en prison sans qu’ils aient été interrogés par le juge d’instruction, alors que l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani qui a écopé, le 24 octobre 2024 en première instance, de deux ans de prison, a été condamnée, en date du 24 janvier 2025, à un an et six mois en appel.
Aussi, soixante députés ont-ils renouvelé, le 22 janvier 2025, leur demande de soumettre la proposition de loi visant à amender ledit décret à la commission compétente, après que le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a refusé, à deux reprises, de le faire. Une première proposition avait été déposée le 20 février 2024, tandis qu’une pétition d’examen en urgence, signée par 57 députés, a été soumise, en mai 2024.
Ce décalage entre l’intention déclarée de protéger et la réalité de l’application de ce décret, jugé liberticide, soulève des interrogations fondamentales. Au moment même où les cas s’accumulent, la frontière entre la lutte contre la diffamation et la restriction de la liberté d’expression devient de plus en plus opaque, de sorte que lorsque la justice tranche, il est rare qu'elle ne provoque pas controverse, sinon polémique.
Sur le même sujet
Ce flou juridique permet une utilisation du décret 54, autant comme une réponse à une plainte légitime, que comme outil de répression contre des opinions divergentes du pouvoir, dans le vaste sens lexical.
D'après Chérif El Kadhi, l'objectif de ce décret est de lutter contre les crimes cybernétiques et “il relève du rôle de l'État de juguler ces dépassements et de les combattre avec des moyens légaux, sauf que la loi sur la cybercriminalité limite, comme dans nombre de pays arabes, la liberté d'expression".
L’analyste note que ceci est bien clair à travers l'article 24 dudit décret qui regroupe des infractions punissables et des sanctions pénalisant des actes qui manquent de précision en utilisant des termes très vagues. Il s’agit, selon lui, d’un article qui porte sur les crimes de publication et des dépassements liés à la liberté d’expression, loin de la lutte contre la cybercriminalité – l’essence même du décret 54.
“Cette loi, je le dis, ne répond malheureusement pas aux normes internationales des droits humains”, a-t-il réitéré.
Ainsi, alors qu'il est censé garantir la sécurité digitale, ce décret 54 semble, paradoxalement, menacer les droits numériques et la liberté d’expression et est d'ailleurs, en contradiction flagrante avec l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec les normes internationales telles que l’observation 34 de l’année 2011 sur l’article 19 du PIDCP, qui recommande aux États membres d’éviter au maximum les peines privatives de liberté pour de telles accusations.
Documents biométriques : innovation sécuritaire et respect des libertés
Sur un autre plan, les cartes d’identité et passeports biométriques, considérés comme des outils innovants et sécurisants, marquent une étape importante dans la modernisation des systèmes administratifs. L’introduction de ces documents, régis par la loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, parue au Journal Officiel dans son édition du mardi 12 mars 2024, est prévue pour le second semestre de 2025.
Cette mesure vise à se conformer aux directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour la sécurisation des déplacements internationaux et aux normes internationales ainsi qu’à s’aligner aux autres pays qui l’ont déjà adoptée.
Bien que prometteuse en termes de sécurité, l’adoption des documents biométriques comporte un risque majeur en cas de compromission de la base de données où sont stockées les informations personnelles des citoyen·nes. Une telle base contient des données sensibles, comme les empreintes digitales, les photographies et d’autres identifiants biométriques, qui, si elles venaient à être piratées ou détournées, pourraient être exploitées à des fins malveillantes, telles que l’usurpation d’identité ou le chantage.
Sur le même sujet
Dotés d’une puce électronique contenant des données personnelles, ces nouvelles pièces d’identité sont présentées comme un moyen efficace de lutter contre la fraude, l’usurpation d’identité et leur exploitation à des fins criminelles ou terroristes. Cependant, des questions subsistent : où seront stockées ces données sensibles ? Qui en aura l’accès ? Et surtout, comment garantir qu’elles ne soient pas utilisées à des fins abusives ?
Pour l'analyste de politiques technologiques, Chérif El Kadhi, la vraie et principale question à poser et qui résume la problématique majeure que soulèvent nombre d'expert·es est la suivante : "Pourquoi parle-t-on de collecte et de sauvegarde de données biométriques ?”
"Sur le plan pratique, il est possible et tout à fait faisable de stocker les données uniquement sur la puce et de procéder à l'identification des personnes en cas de besoin, sans créer une base de données biométriques", a-t-il expliqué, précisant que les arguments présentés par le ministère de l'Intérieur à ce sujet – selon lesquels l’objectif est d’éviter la falsification des documents – sont techniquement discutables, car il existe un risque de mettre en danger les données biométriques de tous les Tunisien·nes âgé·es de plus de 15 ans, en les centralisant en un seul endroit, ce qui pourrait mettre en péril la souveraineté nationale.
“Le risque zéro n'existe pas. Une base de données biométriques compromise, elle l'est à vie”, avertit l’analyste.
Mais au-delà des atteintes individuelles, ce type de faille pourrait représenter une menace grave pour la sécurité nationale et la souveraineté du pays. Une base compromise peut être utilisée pour infiltrer des systèmes critiques, manipuler des données officielles ou même mettre en danger les infrastructures numériques de l’État.
"À ma connaissance, le matériel utilisé n'est pas tunisien et ce sont généralement quelques grandes entreprises industrielles internationales qui fournissent des solutions dans ce domaine", explique El Kadhi. Il ajoute que ces entreprises peuvent être liées par des engagements légaux envers des États tiers auxquels elles devraient transférer des données sensibles, ou encore, dans certains cas, ne pas répondre à la législation tunisienne si cela ne constituait pas un risque au niveau de la sûreté nationale.
L’analyste recommande, en ce sens, de faire appel à des sociétés tunisiennes ou d’utiliser le strict nécessaire pour assurer le processus d’authentification, si les capacités techniques adéquates ne sont pas disponibles, même si certains pays exercent des pressions en ce qui concerne la biométrie.
Pour El Kadhi, la liaison établie entre la carte d’identité et le passeport est également problématique, car il s’agit de deux documents différents. L’exemple du Mobile ID (E-Hawiya)* est un exemple concret illustrant qu’il est possible d’identifier les personnes sans passer par la base de données biométriques.
Prolifération des caméras de surveillance : sécurité ou intrusion dans l’espace public ?
En Tunisie, la multiplication des caméras de surveillance dans l’espace public témoigne également de la volonté croissante de renforcer la sécurité face à de diverses menaces, allant de la criminalité urbaine à la prévention des actes terroristes.
Des caméras de surveillance ont en effet été récemment installées dans les établissements scolaires afin de garantir la protection des élèves et du corps enseignant face à la montée des violences.
Même scénario pour les stations de la Société des Transports de Tunis où des actes de vandalisme et de destruction des moyens de transport sont constamment enregistrés. Les caméras de surveillance sont par ailleurs utilisées pour assurer la sécurité routière en relevant les infractions, telles que la conduite en sens interdit, le non-respect de la priorité ou des feux et le changement de voie sans indication, entre autres.
Il en va de même pour les centres commerciaux et les boutiques, les banques et les distributeurs automatiques, les cafés et les restaurants, les aéroports et les administrations… C’est dans ces lieux que l’omniprésence de ces dispositifs soulève des inquiétudes quant à leur impact sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux.
“Suivre les déplacements des individus et traquer leurs mouvements touche à leur droit à la vie privée, qui est un droit fondamental garanti par la Constitution”, insiste l’analyste.
“Pour installer une caméra de surveillance dans l’espace public, une autorisation explicite est obligatoire, même si le cadre légal qui régit cette mesure devrait être révisé. Toutefois, des opérations de contrôle peuvent être effectuées, de manière illégale, soit sans autorisation judiciaire.”
Sur le même sujet
Les dispositifs de surveillance risquent de devenir des outils de contrôle social, limitant la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique. Ce constat prend une résonance particulière en Tunisie, où l’espace public a historiquement été un lieu d’expression démocratique depuis la révolution de 2011.
“Les bases théoriques et techniques du contrôle existent, tandis qu’un climat général de peur pour les acquis de la Révolution tels que le droit de manifester et le droit de s’exprimer s’installe, notamment à la lumière des restrictions précitées”, explique El Kadhi, soulignant qu’avec de tels pouvoirs, les dépassements, à l’échelle individuelle ou au niveau de la politique générale de l’État, peuvent avoir lieu.
Dans certains pays, la reconnaissance faciale peut même être utilisée pour surveiller de manière disproportionnée des minorités ethniques ou des opposant·es politiques, en privant les individus de leur droit à la protection contre la surveillance abusive qui renforcerait les biais discriminatoires.
"Ces systèmes sont une forme de surveillance de masse qui porte atteinte au droit à la vie privée et menace les droits à la liberté de réunion pacifique et d’expression", lit-on sur le site d'Amnesty International.
L’ONG a lancé en 2021 la campagne “Ban the Scan” , visant à interdire l’usage des systèmes de reconnaissance faciale, cette technologie de surveillance de masse amplifiant le risque de discrimination raciale lors des interventions policières et menaçant le droit de manifester.