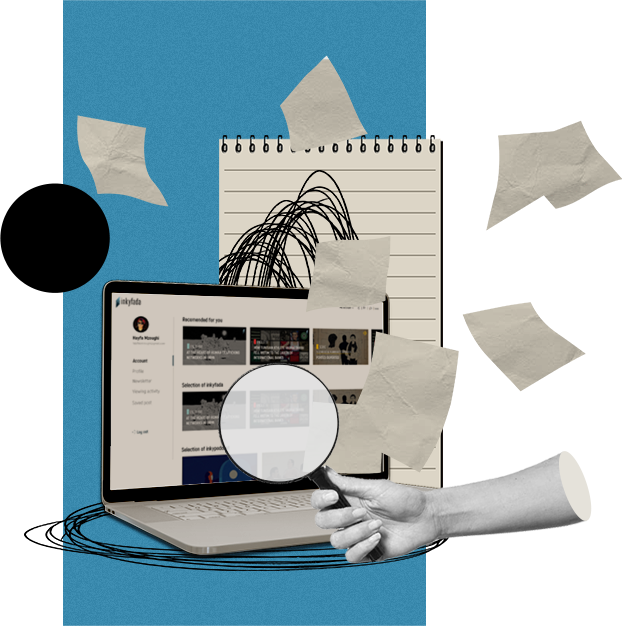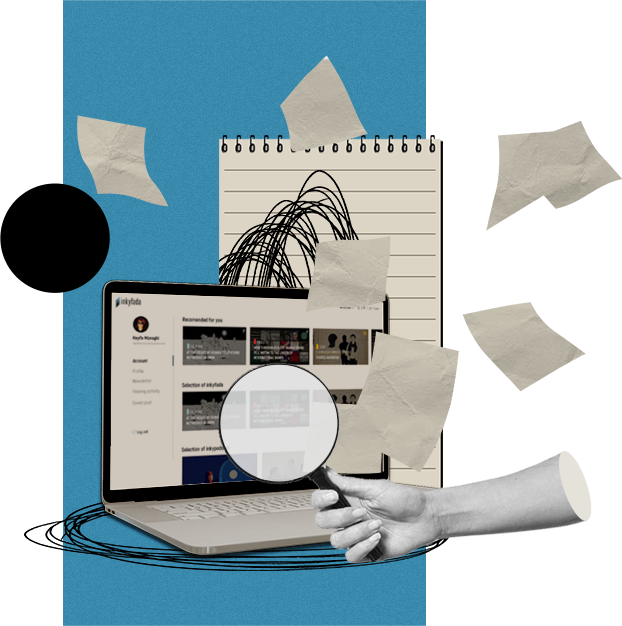Ce rassemblement s’inscrit dans une mobilisation plus large : une grève nationale lancée le 1er juillet, à l’appel de plusieurs structures syndicales. Quelques jours plus tôt, l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) annonçait un boycott du processus de sélection des centres de stage, suivi à 96,5 %. Cette action concerne également la répartition des stages en médecine de famille.
“Ce taux confirme la solidité du positionnement collectif des jeunes médecins”, affirme l’organisation. "Ces appels [de sélection de stages par le ministère] ont été ignorés en signe de protestation contre l’absence de dialogue sérieux”, ajoute Baha Eddine Rabei, vice-président de l’OTJM, dans un communiqué à l’agence TAP.
Une crise structurelle...
Au cœur des revendications :
- Révision des affectations, jugées arbitraires, sans concertation ni prise en compte des spécialités ou des conditions matérielles dans les structures d’accueil ;
- Revalorisation des indemnités de garde, plafonnées à 3 DNT/heure et, selon de nombreux témoignages, non versées dans ⅔ des hôpitaux ;
- Revenus mensuels très bas, autour de 750 dinars, sans protection sociale ;
- Évaluation transparente des stages, afin de limiter les décisions discrétionnaires ;
- Reconnaissance de droits sociaux (congé maternité, protection pendant le service civil, etc.).
Le 29 juin, lors d’une assemblée générale, des responsables administratifs auraient menacé les jeunes médecins de poursuites judiciaires s’ils poursuivaient leur mouvement.
Selon Alaa Tlili, médecin et membre de l’OTJM, ces responsables auraient par ailleurs évoqué le recours à des “médecins étrangers, chinois ou hongrois ”, pour remplacer les grévistes.
... documentée depuis des années
La colère actuelle s’inscrit dans une crise bien plus profonde. En 2022, lors d’un entretien à inkyfada, Aziz*, médecin résident, alertait déjà sur la situation :
“Avec le manque d’équipement et la pénurie de médicaments, nous nous retrouvons démunis face aux maladies et aux virus qui envahissent nos hôpitaux. Ces facteurs encouragent la migration et expliquent le manque de personnel médical et la détérioration de la santé publique en Tunisie.”
Plutôt encore, en 2018, Yasmine*, alors interne, décrivait l’abandon auquel sont confronté·es les jeunes médecins, souvent seul·es pour faire fonctionner des services entiers : “Pour ma première garde aux urgences, j’ai été lancée seule, sans aide. (...) Sans eux, les hôpitaux s’écrouleraient.”
Ce malaise est d’autant plus difficile à exprimer qu’il s’accompagne d’une crainte de représailles : “On doit absolument valider les stages à la fin de l’année, donc ils ont vraiment un moyen de pression.”
Sur le même sujet
Un exode massif et des chiffres alarmants
Les données officielles confirment une dynamique d’effondrement. La part du PIB allouée à la santé publique est passée de 6,4 % à 5,3 % entre 2010 et 2020, accentuant la dégradation des infrastructures et des conditions d’exercice.
Entre 2017 et 2021, environ 3100 médecins ont quitté la Tunisie. En 2024, ils étaient 1450 à faire leurs valises, selon Rym Ghachem Attia, présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins. Les destinations les plus fréquentes : France, Allemagne, Arabie saoudite, Qatar.
Alors que plus de 4500 médecins ont quitté la Tunisie en moins d’une décennie, les professionnel·les resté·es sur place multiplient les alertes. L’exode s’accélère, et avec, la contestation.
Sur le même sujet
Réactions officielles : entre fermeté et ambiguïté
Le ministère de la Santé justifie sa politique d’affectations par la nécessité d’assurer une couverture sanitaire équitable, notamment en zones intérieures. Une justification jugée insuffisante par les médecins mobilisé·es, faute de concertation, d’adaptation aux profils, et face aux menaces de sanctions.
Concernant la polémique sur les médecins étrangers, Mabrouk Aounallah, chef de cabinet au sein du ministère, a déclaré au micro de Mosaïque FM ce mercredi matin, que les propos relayés avaient été “sortis de leur contexte” et qu’ “il n’a jamais été question de remplacer les grévistes par des étrangers”.
Cette potentielle substitution, si elle se matérialisait, soulèverait des enjeux juridiques et logistiques majeurs, davantage qu’une simple mesure palliative.
Dans une vidéo diffusée lundi soir sur la page Facebook de la présidence de la République, Kaïs Saïed appelle à une réforme urgente du système de santé, tout en dénonçant “les dérives corporatistes” . Il plaide pour un nouveau cadre juridique, fondé sur “l’équité et la responsabilité”, sans répondre directement aux revendications portées par la grève.
Des perspectives floues, à l'image du passé
La grève de cinq jours, entamée le 1ᵉʳ juillet, marque un tournant. Les syndicats avertissent : sans avancées concrètes sur les revendications financières et sociales, la mobilisation s’intensifiera. L’Ordre des médecins et le Conseil national de l'Ordre des médecins proposent une table ronde multipartite (ministère, présidence, syndicats, étudiant·es) pour sortir de l’impasse.
Depuis plus d’une décennie, les jeunes médecins en Tunisie réclament la reconnaissance d’un statut juridique clair encadrant leur travail. En effet, aucun cadre officiel ne précise à qui incombe la responsabilité en cas d’erreurs de diagnostic ou de traitement, alors que ces jeunes praticien·nes sont censé·es exercer sous la supervision d’un médecin senior. Ce flou est aggravé par des conditions de travail éprouvantes et le manque de moyens dans les hôpitaux.
Ce statut, débattu depuis 2012, a reçu l’accord du ministère de la Santé en février 2017, mais reste toujours non publié. En 2018, une mobilisation massive relance les revendications, sans obtenir gain de cause. Sept ans et huit ministres plus tard, aucun projet de loi à ce sujet n’a été adopté.