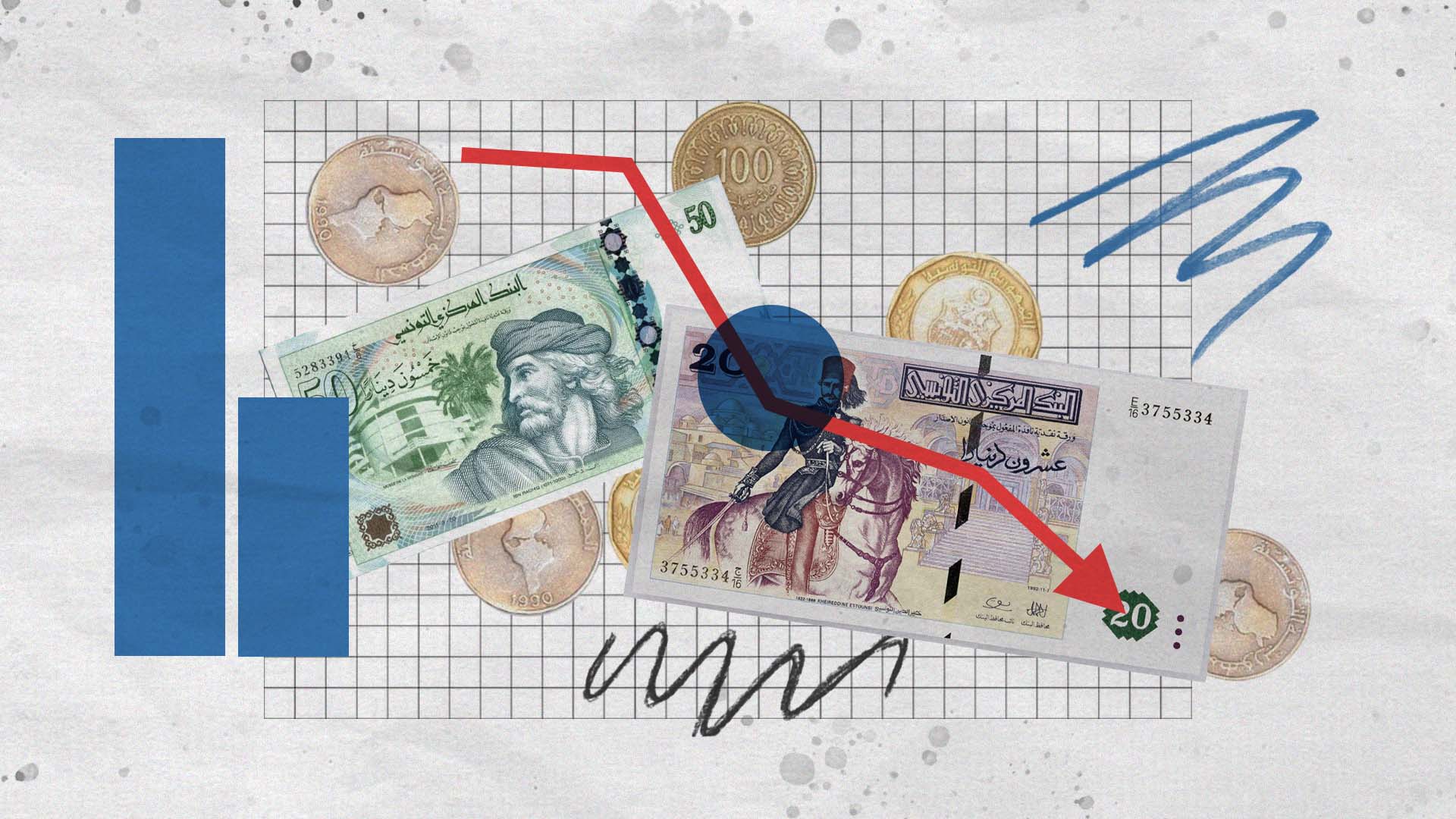Que dit réellement l’article 49 ?
L’article 49 stipule que les députés ne peuvent proposer de nouvelles dépenses qu’à condition d’identifier des ressources additionnelles ou des économies équivalentes. Ils peuvent également modifier la répartition des crédits entre programmes, à condition d’ajuster les objectifs et indicateurs correspondants.
Autrement dit, l’intervention parlementaire est autorisée tant qu’elle reste neutre sur “l’équilibre global” des dépenses et des ressources. Or, cet équilibre est déjà fragilisé dans le budget 2026, marqué par un déficit estimé à près de 11 milliards de dinars.
La ministre des Finances a ainsi considéré que de nombreux amendements ne respectaient pas la LOB pour deux raisons principales. D’une part, ils risquent de compromettre les équilibres budgétaires arrêtés par l’exécutif. Dans les faits, le volume global des dépenses est passé de 52 milliards de dinars dans le projet initial à près de 63 milliards dans la version finalement adoptée. D’autre part, plusieurs amendements ne respectaient ni la forme ni le fond requis pour une loi de finances, une responsabilité qui semble partagée entre les contraintes structurelles du modèle parlementaire actuel et le déficit d’appui technique.
Un cadre budgétaire saturé
Au-delà des amendements problématiques, le rejet massif et quasi non négociable des propositions parlementaires révèle une contrainte plus profonde : un cadre budgétaire déjà saturé, incapable d’absorber la moindre inflexion sans mettre en péril son équilibre formel. Dans ces conditions, toute tentative d’ajustement se heurte à une marge de manœuvre pratiquement inexistante.
Pour Ayoub Menzli, expert en économie politique et doctorant à l’université Roma Tre, comprendre cette situation suppose de déplacer le regard vers la dynamique interne du budget, ses rigidités et les logiques économiques qui produisent, année après année, un déficit présenté comme inévitable.
Après une amélioration relative entre 2023 (–11 665 MDT) et 2025 (–10 150 MDT), le déficit budgétaire repart à la hausse en 2026 pour atteindre environ 11 000 MDT. Cette rechute marque l’arrêt net de la trajectoire de consolidation budgétaire. Elle s’explique par la combinaison de pressions sociales croissantes, notamment liées aux salaires et aux subventions, et par l’incapacité à accroître durablement les recettes dans un système fiscal largement concentré sur les ménages, tandis que la contribution des entreprises demeure limitée.
Le rapport annuel de la Cour des comptes (2023) confirme cette lecture. Entre 2019 et 2023, la croissance de la dépense publique, plus rapide que la croissance potentielle, a dégradé le déficit structurel de 1,4 point de PIB. certaines réformes fiscales ont contribué à l’aggraver de près d’un point supplémentaire.
Des dépenses étouffantes
Côté dépenses, l’espace de décision politique apparaît extrêmement contraint. En 2026, les dépenses totales atteignent 63,6 milliards de dinars, dont les intérêts de la dette représentent 17,3 %. Dans un budget où déjà les charges nécessaires au fonctionnement constituent 47%, près de 60 % du budget se trouve ainsi prédéterminé avant toute intervention parlementaire.
L’investissement public, dont la croissance est présentée comme le résultat direct attendu des exonérations fiscales des sociétés, est relégué à 2,5 % du budget.
Dans ce contexte, le déficit budgétaire, équivalant à environ 21 % des recettes, devient structurel. Il est entièrement absorbé par le service de la dette. L’endettement ne finance plus le développement, mais le déficit lui-même, enfermant les finances publiques dans un cercle vicieux : charge de la dette élevée, réduction de l’investissement, faible croissance, difficulté persistante à réduire le déficit.
Selon Menzli, cette impasse s’explique également par les fondements macroéconomiques de l’économie tunisienne. Même dans un scénario de hausse des exportations, les importations — pétrole, gaz, céréales, médicaments — resteraient supérieures aux exportations. Ces importations sont largement inélastiques, tandis que les exportations demeurent dominées par des produits à faible valeur ajoutée et dépendants de chaînes de valeur étrangères. Cette asymétrie alimente un déficit commercial chronique et exerce une pression continue sur le dinar.
Le Parlement comme « pare-chocs »
Dans ce cadre, le ministère des Finances a rappelé que tout amendement devait respecter les articles 66 et 69 de la Constitution ainsi que l’article 49 de la LOB, au nom de la soutenabilité budgétaire.
Selon l’expert Ayoub Menzli, la loi de finances est conçue comme un exercice de survie annuel : “comment mobiliser des ressources afin de couvrir nos dépenses pour l'année en cours ? Les considérations plus long terme n'ont pas de place. » Il n’existe encore ni projet structurant ni leviers économiques cohérents. Le Parlement joue alors un rôle essentiellement symbolique, fonctionnant comme un « pare-chocs » qui absorbe la colère sociale, tandis que les choix budgétaires réels traduisent une dépendance économique profonde.
Cette impasse est particulièrement visible dans la gestion des régimes sociaux. La loi de finances 2026 apparaît déjà dépassée face à l’insoutenabilité structurelle de la CNSS, de la CNRPS et du CNAM.
Le rapport de la Cour des comptes (2023) alerte sur un déficit chronique de la CNSS depuis 2010, atteignant 1,4 milliard de dinars en 2022, avec un taux de recouvrement inférieur à 70 %. Sans réforme structurelle, le régime risque l’insolvabilité.
Trois logiques d’amendements
Selon le député Malik Kammoun, les amendements déposés relèvent de trois logiques,
La première est d’ordre social : allègements fiscaux pour les petits agriculteurs, mesures en faveur des personnes en situation de handicap, soutien au secteur audiovisuel ou facilitation de l’emploi des diplômés. Ces propositions répondent à des demandes sociales réelles et largement consensuelles.
La deuxième logique est sectorielle. Elle concerne des amendements défendus par des intérêts économiques spécifiques, comme la réduction de la TVA sur les panneaux photovoltaïques ou la baisse des droits de douane sur certains intrants. Si certaines mesures peuvent se justifier économiquement, leur impact cumulé aurait entraîné une érosion significative des recettes, difficilement soutenable dans un budget déjà déficitaire.
« La question n’est pas l’intention, mais d’où viennent les fonds »
La troisième logique est davantage symbolique. Plusieurs amendements ont été déposés sans étude d’impact ni cohérence d’ensemble, principalement pour marquer une présence politique. Dans un contexte où la loi de finances est devenue le principal espace d’expression législative, ces propositions ont contribué à saturer le débat et à renforcer la position du gouvernement.
Certaines mesures adoptées montrent les limites conceptuelles des amendements, par exemple sur la question de l’emploi. Malik Kammoun explique qu’il ne croit plus aux annonces de recrutements répétées d’année en année : « Dès que je vois un article qui parle d’emplois ou de recrutements, j’arrête de lire ». Selon lui, ces promesses ne sont presque jamais accompagnées de financements réels et reviennent depuis la révolution, alors même que la situation des finances publiques ne cesse de se détériorer.
L'expert Ayoub Menzli partage ce constat et estime que les politiques actuelles de l’emploi sont inefficaces. Pour lui, encourager ponctuellement les entreprises à embaucher ne suffit pas si l’État ne met pas en place une vraie politique industrielle et une stratégie durable pour l’emploi. Il prend l’exemple des avantages fiscaux accordés aux entreprises, qui coûtent plus de 2 milliards de dinars par an, sans preuve claire qu’ils créent réellement des emplois ou attirent plus d’investissements. « C’est de l’argent jeté par les fenêtres », résume-t-il.
Aujourd’hui, l’impôt sur les sociétés ne génère que 6,91 milliards de dinars, soit 14,47 % des recettes fiscales, contre 22,69 milliards issus de l’IRPP, qui représentent à eux seuls 28.54% des recettes fiscales et 25.94% des ressources budgétaires. Ce déséquilibre est le résultat de choix politiques, Comme la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) en 2014 de 30% à 25% et son harmonisation ultérieure en 2021, par la suppression des taux différenciés de 25 %, 20 % et 13 % au profit d’un taux unifié autour de 15 %, ainsi que l’abaissement du taux minimal d’imposition de 15 % à 10 % pour les sociétés bénéficiant d’exonérations partielles ou totales, au détriment de la mobilisation durable des recettes publiques.
D’autres montrent des limites surtout techniques, comme la taxe sur la fortune, fixée à 0,5 % dès 3 millions de dinars et 1 % au-delà de 5 millions, pourrait rapporter plusieurs centaines de millions de dinars dans un pays où 1 % des plus aisés détiennent 22,4% du revenu national avant impôt d'après world inequality database et les 50% des plus pauvres détiennent 12,4 du revenu national avant impôt. Théoriquement redistributive, elle risque toutefois de rester limitée faute de moyens : l’administration fiscale ne compte qu’environ 450 agents, sans registre patrimonial ni accès aux actifs financiers, alors que près des deux tiers des patrimoines ne seraient pas déclarés.
Comme le souligne l’expert, si la progressivité de l’impôt fonctionne pour les hauts revenus, elle se brise chez les ultra-riches, qui recourent à des moyens d’optimisation fiscale, par exemple, la faible taxation des dividendes par rapport aux salaires accentue cette injustice et réduit l’efficacité du système fiscal.
Bras de fer politique
Par définition, la loi de finances ne peut contenir que des dispositions liées directement à l’équilibre budgétaire et à l’exécution des finances publiques. Dans ce cadre, le député estime que plusieurs propositions étaient juridiquement irrecevables et affirme même que, si une Cour constitutionnelle existait, la totalité de la loi de finances aurait pu être invalidée.
Cela s'explique en grande partie par l’affaiblissement des capacités du Parlement. L’Académie parlementaire, censée assurer la formation et l’appui technique des députés, est quasi paralysée depuis 2023. Les députés travaillent avec très peu d’assistants, limités à des tâches formelles, et n’ont bénéficié que d’une formation d’une demi-journée en près de deux ans. Cette fragilité réduit leur capacité d’analyse face à un exécutif qui détient l’essentiel de l’information budgétaire.
À cela s’ajoutent de graves problèmes de coordination institutionnelle, notamment entre les deux chambres, où des articles pourtant déjà rejetés réapparaissent, comme s’ils n’avaient jamais été débattus. Selon Malik Kammoun, il s'agit d’une mauvaise conception politique du rôle des institutions, dans un cadre institutionnel déjà fragilisé.
Le déséquilibre est aggravé par l’opacité de l’exécutif. Le gouvernement ne fournit ni données détaillées sur l’exécution des budgets précédents, ni bilans des dernières lois de finances, se contentant de présentations générales déjà accessibles au public. “Il n’y a pas de données précises sur l’application des lois budgétaires des trois années précédentes”.
En parallèle, il refuse le dialogue parlementaire, ne répond que vaguement aux questions écrites et se soustrait aux débats, y compris lors de crises nationales. « Même dans les crises nationales, la crise de Gabès, la crise de Mazouna, nous leur demandons de venir dialoguer et ils refusent la discussion. On n’a pas de mécanisme pour retirer la confiance ou interroger le gouvernement pour l’obliger à venir. »
Cette absence de coopération explique l’inflation d’articles additionnels dans la loi de finances, devenue de facto le seul espace d’intervention des députés. Alors que des dizaines de propositions de loi à forte portée sociale ont été déposées, notamment 40 en 2024 et 79 en 2025, seules deux ont été adoptées, en revanche, les projets de loi de caractères techniques, administratifs ou répressifs trouvent plus aisément leur chemin vers l’adoption.
Dans ce contexte, l’adoption de nombreux amendements relève moins d’une évaluation de leur impact que d’un bras de fer politique. Selon Malik, près de la moitié des articles additionnels auraient été votés par dépit, dans le but de mettre la ministre des Finances en difficulté, illustrant une défiance institutionnelle profonde et l’incapacité du Parlement à s’imposer comme un véritable espace de délibération et de contrôle.
Des amendements nominales
En pratique, l’exécutif garde la main. Les amendements votés par le Parlement restent largement lettre morte. En cas de contestation, le gouvernement argumente que les députés avaient été prévenus que ces mesures ne relevaient pas de la loi de finances ou qu’elles dépendaient de décrets relevant exclusivement de l’exécutif.
Ce blocage est désormais structurel. Selon le député du bloc voix de la république, aucun amendement parlementaire adopté au cours des deux dernières années n’a été appliqué. L’absence de textes d’exécution sert de justification systématique, sans que le Parlement ne dispose du moindre levier pour imposer leur mise en œuvre.