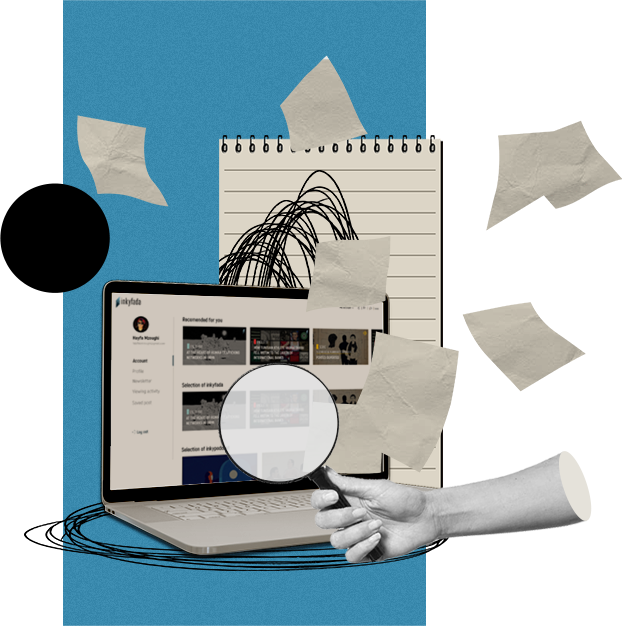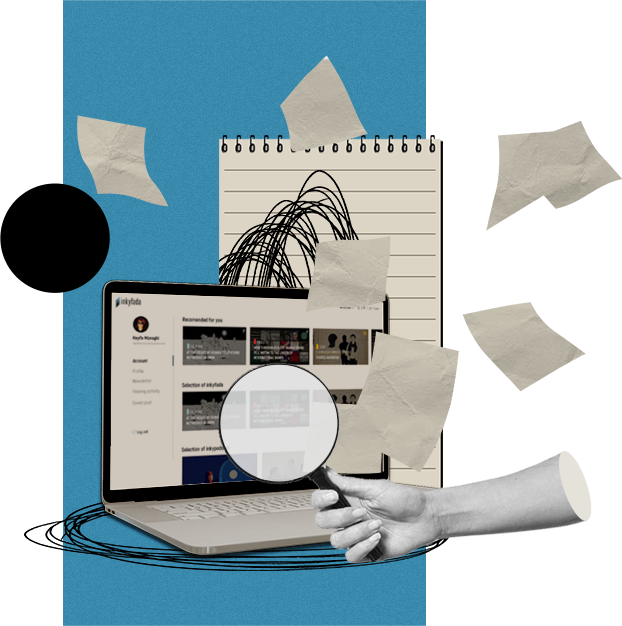Que s’est-il passé ?
Le 11 avril 2025, dix député·es issu·es de différents blocs parlementaires, notamment de la coalition “El Châab Yantasser” [ ndlr: Que le peuple triomphe] et du Bloc national indépendant, ont déposé une proposition de loi fondamentale visant à organiser la Cour constitutionnelle.
Malgré leur insistance sur “l’importance de cette Cour pour renforcer la confiance dans la loi et sa composition”, leur initiative n’a pas fait consensus. La controverse, notamment autour des articles relatifs à la révocation du président de la République, a poussé cinq signataires à se rétracter, provoquant l’abandon du texte.
Pourquoi est-ce important ?
Trois ans après l’adoption de la Constitution de 2022, la Cour constitutionnelle n’a donc toujours pas vu le jour, soulevant des interrogations sur le respect des engagements constitutionnels, l’équilibre des pouvoirs et la capacité d’instaurer un véritable contrôle de constitutionnalité dans un système présidentiel renforcé.
“La Cour constitutionnelle n’est ni un instrument de lutte politique, ni un bras de fer avec le pouvoir”, affirme Malek Kamoun, rapporteur de la commission législative générale. “Elle est une nécessité”, insiste-t-il.
Sur le même sujet
Les articles sur la destitution du président au cœur de la polémique
Le projet incluait les articles 65 à 68, qui prévoyaient la possibilité de destituer le président de la République en cas de violation grave de la Constitution. Ces dispositions ont déclenché des réactions vives :
- Le Conseil supérieur des collectivités locales a annoncé son intention de soutenir le président.
- Yasser Gourari, président de la commission législative générale, a rejeté le projet, le quailifiant d'" interprétation erronée et hors Constitution".
- Malek Kamoun a estimé que le texte, bien que globalement conforme à la Constitution, dépassait les limites fixées par le droit constitutionnel.
En réaction
- “C’est une demande populaire et parlementaire : la Cour constitutionnelle doit être mise en place, comme l’exige la Constitution de 2022”, défend le député Ali Zaghdoud, l’un des signataires.
- "La Cour n'est ni un crime, ni une hérésie. Mais je ne sais pas pourquoi certains députés ont retiré leurs signatures", s'interroge la députée Manel Bdida.
- "Dans toute démocratie, la Cour constitutionnelle est une pierre angulaire," insiste Malek Kamoun. Mais il admet qu' "aujourd'hui, elle n'est pas une priorité politique au Parlement."
- "La Cour est essentielle, mais elle n'est pas perçue comme prioritaire dans la dynamique actuelle du Parlement", résume Wahid Ferchichi, doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Carthage, dans une déclaration à inkyfada.
Un long processus bloqué depuis 2014
- Janvier 2014 : la Constitution impose la mise en place de la Cour, un an après les élections législatives.
- Décembre 2015 : une loi fixe sa composition et son fonctionnement.
- Mars 2017 à juillet 2020 : quatre appels à candidatures ont été lancés sans qu'aucun membre de la Cour ne soit élu·e.
- Avril 2021 : le président Kaïs Saïed refuse de ratifier une loi modifiant les seuils d'élection des membres, invoquant des délais dépassés.
- Juillet 2021 : Kaïs Saïed active l'article 80 de la Constitution, instaurant l'état d'exception.
- Juillet 2022 : adoption d'une nouvelle Constitution par référendum.
- Avril 2025 : une nouvelle proposition de loi relative à la Cour est rapidement retirée du Parlement.
Entre les lignes
- Pour Malek Kamoun, la dynamique actuelle du Parlement est “déséquilibrée”, marquée par “une prédominance de l’action législative et de contrôle”. Certains député·es considèrent que la Cour constitutionnelle “n’est pas une priorité immédiate”.
- Depuis un an et demi, le Parlement n’a adopté aucune loi majeure, se contentant de ratifier des accords de prêts. “ Un Parlement de crédits”, ironisent certains observateur·ices.
- “Le Parlement actuel fonctionne comme s’il était sans identité, sans présidence claire”, critique le député Mohamed Ali.
- “L’idée de la Cour constitutionnelle reste suspendue, en attendant une initiative législative de la part du président de la République lui-même”, conclut Malek Kamoun.
Quelle est la prochaine étape ?
À moins que le président de la République ne présente un projet de loi ou que les postes vacants nécessaires ne soient pourvus (comme celui de Premier Président de la Cour de cassation), la création de la Cour reste reportée sine die et il n’existe donc aucun organe officiel pour imposer un contrôle sur la constitutionnalité des décrets et des lois.