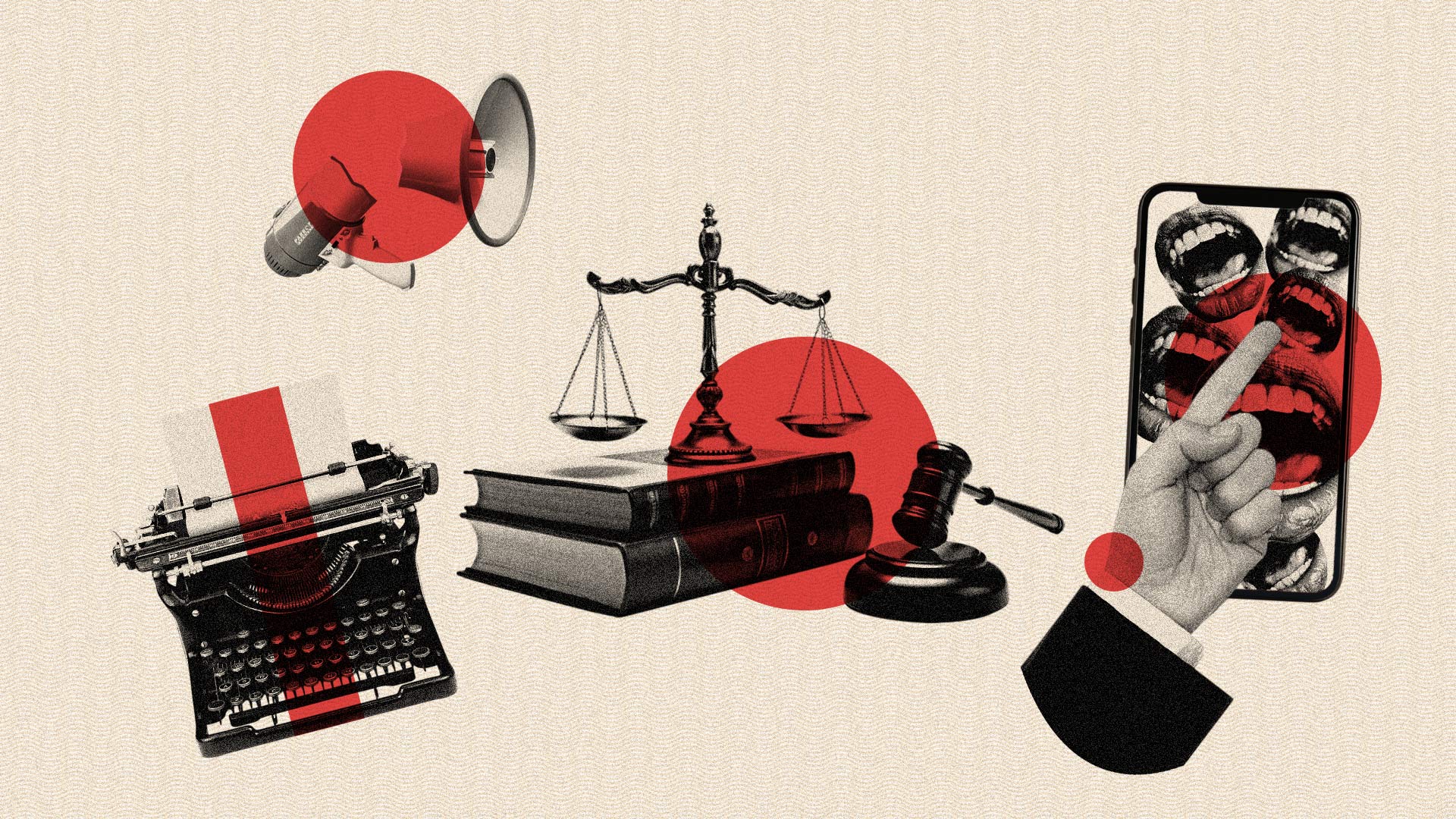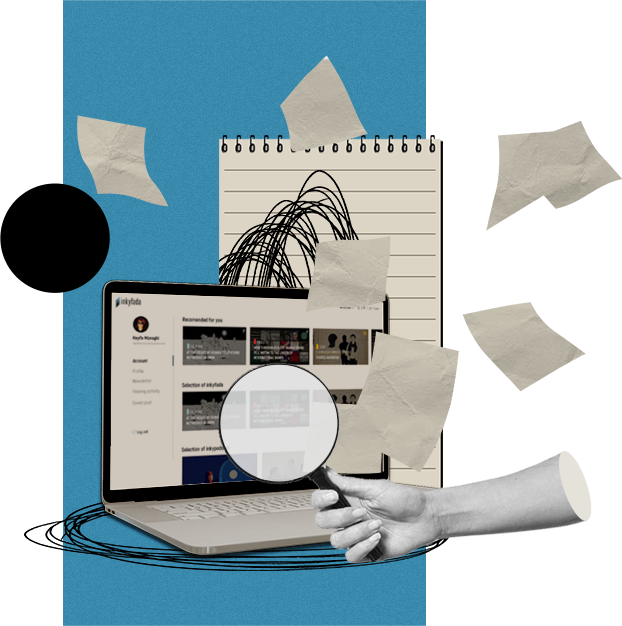L’essentiel :
• 24 cas judiciaires ont été engagés en vertu du décret 54 contre des journalistes et professionnel·les des médias en Tunisie, dont
21 poursuites initiées par des institutions officielles, parmi lesquelles sept émanent directement du ministère public. À cela s’ajoutent au moins
cinq condamnations à des peines de prison.
• Bien que présenté comme un cadre juridique pour lutter contre la cybercriminalité,
le décret 54 a été utilisé pour poursuivre des journalistes, des opposant·es et des citoyen·nes, en se concentrant principalement sur l'article 24, qui prévoit de
sévères peines de prison allant jusqu'à dix ans pour des accusations vagues comme
"la propagation de fausses rumeurs" et
"l'incitation au discours de haine".
• Le décret fait face à de vives critiques pour son
incompatibilité avec la Constitution et les conventions internationales. Pourtant, la justice tunisienne continue de l'appliquer,
en l'absence de possibilité de contester la constitutionnalité des décrets présidentiels.
• Les efforts pour modifier le décret 54 se heurtent à des
obstacles politiques, la présidence du Parlement ayant rejeté des initiatives législatives proposées par des dizaines de députés à deux reprises, et récemment une troisième fois. Une situation qui pousse les journalistes et les organisations civiles
à intensifier leurs efforts pour exiger que le décret 54 soit transformé en une loi fondamentale protégeant la liberté d'expression et de publication.
• Dans le contexte actuel, les conséquences du décret 54 dépassent largement le cadre des journalistes et s’étendent à l’ensemble des citoyen·nes.
Une simple opinion exprimée en ligne peut désormais exposer quiconque à des poursuites judiciaires , comme en témoignent les nombreux cas déjà recensés.
Les trois journalistes et professionnel·les des médias mentionnés dans le communiqué incluent Chada Haj Mbarek, en détention provisoire depuis juillet 2023 et jugée devant la deuxième chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis. Sa demande de libération a été rejetée lors d’une audience tenue le 14 décembre 2024.
Le journaliste et activiste Ghassen Ben Khelifa est également poursuivi pour des contenus publiés sur un réseau social, des contenus qui, selon le communiqué, “n’ont aucun rapport avec lui”.
Enfin, Sonia Dahmani, dont l’équipe de défense a fait appel de la peine de deux ans de prison prononcée contre elle le 24 octobre 2024, est la troisième concernée par cette affaire. Sa condamnation fait suite à des déclarations médiatiques qu’elle a faites, ainsi qu’à son renvoi en justice sur la base de l’article 24 du décret-loi 54.
Selon Khouloud Cheikh, coordinatrice de l’unité de surveillance au sein du Centre pour la sécurité professionnelle du SNJT, le nombre de cas renvoyés à la justice en vertu du décret 54 concernant les journalistes et les professionnel·les des médias a atteint 24, dont 21 ont été initiés par des entités officielles et sept par le ministère Public.
Sur le même sujet
Dans un entretien accordé à inkyfada, le secrétaire général du SNJT, Zied Dabbar, déclare que "le pouvoir judiciaire va directement à des sanctions punitives. Les journalistes sont jugés selon le Code des communications, le Code pénal, la loi anti-terrorisme, ou le décret 54, qui est devenu l'outil principal des tribunaux dans les affaires de publication."
Dans cet article, inkyfada examine les effets du décret 54 depuis son adoption, visant des journalistes qui, selon le syndicat, “ont simplement exercé leur droit constitutionnel à l’information et à l’expression” et revient sur les tentatives de la société civile et de certain·es parlementaires pour réformer ou abroger le décret.
Le décret 54 et “la politique du bâillon”
Depuis que le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré l'état d'exception le 25 juillet 2021, une série de décrets présidentiels ont été publiés, dont le décret-loi 54 de 2022 relatif à la lutte contre les crimes liés aux systèmes d'information et de communication. Un décret qui vise à "réglementer les dispositions visant à prévenir et à réprimer les crimes liés aux systèmes d'information et de communication".
Mohamed Yassine Jelassi, président honoraire du SNJT et membre du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes, déclare à inkyfada que "le syndicat a été la première entité à s'opposer au décret 54”. Il est qualifié à l'époque par la vice-présidente du syndicat, Amira Mohamed, de "scandale et nouveau chapitre de la restriction de la liberté d'expression, l'un des principaux acquis de la révolution", lors d'une intervention sur Radio Jawhara FM en septembre 2022.
Jelassi poursuit en disant que le syndicat "a exprimé son opinion sous la forme d'une lecture complète qui a prouvé que ce décret est contraire à la Constitution et aux lois sur la liberté de la presse, car il s'inscrit dans une politique de musellement des individus et de restriction des marges de liberté, d'autant plus que les décrets présidentiels ne peuvent pas être contestés."
Sur le même sujet
Pour Jelassi, l'une des "catastrophes accompagnant le processus du 25 juillet est la protection des décrets présidentiels contre toute contestation, ce qui a causé d'importants problèmes pour les organisations et les partis en l'absence de la Cour constitutionnelle."
Loin de lutter contre la cybercriminalité, son objectif supposé, le décret 54 a été utilisé depuis son adoption, selon Human Rights Watch et d'autres organisations non gouvernementales, pour arrêter, inculper ou interroger des journalistes, des avocat·es, des étudiant·es et d'autres dissident·es, en raison de leurs déclarations publiques sur Internet ou dans les médias.
Dans la plupart des cas, l’adoption du décret s’est limitée à l’application de l’article 24, que les militant·es et les organisations de défense des droits humains considèrent comme dangereux en raison du “caractère flexible” de sa formulation, de son conflit avec les principes de la Constitution et les accords internationaux pertinents, en plus de son conflit avec le décret 115 réglementant la profession de journaliste.
L'article 24 “contraire à la Constitution et aux conventions internationales”
L' article 24 du décret 54 dispose que "quiconque utilise intentionnellement un système de communication pour propager des nouvelles, des informations ou des fausses rumeurs" dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui, de nuire à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou de semer la terreur parmi la population, est passible d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 50 000 dinars.
Aymen Zaghdoudi, professeur de droit public, explique que cet article "contient des termes vagues et n'est pas clair dans les expressions utilisées, comme l'incitation au discours de haine". Il ajoute que cet article "criminalise non seulement la publication de contenu, mais aussi l'envoi, la production et la préparation de ce contenu, des actes qui ne sont pas clairement définis".
En outre, l'article 24 est contraire à la Constitution tunisienne, en particulier à son article 55, qui impose à l'État, lorsqu'il adopte un texte limitant les libertés, d'être clair et précis. Parmi les principaux problèmes posés par cet article, il y a aussi le fait qu'il "prévoit des peines disproportionnées pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison".
"Prononcer des peines de prison pour un travail journalistique ou l'expression d'une opinion représente un grand danger. Avec le décret 54, tout travail journalistique devient susceptible de poursuites judiciaires et d'emprisonnement”, dénonce Zied Dabbar.
En 1968, la Tunisie a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'a ratifié un an plus tard. Zaghdoudi déclare : "Le Pacte dispose dans son article 19 que l'État doit garantir la liberté d'expression, et lorsqu'il impose des restrictions, le texte doit être clair, précis et respecter les conditions de légalité, de nécessité et de proportionnalité, qui n'ont pas été respectées dans l'article 24 du décret 54."
Zaghdoudi ajoute que "l'article 24 du décret 54 est contraire à la Convention de Budapest, que la Tunisie a ratifiée, car les crimes prévus dans cet article, comme la diffamation et l'insulte, ne figurent pas dans la Convention."
La Tunisie a officiellement adhéré à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité en mars 2024, connue sous le nom de Convention de Budapest, devenant ainsi le 70ᵉ membre. Un communiqué du ministère des Technologies de la Communication de l'époque indiquait que l'adhésion de la Tunisie s'inscrivait dans le cadre de "la coordination étroite entre les différents ministères [...] pour protéger l'espace cybernétique national et les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication contre les attaques cybernétiques."
Cependant, l'article 24 du décret 54 ne se limite pas au domaine cybernétique, mais s'applique également à l'espace public. "Dès qu'une personne écrit un article dans un journal papier ou participe à une manifestation dans la rue et diffuse ou publie ces manifestations sur les réseaux sociaux, elle peut être poursuivie en vertu du décret 54, même si elle n'a pas utilisé les réseaux de communication publics, mais était simplement présente dans l'espace public”, explique Aymen Zaghdoudi.
“C'est ce qui s'est produit dans de nombreux cas où des personnes ont été poursuivies en vertu du décret 54 pour leur participation à ces manifestations." Le professeur rappelle ainsi ce qui est arrivé au doyen des vétérinaires tunisiens lorsqu'il a donné une interview publiée dans un journal papier et s'est retrouvé poursuivi en justice en vertu du décret 54.
D'autres articles du décret 54 posent également des problèmes majeurs. Les articles 8, 9 et 10 permettent aux officiers de police judiciaire d' "accéder directement à tout système ou support d'information et d'y effectuer des investigations techniques afin d'obtenir les données stockées", de les saisir, ou même de "collecter ou enregistrer immédiatement les données de trafic des communications dans le but de "révéler la vérité"”, selon le texte du décret.
Zied Dabbar voit dans ces articles "une menace pour le droit des citoyens à l'expression, à la liberté de la presse et à la publication". Il ajoute que "l'État tunisien, bien qu'il doive avoir une loi spécifique sur les crimes cybernétiques, doit réviser le décret 54 et appliquer le décret 115. Aujourd'hui, le paradoxe est que la classe politique utilise deux poids deux mesures dans l'application de ce décret."
Aymen Zaghdoudi soutient que l'application de l'article 24 a conduit à "la mort déclarée du décret 115", qui n'est plus appliqué aux journalistes et aux non-journalistes, car toutes les poursuites sont désormais engagées en vertu du décret 54.
Le rôle du Parlement dans le blocage des réformes
En réponse à ces mesures, le SNJT a lancé des campagnes de lutte nationale et internationale en partenariat avec des organisations telles que l'Ordre des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la Fédération africaine des journalistes et la Fédération internationale des journalistes, dans le cadre de la lutte contre l'emprisonnement des journalistes et pour la modification du décret 54.
Le secrétaire général du syndicat des journalistes, Zied Dabbar, confirme que le travail du syndicat a également impliqué un certain nombre de député·es, "sur la base d'intérêts communs et loin des calculs politiques", en présentant des initiatives pour réviser ce décret. Dabbar explique que "le syndicat a choisi d'agir de manière proactive plutôt que réactive."
“La demande n'est pas d'abroger le décret 54, mais de le réviser pour qu'il soit conforme à la Constitution et au décret 115 sur la liberté de la presse et de la publication, en demandant la modification des articles 9, 10, 24 et 25 du décret."
Dans une première tentative, le 20 février 2024, cinq député·es indépendant·es et non affilié·es ont présenté une initiative législative pour réviser le décret 54, soutenue à l'époque par 40 député·es, mais elle n'a pas été renvoyée à la Commission des droits et libertés par décision de la présidence du Parlement. En mai de la même année, une demande d'urgence a été déposée pour examiner la même initiative, signée par 57 député·es, mais elle a été reportée à "après les élections présidentielles", selon une déclaration du député Badreddine Gammoudi. Ce retard, selon Dabbar, a créé un problème au niveau de la pratique journalistique, qui est “devenue difficile en raison de l'inadéquation des législations".
Le règlement intérieur du Parlement permet à au moins dix député·es de présenter une initiative législative par l'intermédiaire de l'une des commissions : soit la Commission des droits et libertés, soit la Commission de la législation générale. Cependant, le président de l'Assemblée a eu recours à un vote au sein du bureau du Parlement pour rejeter le renvoi de cette initiative, selon le secrétaire général du SNJT, qui ajoute que le président du Parlement "en refusant de renvoyer l'initiative législative à l'une des commissions, s'est impliqué dans le non-respect de la loi, du règlement intérieur du Parlement qu'il a lui-même établi, et de la Constitution de la République tunisienne."
"Nous confirmons l'implication du président du Parlement, Ibrahim Bouderbala, et sa complicité dans l'emprisonnement des journalistes, car il est un obstacle majeur au projet de révision du décret 54."
En décembre 2024, le syndicat des journalistes a organisé une table ronde sur le décret 54, dans le cadre de la "relance de l'initiative de projet de révision". La table ronde a réuni l'Ordre des avocats, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, avec la participation de député·es, d'expert·es en droit, de journalistes et de représentant·es d'organisations de la société civile. La réunion, selon le communiqué publié sur le site du syndicat, a abouti à un "consensus pour tenir la présidence du Parlement responsable de la création de tous les obstacles illégaux empêchant le renvoi de la proposition de modification du décret à la commission compétente et de la confiscation du devoir du Parlement de protéger les droits et libertés."
Le secrétaire général du SNJT déclare : “D'autres réunions avec les députés suivront, et nous intensifierons notre action contre le président du Parlement en organisant des sit-in pour exiger qu'il respecte la Constitution et le règlement intérieur du Parlement. [...] Nous demandons également aux députés d'assumer leur responsabilité historique, car le décret 54 n'épargne personne.”
Le député Mohamed Ali a confirmé dans une déclaration à inkyfada que "la question de la révision du décret 54 sera à nouveau soulevée dans un avenir proche", ce qui s'est effectivement produit le 22 janvier dernier, lorsque cette troisième initiative a recueilli les signatures de 60 député·es, en raison de "la conviction partagée par tous les milieux que le décret 54 a créé des tensions politiques, entravé le travail des journalistes et affecté un grand nombre de citoyens qui ont été victimes de l'expression de leurs opinions et positions".
“Dans le contexte actuel en Tunisie et dans la région, il est impossible de parler de dialogue national lorsque des législations, décrets et lois entravent les échanges, creusent le fossé entre le pouvoir et le reste de la société – activistes, journalistes, défenseurs des droits humains – et constituent un obstacle à l’unité nationale.”
Le secrétaire général du SNJT demande aux représentant·es du peuple “d’être fidèles à leur discours en faveur des libertés et de la liberté de la presse, considérée comme le seul acquis depuis la révolution jusqu'à aujourd’hui.”
Le décret 115 en loi et les instances de régulation
Avec la multiplication des poursuites judiciaires en vertu du décret 54 et l’absence d’application du décret 115 régissant la profession journalistique, l’ancien secrétaire général du SNJT, Mohamed Yassine Jelassi, estime que “le travail journalistique est devenu précaire, car il est régi par deux décrets”, et qu’il est donc temps, selon lui, que les lois encadrant le secteur soient “une priorité de l’action législative, civile et syndicale. Le cadre législatif de la liberté de la presse doit être renouvelé et les décrets 115 et 116 doivent être transformés en lois.”
Une position que partage son successeur à la tête du syndicat, Zied Dabbar, qui insiste sur “la nécessité de transformer le décret 115 en une loi fondamentale garantissant un environnement de travail adéquat pour les journalistes.”
“Un débat public sera ouvert dans le cadre d’une séance plénière ou d’une conférence nationale sur le décret 115, et une proposition sera soumise pour qu’il devienne une loi.”
À l’instar de la transformation du décret 115 en loi, les structures professionnelles demandent la création d’une instance nationale de régulation des médias, à l’image de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), qui est régie par le décret 116. Ce besoin se justifie par la situation de “vide institutionnel”, qui représente une menace pour les journalistes et les expose à des poursuites judiciaires, comme ce fut le cas pour le journaliste Jamel Arfaoui.
Le vide institutionnel dans le secteur a exacerbé la crise des journalistes, les laissant face à face avec la justice. Depuis l’annonce des mesures du 25 juillet 2021, les prérogatives de la HAICA ont été ignorées, et elle a été exclue du paysage médiatique qu’elle régulait, garantissant diversité, pluralisme, équilibre et indépendance des médias audiovisuels.
La marginalisation de la HAICA s’est accentuée avec la décision de mettre à la retraite son président, Nouri Lajmi, à compter du 1ᵉʳ janvier 2023, sans lui désigner de successeur·e. De nombreuses organisations de défense des droits humains ont alors exprimé leur inquiétude quant au devenir de cette instance, considérée comme une référence en matière de gouvernance des médias en Tunisie.
Le Conseil de la presse, une instance indépendante créée en 2020, fait également face à plusieurs obstacles l’empêchant de remplir pleinement son rôle, notamment l’absence de financement, de ressources humaines et de locaux dédiés. Ces entraves paralysent son action en tant qu’organe indépendant visant à défendre la liberté de la presse, garantir le droit du public à l’information et promouvoir l’autorégulation et la déontologie journalistique.
Le professeur de droit Aymen Zaghdoudi affirme qu’il est nécessaire de “renforcer la place du Conseil de la presse et d’instaurer une instance de régulation indépendante de la communication audiovisuelle, qui ne soit soumise ni aux ordres ni aux directives du pouvoir exécutif.”
“Le danger ne se limite pas aux journalistes”
Si les journalistes sont les premiers affectés par les conséquences du décret 54, car ils “souffrent non seulement sur le plan économique et social, ainsi que dans l’accès à l’information, mais aussi à travers les poursuites judiciaires engagées contre eux”, selon le secrétaire général du SNJT, les répercussions du décret dépassent le cadre du journalisme pour concerner l’ensemble de la population. Dabbar s’interroge : “Si un journaliste est emprisonné en Tunisie pour l’exercice de ses fonctions ou pour avoir exprimé son opinion, quel sera le sort du citoyen qui exprime son avis sous le régime du décret 54 ?”
“Le danger ne se limite pas aux journalistes. La protection de la liberté de la presse et d’expression est une garantie pour tous les Tunisiens. Avec la crise économique et sociale que traverse le pays, si la liberté des citoyens est restreinte, ils seront privés du seul acquis obtenu grâce à la révolution”, insiste-t-il.
En effet, en janvier 2023, un jeune originaire du gouvernorat de Kasserine a été arrêté en vertu du décret 54 pour “incitation à la protestation” après avoir diffusé une publication sur Facebook quelques jours avant la commémoration de la révolution, dans laquelle il écrivait : “À la révolution, à la rue de nouveau… La révolution continue.” De même, une militante politique du Parti destourien libre a été poursuivie en octobre 2023 en vertu de l’article 20 du décret controversé pour avoir administré les pages de son parti sur les réseaux sociaux. En septembre 2024, l’activiste Moudda Jemai a également été arrêtée à Gabès, accusée de plusieurs charges en vertu du même décret.
Mohamed Yassine Jelassi considère que le décret 54 est tout simplement “un instrument de suppression des libertés”. Il adresse un message à tous, y compris “ceux qui exercent la politique et ont occupé le pouvoir par le passé”, leur rappelant que “manipuler les lois à leur avantage est une démarche incertaine, car ces mêmes lois finiront par s’appliquer à eux.”
De son côté, Zied Dabbar appelle l’État tunisien à “réviser sa politique en matière de liberté d’expression et de presse, et à supprimer toutes les sanctions privatives de liberté à l’encontre des journalistes, des professionnels des médias et de toutes les personnes exprimant leurs opinions.”
Et le secrétaire général du syndicat de conclure : “Les États démocratiques ne prononcent pas de peines de prison pour des délits d’opinion.”