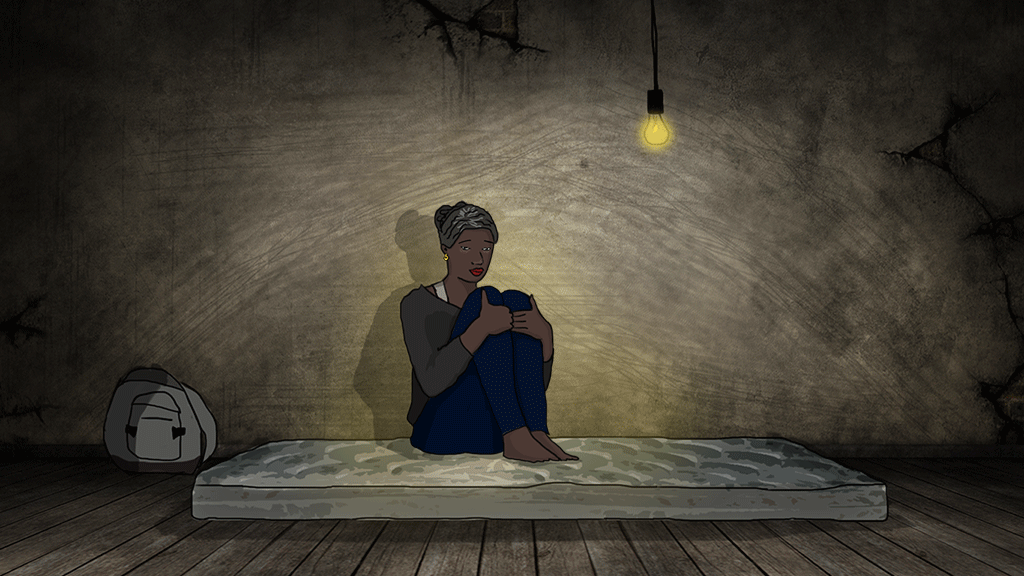“Je sens que les gens me traitent différemment parce que je suis noire. Déjà, on ne me considère pas comme une Tunisienne”, témoigne Khawla Ksiksi, une juriste tunisienne. Depuis toute petite, elle ressent le poids du harcèlement et des stéréotypes à l’encontre des personnes noires. Dès la crèche, les enfants lui disent de “prendre une douche”. Dans la rue, des hommes l’insultent, la prennent pour une fille facile, “une machine à sexe”.
“Les gens n’imaginent pas que j’ai pu faire des études, on me prend toujours pour une serveuse ou une femme de ménage. On me dit souvent aussi que je suis ‘belle pour une Noire’.”
Ce genre de témoignage n’est pas isolé, que ce soit de la part de Tunisien·nes noir·es ou de Subsaharien·nes résidant en Tunisie. “Tout ça c’est du racisme ordinaire”, résume Khawla Ksiksi. Un racisme ordinaire qui a souvent de lourdes conséquences, allant d’actes discriminatoires à des actes de violence verbale ou physique.
Définir le racisme
Selon la Convention internationale relative à l’élimination de la discrimination raciale, ratifiée en 1967 par la Tunisie, “une discrimination raciale vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.”
En Tunisie, il n’existe pour l’instant aucun texte juridique spécifique condamnant formellement ces actes, à l’exception de certaines dispositions du décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition.
Une proposition de loi avait été élaborée par des associations de la société civile en 2016. Le but était de mettre en place des mécanismes pour lutter efficacement contre le racisme en Tunisie : des politiques de sensibilisation au sein des institutions publiques, une criminalisation des actes discriminatoires, un meilleur accès à la justice, ainsi que la création de structures visant à protéger les victimes du racisme.
Mais ce projet a finalement été délaissé car “ce n’était pas prioritaire”, estime Jamila Ksiksi, l’une des 14 député·es ayant soutenu cette proposition. Il n’a jamais été débattu en plénière et a finalement été abandonné.
Depuis quelques mois, la question est de nouveau à l’ordre du jour. Le ministère des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits humains a proposé un nouveau projet de loi. Composé de seulement 11 articles, ce texte est beaucoup moins détaillé que le premier et n’a “même pas le strict minimum”, considère la députée.
Par exemple, la notion de discrimination raciale est définie comme étant “une distinction basée sur l'ethnie, la couleur ou l’origine” alors que la première proposition incluait en plus la nationalité et la religion. Elle définissait également l’ensemble des concepts découlant du racisme tels que “la discrimination indirecte”, le “harcèlement racial” ou encore “la vulnérabilité”, notions qui ne sont pas mentionnées dans le projet de loi.
Malgré ces manquements, Jamila Ksiksi juge que ce texte constitue tout de même un “pas en avant”. “C’est un signal fort qui montre que l’État s’engage contre les discriminations raciales, et c’est ce qu’on veut. Maintenant c’est à nous d’améliorer ce texte”.
Des sanctions limitées
Les peines prévues peuvent aller jusqu’à 3 ans de prison et 3000 dinars d’amende. Si la sanction concerne une personne morale, elle peut être condamnée à une amende entre 5000 et 15.000 dinars.
Les actes formellement condamnés sont l’incitation à la haine, la diffusion d’idées fondées sur la haine raciale, l’apologie et le soutien à des idées ou pratiques discriminatoires, ainsi que l’appartenance à des groupes haineux ou discriminants. Aucun article ne mentionne les actes de violence physique ou d’agression, pourtant régulièrement dénoncés par les associations et les victimes elles-mêmes.
Mais cette criminalisation des actes racistes présente plusieurs problèmes. L’article 9 du projet prévoit que “les sanctions prévues par cette loi n’empêchent pas l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur”.
“C’est anticonstitutionnel”, indique Mohamed Ben Hamida, expert juridique au sein de l’ONG Al Bawsala. “Si deux peines sont prononcées, la sanction appliquée est forcément la plus faible au regard de la loi.”
De plus, cette loi pourrait ne protéger que les citoyen·nes tunisien·nes. L’article 2 précise qu’une distinction entre un·e national·e et un·e étranger·e n’est pas forcément considérée comme une discrimination. Si un·e étranger·e est discriminé·e en raison de sa couleur de peau ou de sa nationalité, le caractère raciste de cette violence ne sera pas forcément retenu.
“Il faut complètement supprimer ce paragraphe”, affirme Jamila Ksiksi, “Cela va de soi qu’un étranger et un citoyen n’ont pas les mêmes droits, ce n’est pas la peine de le préciser ! Cette partie risque d'être instrumentalisée.”
Une grande partie des victimes de discrimination en Tunisie sont pourtant des étranger·es, pour la plupart originaires de pays subsahariens. Beaucoup sont étudiant·es dans des universités tunisoises grâce aux accords de coopération existant entre leur pays et la Tunisie. En 2016-2017, ils et elles étaient environ 4500 selon les chiffres de l’Association des étudiant·es et stagiaires africain·es en Tunisie (AESAT).
Cette même association note que ce nombre ne cesse de diminuer, principalement en raison des problèmes que rencontrent les étudiant·es en Tunisie. La plupart dénoncent les difficultés administratives et des actes de discrimination réguliers.
“Ils n’ont pas pensé aux étrangers dans ce texte. Il n’y a aucune stratégie pour résoudre les problèmes des migrants en Tunisie et les protéger de la violence”, déplore Safouen Medfai, secrétaire général de l’association Mnemty, une organisation luttant contre le racisme.
En plus des étudiant·es, beaucoup de migrant·es viennent en Tunisie pour tenter la traversée vers l’Europe ou trouver du travail. Ces personnes, souvent vulnérables, sont également exposées au racisme mais aussi à l’exploitation.
Sur le même sujet
La proposition faite en 2016 condamnait d’ailleurs plus sévèrement les personnes ayant une autorité sur la victime, ou exerçant des pressions à son encontre pour l’empêcher d’entamer une procédure. Cette aggravation de la peine n’a pas été ajoutée au projet gouvernemental.
Faciliter l’accès à la justice
Entre la peur de porter plainte et la lenteur des procédures, l’accès à la justice reste difficile pour les victimes de discrimination. La députée Jamila Ksiksi insiste sur la nécessité de créer “un cadre de confiance” pour qu’elles osent porter plainte.
Elle propose par exemple de faciliter l’accès à la justice en tenant davantage compte de la parole de la victime. “Parfois, une personne peut subir une agression ou des propos racistes sans pouvoir le prouver. Mais il faut quand même pouvoir porter plainte, cela doit être mentionné dans le texte !”
Concrètement, ce projet de loi propose déjà quelques mesures pour améliorer l’accès à la justice. La victime pourra désormais porter plainte directement auprès du ou de la procureur·e qui devra être préalablement formé·e aux questions discriminatoires.
Le but est d’éviter que les victimes ne passent par le commissariat où “elles rencontrent souvent des problèmes”. “On ne prend pas leur plainte ou bien les policiers ne considèrent pas que l’agression est raciste”, raconte Safouen Medfai de Mnemty. De plus, étant souvent dans une situation administrative illégale, faute d’avoir reçu leur carte de séjour dans les temps, beaucoup de Subsaharien·nes préfèrent éviter d’avoir affaire à des policier·es.
Avec cette nouvelle disposition, Safouen Medfai espère que les victimes seront plus en confiance et que les procédures seront accélérées. Selon ce texte, l’enquête préliminaire ne devrait pas dépasser deux mois et le verdict devrait également être rendu dans un délai de deux mois.
“Nous avons demandé à ce que les procédures prennent moins de temps car parfois les procès prennent plusieurs années et les victimes lâchent l’affaire”.
Mais la description de la procédure n’est pas complète pour autant. “Le texte n’explique pas la démarche à suivre si l’enquête excède les deux mois par exemple”, commente Mohamed Ben Hammida d’Al Bawsala. “Y aura-t-il une sanction ? Un non-lieu ?”. Le juriste souligne aussi qu’il y a un risque que les enquêtes soient bâclées afin d’être achevées dans les temps.
Se pose également le problème de la langue.“Tous les étudiants subsahariens ont déjà été victimes de racisme”, affirme Janista Assengone, une Gabonaise étudiante en droit. “Et ça ne nous traverse même pas l’esprit d’aller porter plainte ! Porter plainte contre qui ? Déjà tu ne parles pas arabe, c’est déjà une première barrière qui est là...”
La proposition faite en 2016 prévoyait que les autorités judiciaires soient obligées d’informer les victimes de leurs droits dans la langue de son choix, une mesure qui n’a pas été inscrite dans le projet gouvernemental. Peu de Subsaharien·nes parlent l’arabe et l’impossibilité d’avoir accès à des documents en français les dissuade souvent d’entamer une procédure.
Une sensibilisation peu concrète
Avec ce projet, le gouvernement prévoit la mise en place de “programmes de sensibilisation” au sein des ministères ainsi qu’une formation spécifique auprès des juges, des gardien·nes de prison et des agent·es de la police judiciaire dans le but de “donner un meilleur accès à la justice” et de “lutter contre l’impunité”.
“Cette formation sera réalisée par qui, comment et selon quels critères ?”, s’interroge le secrétaire général de Mnemty. Aucun détail n’est donné à ce sujet, il est simplement mentionné que des “stratégies” seront mises en place. Pour le militant, la priorité devrait être donnée aux domaines de l’audiovisuel, de la santé mais surtout de l’éducation, “par exemple dans les manuels scolaires”.
En comparaison, la loi contre les violences faites aux femmes est beaucoup plus exhaustive et concrète, avec la mise en place de programmes scolaires et universitaires, une sensibilisation de la part des médias, et l’organisation de cycles de formation.
Sur le même sujet
La proposition de 2016 était encore une fois plus détaillée et imposait aux ministères de la justice, de l’éducation et de l’enseignement supérieur d’instaurer des programmes spécialisés au sein de leurs institutions. Elle condamnait également les fonctionnaires reconnu·es coupables d’acte de discriminations dans le cadre de leurs fonctions d’un mois à deux ans de prison et d’une amende.
En ce qui concerne l'accompagnement, le projet de loi prévoit de mettre en place un soutien “psychologique et social” pour les victimes. Mais de la même manière, aucune information n’est fournie sur cette prise en charge qui est pour l’instant assurée par des ONGs comme Médecins du Monde.
De son côté, Mnemty, en collaboration avec l’organisation “Rosa Luxembourg”, compte créer un centre d’écoute, composé de médecins et de psychologues. Il devrait être fonctionnel entre avril et décembre 2018. L’organisation espère que d’ici là, une structure étatique sera établie et pourra prendre le relais.
Une commission indépendante ?
Pour assurer l’ensemble de ces changements, une commission de lutte contre les discriminations devrait être créée afin de proposer les politiques, les stratégies et les programmes d'action au niveau national pour lutter contre le racisme. Elle aurait en plus un rôle d’observatoire chargé d’établir de statistiques. Pour l’instant, seules les associations essaient de recenser le nombre d’actes racistes car il n’existe aucune étude au niveau national.
“On doit bien revoir les statuts de cette commission car elle doit être indépendante, comme toute structure découlant d’un cadre juridique international”, prévient Jamila Ksiksi, “il faut bien définir ses liens avec le gouvernement, son rôle et ses prérogatives.”
Pour l’instant, il y a peu de détails sur le fonctionnement et la composition de cette commission. Son indépendance n’est pas non plus garantie : il est précisé qu’elle sera rattachée au ministère des droits humains. “Pour assurer une véritable indépendance vis-à-vis du gouvernement, cette commission devrait être rattachée à la Haute instance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et non à un ministère”, estime Mohamed Ben Hamida.
Ce projet gouvernemental est étudié en commission depuis le 15 mars 2018. Jamila Ksiksi espère qu’il pourra être débattu en plénière à la fin du mois de mai. En attendant, la députée ainsi que les membres d’associations telles que Mnemty comptent développer une stratégie de lobbying auprès de la Commission des droits et libertés et des relations extérieures, afin de pousser ses membres à améliorer le texte grâce à de nouveaux amendements.