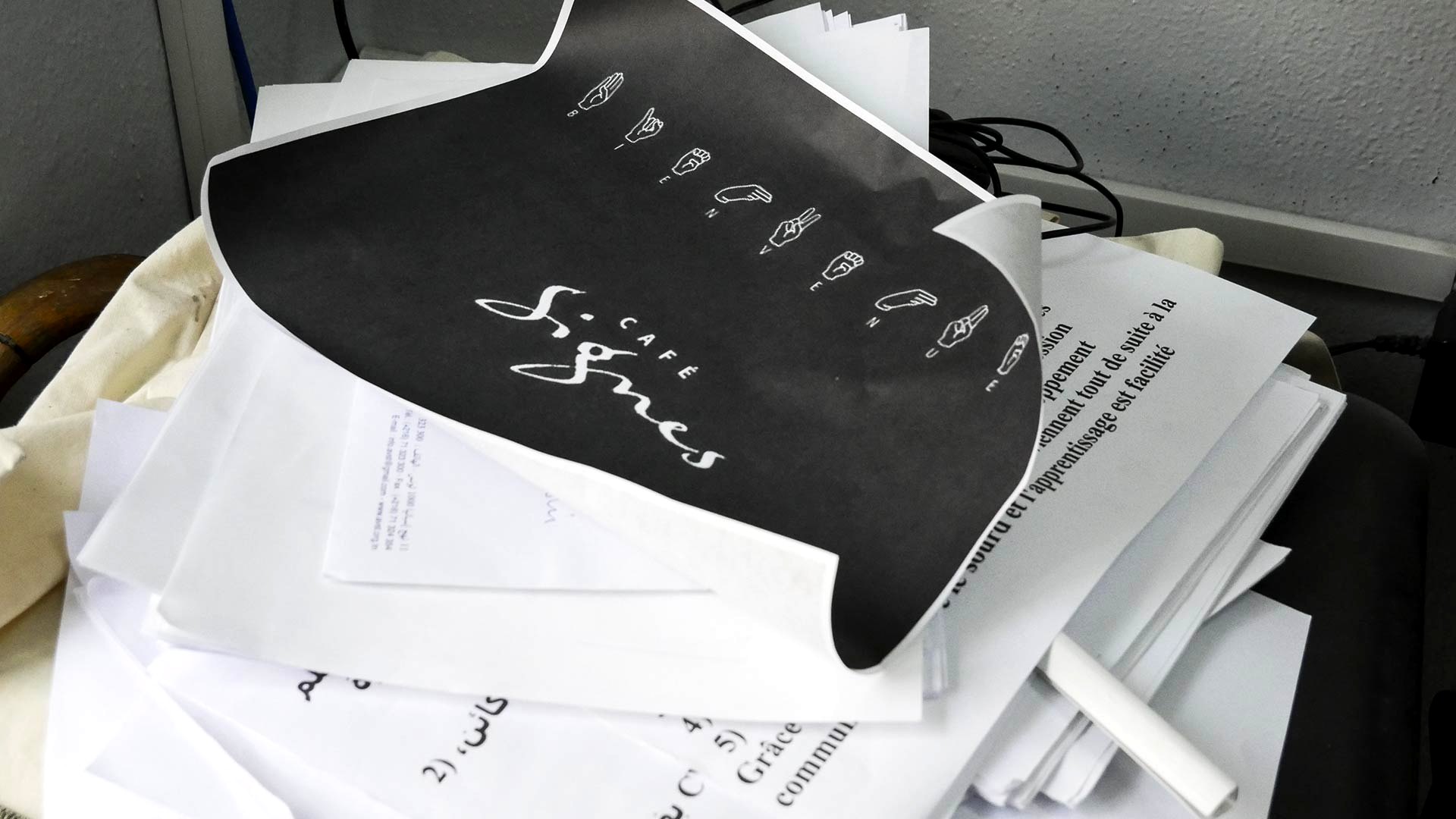“Quand j’étais petit, je ‘volais’ les signes.”
En Tunisie, il existe des centres pour les personnes atteintes de surdité, appelées “écoles spécialisées”. Elles prennent en charge les enfants dès leur plus jeune âge pour leur assurer une scolarité. C’est le cas de Mohamed qui intègre l’une d’entre elles, située au Bardo. Focalisée sur l'apprentissage de la parole, il y reste quatre ans, sans réussir à apprendre à lire, à écrire et même à parler. Il décide alors d'intégrer un centre de formation professionnel en électricité.
À 16 ans, le jeune homme obtient un diplôme d’électricien et commence à travailler. Pour autant, sa vie n’est pas si simple. Confronté aux difficultés du quotidien, il n’a pas connaissance de ses droits, ni même de l’existence d’associations aidant les personnes dans sa situation.
Ce n’est qu’à l’âge adulte, un peu par hasard, qu’il découvre “l’Association la voix du sourd” (AVST). Lors d’une séance de sport avec des jeunes de son quartier, l’un d’entre eux lui conseille de se rendre au local de l’association. Là-bas, il rencontre de nombreuses personnes confrontées aux mêmes difficultés que lui, que ce soit dans leur scolarité, l’employabilité, ou tout simplement dans leur vie courante.
Des lois inappliquées
“En Tunisie, on a une législation très avancée sur le handicap”, estime Sami Ben Jemaa, le coordinateur opérationnel de Handicap international. Déjà, “avant la Révolution, le pays était assez performant dans tout ce qui permettait de consolider son image”, explique-t-il. Mais selon lui, cette législation ne reste qu’une façade et les promesses inscrites dans les textes juridiques ne sont pas réellement mises en place.
La non-discrimination des personnes en situation de handicap est également inscrite dans l’article 48 de la Constitution. Sur le plan international, la Tunisie a adhéré en 2008 à la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Malgré ces avancées, Sami Ben Jemaa estime qu’il reste encore des choses à mettre en place comme des organismes de sanctions, notamment pour le respect des quotas au sein des entreprises.
Toute personne en situation de handicap doit en effet pouvoir suivre un cursus scolaire normal, mais aussi accéder aux services de l’emploi. En 2005, une loi a été adoptée définissant un quota d’au moins 1% de personnes en situation de handicap dans les effectifs de la fonction publique et des entreprises employant plus de 100 personnes. Le texte prévoit aussi la mise en place d’infrastructures pour faciliter l’accès à certains lieux. Et en 2006, la langue des signes tunisienne a été reconnue officiellement.
Depuis 2016, le quota a été revu à la hausse et s’élève désormais à 2% pour les entreprises de plus de 100 personnes. De plus, les entreprises ayant entre 50 et 99 employé·es doivent embaucher au moins une personne en situation de handicap.
“[Ces objectifs] sont respectés dans la fonction publique et les institutions publiques. Pour le privé, c’est encore à travailler”, commente Ahmed Belazi, le directeur du département Solidarité et développement social auprès du ministère des Affaires sociales. La loi prévoit pourtant des sanctions “mais réellement il n’y a rien, il n’y a pas de suivi”.
Sami Ben Jemaa explique ces lacunes par le manque de moyens dont souffrent les organismes de contrôle. Cette vérification devrait normalement être faite par l’inspection du travail et la médecine du travail.
En pratique, un “concours” réservé aux personnes en situation de handicap est mis en place, leur permettant de postuler à différents emplois. Les candidat·es communiquent leur niveau scolaire ou universitaire pour qu’une commission pluridisciplinaire puisse notamment juger de leur niveau d’alphabétisation. Avec ces données, cette commission vérifie aussi que leurs compétences correspondent à l’un des postes disponibles.
Droits liés à la possession de la carte handicapée
- Priorité dans les administrations, les entreprises et les établissements publics et privés,
- Places réservées dans les moyens de transport en commun publics et privés
- Gratuité du transport ou transport à tarif réduit sur les lignes de transport en commun gérées par les entreprises publiques pour il/elle et son accompagnateur·trice.
- Places de stationnement provisoire et places réservées aux personnes en situation de handicap dans les parkings publics et privés pour il/elle et son accompagnateur·trice.
- Les organismes de sécurité sociale prennent en charge, conformément aux règlements en vigueur, les frais de soins, d’hospitalisation, d’appareillage de prothèse facilitant l’intégration, ainsi que les frais de réadaptation au profit des personnes assurées sociales.
- Gratuité de soins, de l’hospitalisation dans les structures publiques de santé des appareils de prothèses et de réadaptation lorsqu’elles remplissent les conditions de bénéfice de soins gratuits ou à tarif réduit.
- Différentes allocations, pensions et indemnités au profit des personnes affiliées socialement et qui ne disposent pas d’un revenu permanent soumis à l’impôt, quelque soit leur âge ou leur rang.
-
L’État, les collectivités locales et les structures compétentes, prennent, le cas échéant, des mesures pour la prise en charge de ces personnes si elles sont nécessiteuses et souffrant d’une invalidité sévère reconnue ou sans soutien. Sont considérées
comme mesures de prise en charge:
- Prise en charge de la personne au sein de sa famille,
- Aide matérielle au profit de cette personne ou de son tuteur légal pour contribuer aux frais de ses besoins fondamentaux,
- Placement de la personne dans une famille d’accueil,
- Placement de la personne dans des établissements spécialisés dans l’hébergement et sa prise en charge.
- Assistance matérielle au profit des familles accueillant une personne handicapée sans soutien pour satisfaire à ses besoins fondamentaux.
- Gratuité d’accès aux musées, aux sites archéologiques, aux stades et aux aires publiques de distraction.
- Tout·e chef·fe de famille bénéficie d’une réduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicapé·es.
Malgré ces droits définis par la loi, les structures restent souvent inaccessibles. “Parce que maintenant si on dit handicapé, on pense [à un handicap] moteur. [Alors] que même les sourds et les aveugles ont besoin d’une signalisation spécifique à eux”, explique Ahmed Belazi du ministère des Affaires sociales.
Ironiquement, le bâtiment de la délégation du ministère des Affaires sociales de Bab El Khadra n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Ahmed Belazi déplore le fait d’être contraint de les recevoir au rez-de-chaussée, ce qui nuit à la confidentialité des échanges.
Mais le problème de l’accessibilité ne s’arrête pas là. Mieux prendre en considération la langue des signes tunisienne permettrait une meilleure intégration des personnes atteintes de surdité. Pour cela, il faudrait normaliser la langue, mais il n’y a pas d’autorité en charge de cela selon Sami Ben Jemaa. Pour Amira Yaakoubi, médecin et membre de l’AVST, tout le problème est là. La langue des signes tunisienne est issue d’un mélange de plusieurs autres langues, mais elle comprend également des signes propres à certains gouvernorats.
En 2003, l’Institut des sciences humaines (ISH) de Tunis a créé une section d’enseignement destinée à la formation d’interprètes en langue des signes tunisienne. À ce jour, il s’agit du seul cursus existant en Tunisie et les interprètes sont rares.
À son échelle, l’AVST dispense chaque samedi des cours de langue des signes, gratuitement. Plusieurs personnes sourdes mais aussi des entendant·es viennent au local de l’association pour les suivre.

Un handicap incalculable
Peu de données existent sur la question du handicap, et encore moins sur celle de la surdité. Le ministère des Affaires sociales et l’INS estiment que depuis 2014 il y aurait 8484 personnes sourdes dans le pays. 14.512 personnes auraient également des difficultés d’auditions, sans pour autant être considérées comme handicapées. Toujours selon cette même source, 61% des personnes porteuses d’un handicap seraient analphabètes. Ils et elles ne seraient que 2,2% à être scolarisé·es au niveau supérieur.
“Il n’y a pas de statistiques officielles”, estime Lotfi Zekri, le secrétaire général de l’institut de recherche en langues des signes ICHARA. Pour le coordinateur opérationnel de Handicap international Sami Ben Jemaa, il n’y a rien d’étonnant à cela, “[ces chiffres] sont issus du recensement de la population”. Les données issues d’un recensement sont généralement plus faibles que la réalité. Ce constat pousse Handicap international à montrer “qu’il y a besoin de faire une étude nationale”, continue-t-il.
Sami Ben Jemaa justifie son propos avec les résultats d’une étude non-publiée faite sur la participation sociale des personnes en situation de handicap dans la délégation de la Manouba en 2017. Il y aurait “deux fois plus, au minimum, de personnes en situation de handicap” par rapport aux chiffres officiels annoncés par le ministère et l’INS en 2014. En effet, les résultats de l’étude de Handicap International montrent qu’il y aurait entre 4,1% et 12,7% de personnes sourdes dans la délégation, contre un taux estimé à 2,1% par les autorités.
Une scolarité précaire
Les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de surdité commencent dès le plus jeune âge et sont d’abord dues aux dysfonctionnements du système de santé. “Il n’y a pas de conduite définie par le système de santé pour annoncer et accompagner l’annonce [de la surdité]. C’est un des facteurs du surhandicap”, explique Sami Ben Jemaa, le coordinateur opérationnel de Handicap international.
Malgré l’existence d’un système d’accompagnement des enfants, rien n’est fait pour aider les parents. Ce sont pourtant eux qui doivent faire des choix décisifs concernant l’éducation de leurs enfants. “Les parents peuvent ne pas accepter, fuir l’information, avoir du ressenti envers le partenaire, surprotéger l’enfant”, commente le coordinateur de Handicap International.
À partir du moment où le diagnostic de sa surdité est clairement établi, l’apprentissage de la langue des signes peut commencer très tôt chez l’enfant, “90% de ces enfants naissent dans un milieu entendant, du coup il n’y a pas d’outils de communication. Les parents n’ont pas les informations pour pouvoir communiquer avec eux”, explique Lotfi Zekri, audioprothésiste et secrétaire général de l’institut international de recherches en langues des signes de Tunis (ICHARA).
Les personnes sourdes et leurs proches peuvent ainsi avoir un sentiment d’abandon, sans forcément savoir vers qui se tourner après ce constat, en particulier lorsque la surdité n’est pas appareillable. Certaines personnes atteintes de surdité peuvent, par le biais d’un appareil auditif récupérer une partie de leur audition. Grâce à cela, elles peuvent être réorientées dans le système scolaire traditionnel et acquérir un langage parlé.
Dans ce sens, l’un des choix qui se présente aux parents est d’inscrire leurs enfants dans un centre qui se concentre sur l’apprentissage de la parole. À l’aide d’orthophonistes, le personnel scolaire essaye d’apprendre à parler à l’enfant. “De cette façon, on prépare l’élève à l’intégration des écoles ordinaires”, commente Ahmed Belazi du ministère des Affaires sociales. Tout l’enjeu est là. Si l’enfant est “appareillable” et n’a pas de lacunes scolaires, il pourra rejoindre une école classique à n’importe quel niveau, une fois un apprentissage de la parole suffisant.
Mais ce système à ses limites. Toutes les surdités ne sont pas appareillables et l’apprentissage de la parole n’est pas possible pour tous et toutes. Dans ces cas-là, des écoles spécifiques pour sourd·es leur permettent de suivre une scolarité. Selon Ahmed Belazi, l’apprentissage de la parole est cette fois totalement abandonné, le but étant de leur permettre d’intégrer des formations professionnelles à la fin de leur cursus. C’est pour cela que Sami Ben Jemaa estime “qu’il n’y a pas de stratégie d’intégration” pour les personnes sourdes non-appareillées, tout le système scolaire et universitaire traditionnel étant basé sur la communication orale.
Pour ces élèves qui ne sont pas appareillables, “l’impact (de leur surdité) est très fort sur l’accès à la connaissance et aux informations”, explique le coordinateur opérationnel Sami Ben Jemaa. Lui aussi estime que la langue des signes n’est pas assez normalisée, alors qu’elle est nécessaire à l’apprentissage. Peu de personnes en dehors de l’entourage des personnes sourdes sont sensibilisés à la langue des signes tunisienne,“généralement la famille, les copains”, commente Ahmed Belazi.
Selon lui, ce système explique que beaucoup de jeunes atteints de surdité soient illettré·es. “Il n’y a pas d’accès à la lecture et à l’écriture, pas d’accès au sous-titrage. En plus de cela, il y a la difficulté des différentes langues”, détaille Sami Ben Jemaa. La langue des signes tunisienne, tout comme le tunisien, n’a pas de forme écrite. Les élèves doivent aussi se référer à l’arabe littéraire et au français.
Mohamed, par exemple, n’est pas capable de lire le journal, “c’est juste pour voir, il ne comprend rien. L’image du policier tué, il comprend mais ça s’arrête là”, explique l’audioprothésiste Lotfi Zekri.
À la fin du cursus en école spécialisée, l’enfant peut intégrer un centre de formation professionnelle pour apprendre des métiers manuels. Pour Ahmed Belazi du ministère des Affaires sociales, les personnes en situation de handicap seraient très demandées dans ces domaines-là.
Amira Yaakoubi, médecin et membre de l’AVST, est plus critique. Selon elle, une majorité de personnes sourdes non-appareillables exercent bel et bien des métiers manuels, mais il serait très difficile pour ces personnes d’accéder à des formations universitaires et exercer dans un tout autre milieu.

Des répercussions au quotidien
Les personnes en situation de handicap dépendent de tous les ministères, sans que les compétences de chacun ne soient clairement définies, selon Ahmed Belazi.
“Ils sont tunisiens comme tous les Tunisiens. Et ça, les gens, et même les ministères, ne veulent pas le comprendre…”
Cette incompréhension et ce sentiment d’abandon, Rachid Hachmi, le président de l’AVST les connaît bien. Il se souvient d’une femme sourde qui cherchait du travail et qui s’est présentée au ministère des Affaires sociales. “Le ministère des Affaires sociales nous a dit que le ministère de l’Emploi était le plus apte”, se rappelle le président de l’association. Mais arrivé·es au ministère de l’Emploi, on leur assure que le cas des personnes en situation de handicap est “spécial” et qu’il faut retourner aux Affaires sociales.
Ce manque de clarté et de coopération entre les ministères entrave l’accompagnement des personnes sourdes et n’aide pas à leur intégration au sein de la société. “C’est difficile d’interagir socialement, de sortir du groupe ou de la communauté pour les personnes sourdes”, explique Sami Ben Jemaa, “les activités sociales, citoyennes et économiques sont en majorité destinées aux personnes entendantes.”
“Le drame des sourds, c’est que leur surdité n’est pas visible”, commente Lotfi Zekri de l’institut ICHARA.
Mohamed, après avoir commencé à exercer le métier d’électricien, est venu travailler avec le docteur Lotfi Zekri. C’est lui qui répare et nettoie les sonotones des client·es en plus de faire office de coursier pour le cabinet. Dans son quotidien, il lui est arrivé de rencontrer des problèmes liés à sa surdité. “Je lui impose de mettre un appareil à l’oreille, pour que dans la rue les gens se rendent compte qu’il n’entend pas”, explique l’audioprothésiste.
“Une fois avec des flics, alors qu’il ne portait pas ses prothèses, il a été tabassé parce qu’ils trouvaient qu’il avait été irrespectueux, parce qu’il n’avait pas répondu à leur appel”, raconte Lotfi Zekri. Avec le sonotone, Mohamed entend uniquement les sons très forts et reconnaît quand on l’appelle. Mais la technologie s’arrête là.
Ce problème d’interaction avec les personnes entendantes se décline dans la vie de tous les jours. Mohamed s’est servi d’une activité pour essayer de pallier cela : le théâtre. Après plusieurs années passées au sein d’une troupe, il estime que cela l’aide à “s’en sortir avec les entendants” au quotidien.
Malheureusement cette activité ne lui est pas utile en cas de besoins plus spécifiques et il doit avoir recours à un interprète. Par exemple, lorsque lui ou son épouse, également sourde, ont besoin de rencontrer du personnel soignant, c’est en compagnie de Lotfi Zekri qu’ils sont contraints de le faire. Leurs deux enfants, une fille et un garçon, sont tous les deux entendants. Âgés de deux ans et un an, ils sont encore bien trop jeunes pour aider leurs parents dans cette tâche, mais comprennent déjà quelques bases de la langue des signes tunisienne.
“Il y a un problème de communication entre les personnes [sourdes] et les médecins”, commente le président de l’AVST. La personne sourde vient en consultation accompagnée d’un·e entendant·e pour être sûre de bien faire comprendre la raison de sa visite. Elle expose alors son problème à une tierce personne, nécessairement mise dans la confidence et donc non-soumise au secret médical.
“C’est un calvaire”, commente Lotfi Zekri. “D’abord, comment expliquer son problème? S’il a un problème au pancréas ou quelque chose d’interne, il ne pourra pas exprimer ce problème-là.” Il considère que les personnes sourdes peuvent avoir des difficultés à expliquer les symptômes dont ils souffrent. Ce qui peut être dû au manque de vocabulaire et à la pauvreté de la langue des signes tunisienne, selon la médecin et membre de l’AVST Amira Yaakoubi.
Face à ce constat, l’AVST, soutenue par Handicap International et l’Institut français de Tunisie, a mis en place des ateliers de sensibilisation gratuits pour les personnes sourdes. Initialement concentré sur le point de vue médical et la communication avec les médecins, les débats des séances se sont progressivement élargis à des questions de société plus générales.
Ayant animé les ateliers, Amira Yaakoubi se souvient de différentes situations. Il lui est arrivé de rencontrer “des femmes victimes de viols qui ne savaient pas ce qu’était un viol, qui ne savaient pas que c’était une agression, qu’il fallait consulter suite à cela, qui étaient tombées enceintes, qui avaient gardé le bébé suite à un viol. Parce qu’elles ne savaient pas qu’elles pouvaient avorter.” C’est par l’explication de certaines choses qui peuvent sembler basiques que Amira Yaakoubi se félicite de l’existence de ces séances de sensibilisation.
Tout cela permet aussi aux personnes sourdes de dépasser les aprioris négatifs portés sur les administrations. “Un sourd ne peut pas aller dans une mairie et dire j’ai besoin d’un papier, parce qu’il ne peut pas trouver un interprète à qui parler. Un sourd ne peut pas se rendre à une administration et faire une demande pour quoi que ce soit”, détaille la médecin Amira Yaakoubi. La majorité des personnes sourdes étant analphabètes, elles ne peuvent pas se faire comprendre à l’écrit quand la communication est difficile.
“Il n’y a pas de mécanisme qui aide les sourds à être indépendants.”, termine la médecin.
“C’est un handicap très compliqué, il touche tout un mode de communication”, commente Sami Ben Jemaa, “les personnes sourdes se comportent de manière assez agressive, avec l’impression que tout est fait contre eux.”
Depuis le début du programme, de plus en plus de personnes sourdes sont conscientes de ce dont elles souffrent. En plus de cela, un autre volet du programme consiste à “former le cadre médical et paramédical du dispensaire de Ben Amar”, explique Amal, l’interprète de l’AVST. C’est elle qui est chargée d’enseigner quelques bases de la langue des signes au personnel médical.
Pour permettre cette meilleure compréhension entre personnes sourdes et entendantes, l’utilisation des outils numériques est devenu essentielle. L’internet, les réseaux sociaux et les outils de communication vidéo ont permis un meilleur accès aux informations. Avant, “quand Mohamed voulait téléphoner, pour expliquer une chose de 5 minutes, ça prenait 30 minutes”, se remémore Lotfi Zekri. Car avant Mohamed avait besoin d’un interprète près de lui pour pouvoir communiquer à distance. A présent, il communique seul en langue des signes grâce à la vidéo.
“Dans le temps, le sourd avait besoin de nous pour trouver l’information, maintenant il trouve l’information avec le téléphone”, commente l’audioprothésiste. C’est ce qui fait dire à Amira Yaakoubi que la surdité n’est pas un “vrai” handicap, seulement une langue étrangère.