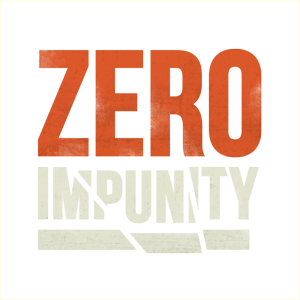Car bien loin des nobles intentions de promotion des droits de l’homme – et des femmes –, les scandales d’abus sexuels commis par des casques bleus ou des fonctionnaires onusiens émaillent l’histoire récente de l’organisation. D’après le « Rapport d’évaluation sur les efforts d’assistance en matière d’exploitations et abus sexuels liés au personnel des missions de la paix » (mai 2015), 480 allégations d’abus ont été dénombrées de 2008 à 2013. Tout porte à croire que les cas sont largement sous-reportés.
Bosnie, Timor oriental, Cambodge, Liberia, Guinée et plus récemment Haïti, République centrafricaine (RCA) ou République démocratique du Congo (RDC) : la liste est longue. « Alors que les forces de maintien de la paix sont censées protéger la population », rappelle la sociologue Vanessa Fargnoli, « certaines organisations constatent que le nombre de viols augmente avec la présence militaire ».
Et à chaque nouveau scandale, son lot de promesses. En 2005, le rapport du prince Zeid, conseiller du secrétaire général de l’ONU, dénonce l’exploitation et les abus sexuels. Il fait l’effet d’une bombe dans toute l’organisation. Onze ans plus tard, quasiment aucune des mesures qu’il avait proposées n’a été suivie d’effets.
Les règles de bonne conduite pour les 16 missions rassemblant 120 000 personnels (100 000 casques bleus, militaires ; le reste des civils) sont pourtant claires : tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels ; interdiction de relation sexuelle avec une prostituée ainsi qu’avec une personne de moins de 18 ans ; relations avec les bénéficiaires de l’assistance de l’ONU vivement découragées. Mais sur le terrain, hypervirilité, machisme, misogynie, déliquescence des États, sentiment de toute-puissance et racisme ont raison des règlements, selon Vanessa Fargnoli. Ils favorisent ces « abus de pouvoir qui prennent une forme sexuelle ».
Les humanitaires ou fonctionnaires onusiens rencontrés lors de notre enquête s’accordent, en « off », à parler de « sexualité débridée » lors des missions de la paix et de « verrous moraux qui sautent ».

L’épineuse affaire Victoria
En 2010, Margot Wallström, représentante spéciale de l’ONU sur la violence sexuelle dans les conflits, qualifie la RDC (République démocratique du Congo) de « capitale mondiale du viol » devant les 15 membres du conseil de sécurité après sa visite dans le pays. La haute fonctionnaire veut attirer l’attention des diplomates. Ils ignorent en revanche que c’est précisément en RDC que les accusations contre du personnel onusien sont les plus nombreuses : 45 % des cas de violences reportés entre 2008 et 2013, dont un tiers concerne des mineurs…
En 2012, Victoria Fontan, alors professeure à l’Université pour la paix au Costa Rica, mène un travail de recherche sur la RDC. Elle entend parler d’histoires de viols commis par des membres de la Monusco (mission onusienne en RDC) et décide de mener l’enquête. Quatre ans plus tard, nous la retrouvons. La chercheuse a depuis longtemps changé de vie, mais se rappelle parfaitement cet épisode.
Lors de ses trois mois passés dans l’est du pays à interroger des victimes, elle découvre deux cas qui n’ont alors jamais fait l’objet d’une enquête par les Nations unies. Le premier concerne une mineure violée à plusieurs reprises et battue par cinq soldats, dont trois de la Monusco. Enceinte, la jeune fille accouche et perd son enfant deux jours plus tard. Pour le second cas, Victoria Fontan passe trois jours à Uvira dans un hôtel qui serait devenu un « hot spot » de la prostitution pour le personnel de la Monusco. Elle se fait passer pour une coiffeuse, son fixeur [accompagnateur local qui fait office de guide et d’interprète], pour un investisseur, nous raconte-t-il au téléphone, en septembre 2016.
Il se rappelle les clients, « des militaires d’un certain rang qui pouvaient se payer une chambre à quelques mètres du camp pour quelques heures ou pour la nuit ».
Il évoque aussi des « mouvements suspects dans l’hôtel » mais, dit-il, « nous n’avons pas pu voir ce qu’il se passait dans les chambres, il n’y avait pas de caméras ». Après avoir interrogé le patron de l’établissement qui leur confirme les témoignages recueillis et leurs propres observations, Victoria Fontan rédige un rapport où elle affirme que des casques bleus et du personnel onusien – dont des pilotes russes – s’offrent le « service » de prostituées, parmi lesquelles figurent des mineures. Elle écrit un article dans la presse colombienne, mais n’arrive pas à attirer l’attention sur ses découvertes.
Victoria décide d’envoyer ses recherches à un journaliste canadien qu’elle connaît. Il publie le 3 août 2012, sur le site du Globe and mail, un article intitulé : « Peacekeepers gone wild : How much more abuse will the UN ignore in Congo ? » (« Quand les casques bleus perdent la raison : combien de temps les NU vont-elles ignorer les abus ? »). Cette fois, l’ONU réagit. Victoria est contactée par la sous-secrétaire générale du Bureau des services de contrôle interne (BSCI), Carman Lapointe. Cet organe créé en 1994 permet de réaliser des enquêtes internes à l’ONU en cas de suspicion de fraude, de corruption ou encore d’abus sexuels. Aujourd’hui retraitée, les souvenirs que Carman Lapointe partage en octobre 2016 sont confus. Elle croit qu’il y a bien eu enquête sur les cas en RDC, « par le bureau de Nairobi » mais qu’il n’y aurait pas eu assez d’éléments pour l’étayer.
La réponse écrite du service presse du département des opérations de maintien de la paix est encore plus intrigante : « Le temps que l’article soit publié, nous avons été informés que l’hôtel identifié dans son rapport avait fermé. L’information disponible dans son article était insuffisante pour permettre une enquête complémentaire ». À New York, une troisième version est donnée par le directeur de la division d’enquête de l’ONU : « D’après nos fichiers, nous avons identifié cinq cas qui ont des similarités avec ceux cités mais aucun ne correspond exactement. Je ne peux donc pas dire catégoriquement que nous avons enquêté sur ces cas ni dire que nous les avons écartés ».
En résumé, cinq ans après les faits, aucune trace tangible d’un début d’enquête dans les archives de l’ONU qui s’enfonce dans la confusion…
Victoria, elle, considère que l’affaire a été étouffée. « Leur première réaction avait été de dire que je n’étais jamais allé en RDC. J’ai ensuite été baladée pendant des semaines, me faisant croire que j’allais participer à l’enquête. Après quelque temps, plus de nouvelles, à part pour me proposer une mission de consulting… » Personne n’a recueilli son témoignage, ni demandé ses notes. Les potentielles victimes n’ont, à notre connaissance, jamais été contactées par les enquêteurs de l’ONU. Quant à l’hôtel, il existe toujours. Les commentaires sur le site de voyages Trip Advisor sont d’ailleurs excellents. Difficile en revanche de savoir si le personnel de l’ONU y a toujours ses habitudes.
L’affaire Victoria est loin d’être la seule à disparaître dans les limbes administratifs de l’ONU. Au fond d’un dédale de bureaux new-yorkais, Sylvain Roy, cadre supérieur du « Groupe de déontologie et discipline », le bureau chargé de récolter et d’évaluer toutes les plaintes pour « mauvaises conduites » commises par les membres du personnel de l’ONU, nous reçoit. « On choisit si on a assez d’information pour débuter une investigation ou non. Si ce n’est pas assez, on va demander à notre personnel sur le terrain d’aller obtenir quelques détails supplémentaires ».
Son unité compte 70 personnes environ (à New York et sur le terrain), pour plus de 120 000 individus à contrôler.
Selon ses estimations, 400 à 500 allégations de « mauvaises conduites » sont reçues par an, dont 15 % de violences sexuelles (soit 75). Il assure que « la grande majorité des dossiers sont enquêtés ».
Mais combien de plaintes sont écartées avant même de faire l’objet d’une évaluation par son équipe ? Combien de ces allégations sont aussi mises de côté pour « manque de preuves » par le Groupe de déontologie ? Personne n’a su nous fournir de chiffres exacts, les rapports non plus.
« Tout cela est très subjectif », nuance Thierry, un humanitaire qui préfère garder l’anonymat et qui a passé deux ans en République centrafricaine (RCA). « Ça dépend du chef de l’équipe de discipline en mission, de sa volonté politique et s’il a le courage de se lancer dans des enquêtes très difficiles et longues, y compris pour les victimes… » Dans presque tous les cas d’agression, assure-t-il, les accusations ne sont pas transmises au Groupe de déontologie et discipline mais aux ONG médicales ou nationales sur place, « qui n’ont aucune envie de partager les informations, pour ne pas qu’elles se perdent dans l’administration », et préfèrent donc prendre en charge elles-mêmes les cas d’abus et d’exploitations sexuels.
Si la plainte passe le filtre du Groupe de déontologie, donc que celui-ci juge qu’il y a suffisamment d’éléments pour lancer une enquête, le dossier est ensuite transmis au Bureau de contrôle des services internes. C’est le directeur de la division d’enquête qui déterminera à son tour, s’ils poursuivront une enquête ou pas. Mais Carman Lapointe, à la tête du BSCI de 2010 à 2015, confirme :
« Des cas sérieux de mauvaise conduite ne nous ont jamais été reportés ».

De l’incompétence généralisée
Si le Groupe de déontologie constitue un premier obstacle, le BSCI n’est pas plus efficace. Pour Camille, notre fonctionnaire de l’ONU, « le but est de faire des investigations de façade, l’important est que les enquêteurs se présentent à un endroit, inquiètent un peu les gens et ensuite ne trouvent rien ». Comme pour le Groupe de déontologie, certaines plaintes sont mises de côté, sur la base d’intuitions et d’appréciations personnelles. « Si on reçoit une évaluation initiale qui nous dit qu’on a reçu la plainte de façon anonyme ou qu’il n’y a pas assez de preuves, on ne peut pas faire grand-chose », concède Carman Lapointe. En 2015, selon les chiffres officiels, sur les soixante-neuf dénonciations reçues dans l’année, seules dix-sept enquêtes ont été menées à terme. Parmi elles, sept ont été étayées contre dix non étayées, pour manque de preuves ou de « détails ». « Cela représente beaucoup d’accusations par an », reconnaît-on du côté des Nations unies.
Sur le terrain, les méthodes d’investigation apparaissent aussi inadaptées pour les cas d’abus sexuels, voire peuvent constituer une violence supplémentaire pour les victimes. Camille appelle les interrogatoires des « check-list interviews » :
« On fait une liste de questions pré-établies et on coche, sans comprendre la psychologie des victimes. Si le témoin nous donne quelque chose d’intéressant, on n’explore pas ».
Techniques d’enquête défaillantes
Dans les retranscriptions d’interrogatoire qui nous ont été transmises, une enquêtrice insiste sur la façon dont une jeune fille mineure haïtienne a été contaminée par le sida, fait qui n’avait rien à voir avec son viol présumé. Lors d’une autre enquête, la même enquêtrice, malgré de fortes suspicions de l’état d’ébriété du suspect, termine sa procédure sans s’en inquiéter. Il s’agissait d’une affaire de viol en réunion en RDC. Camille déplore ce manque de spécialisation et d’expérience que Françoise Bouchet-Saulnier, directrice juridique de Médecins sans frontières, a pu observer.
En Centrafrique par exemple, pendant l’été 2015, quand un enquêteur a voulu prendre une mineure qui avait été abusée en photo complètement nue, « soi-disant pour montrer [la photo] à un médecin afin de déterminer son âge, c’était choquant et tout à fait inapproprié ». Ou encore lorsqu’un mineur violé a été emmené sur la base militaire et présenté aux soldats pour les identifier :
« Les enquêteurs ont dit : “On va voir s’il reconnaît un uniforme.” Le mineur a pris ça comme une confrontation à son agresseur et a vécu un traumatisme abominable », se souvient-elle.
Contacté en février 2017, Ben Swanson, directeur de la division d’enquête du BSCI, dément fermement ces mauvaises pratiques : « J’affirme catégoriquement que le BSCI n’a pas pris de photos de victime nue ». Quoi qu’il en soit, pour les enquêteurs qui poseraient trop de questions pour “satisfaire [leur] curiosité”, on se retrouve à la porte, comme ça a été le cas pour Peter Gallo, enquêteur de 2010 à 2015, devenu lanceur d’alerte.
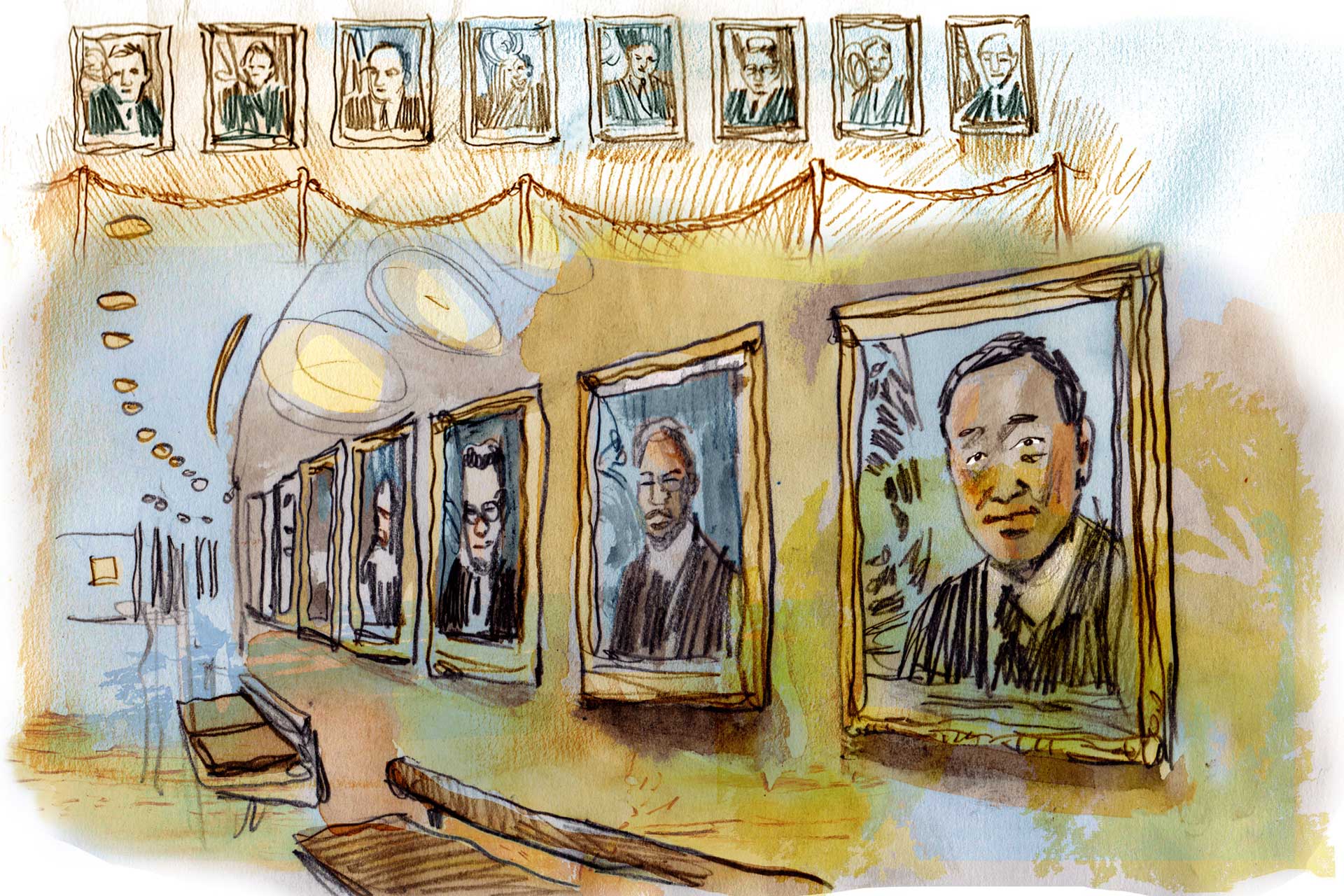
« Aussi rares que des roses sur des icebergs »
Pensant agir dans l’intérêt de l’organisation, certains employés de l’ONU ont tenté de dénoncer ces dysfonctionnements. Mais obtenir la protection de l’organisation est une longue bataille qu’ils sont peu nombreux à gagner. Ces lanceurs d’alerte semblent plutôt bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers la sortie : remise en cause de leurs performances et non renouvellement de leur contrat. En effet, le GAP (Government Accountability Project), une ONG qui les protège et leur apporte une aide juridique, affirmait en 2014 que « 99% des 400 membres du personnel qui ont cherché à obtenir le soutien des Nations Unies depuis 2006 » ne l’ont pas obtenu.
Les « normes de conduite de la fonction publique internationale » précisent pourtant qu’ « un fonctionnaire international a le devoir de signaler toute violation des règles et règlements de l’organisation à l’autorité compétente » et qu’il a « le droit d’être protégé d’éventuelles représailles ».
Enquêtrice pour les droits humains à l’ONU, Caroline Hunt-Matthes est appelée sur le terrain pour investiguer sur le viol d’une réfugiée mineure sri-lankaise par un employé onusien, en 2003.
« Le représentant du secrétaire général avait décidé, parce que la fille n’avait pas pleuré pendant qu’il l’interrogeait, que le viol n’avait pas eu lieu. Il m’a dit : “Je ne veux pas que vous veniez.” »
Caroline ne l’écoute pas et mène son investigation jusqu’au bout : pour elle, le viol est étayé. Mais elle se retrouve face à une série d’obstructions de sa hiérarchie. À notre connaissance, personne ne sait ce qu’il est advenu du dossier.
Le contrat de Caroline Hunt-Matthes ne sera jamais renouvelé: « Au début j’ai eu le soutien de mes superviseurs et j’ai documenté les obstructions. Au fur et à mesure, ils m’ont lâchée et ont fabriqué une évaluation de performance négative ». Caroline attaque les Nations Unies : le tribunal d’appel, juridiction compétente pour contester les jugements du tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, conclut en 2013 que « la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante était illégale » et qu’il s’agissait bien « d’un acte de représaille ». L’organisation fait appel. L’ancienne fonctionnaire en est aujourd’hui à sa treizième année de procédure, faisant de son cas le plus long de l’histoire de l’ONU.
« Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies [depuis janvier 2017, ndlr] a eu l’opportunité en 2013, en tant que haut commissaire aux droits de l’Homme, d’intervenir et il n’a rien fait. Les jugements en faveur du plaignant pour des représailles sont pourtant aussi rares que des roses sur un iceberg », estime-t-elle. Depuis 2011, son cas fait jurisprudence et il n’est plus possible de faire appel d’une décision du bureau de l’éthique, qui lui a aussi refusé tout soutien. Caroline Hunt-Matthes comparaîtra à nouveau en mars 2017 pour une énième audition au tribunal du contentieux administratif de l’ONU.
Mis à l’écart, les lanceurs d’alertes se retrouvent souvent acculés. Les faits qu’ils dénoncent, qui peuvent concerner des cas d’abus, d’obstruction ou de corruption, passent parfois au second plan.
« L’attention médiatique se concentre sur les cas de représailles des lanceurs d’alerte plutôt que sur les affaires d’abus sexuels, c’est le danger », reconnaît Kathryn Bolkovac, policière américaine qui avait révélé un trafic de femmes en Bosnie orchestré par des membres de l’ONU en 1999. « Ça devient une distraction mais ça fait aussi partie de la prise de conscience, ça illustre le système de corruption mis en place ». Pour un lanceur d’alerte médiatisé, combien n’osent pas prendre la parole ou ont été écrasés par la machine ? De la prévention à la condamnation, les procédures sont longues et fatigantes, dans une zone de droit floue dont il est très compliqué de saisir les règles du jeu. Ces dysfonctionnements remontent jusqu’au sommet de la pyramide.
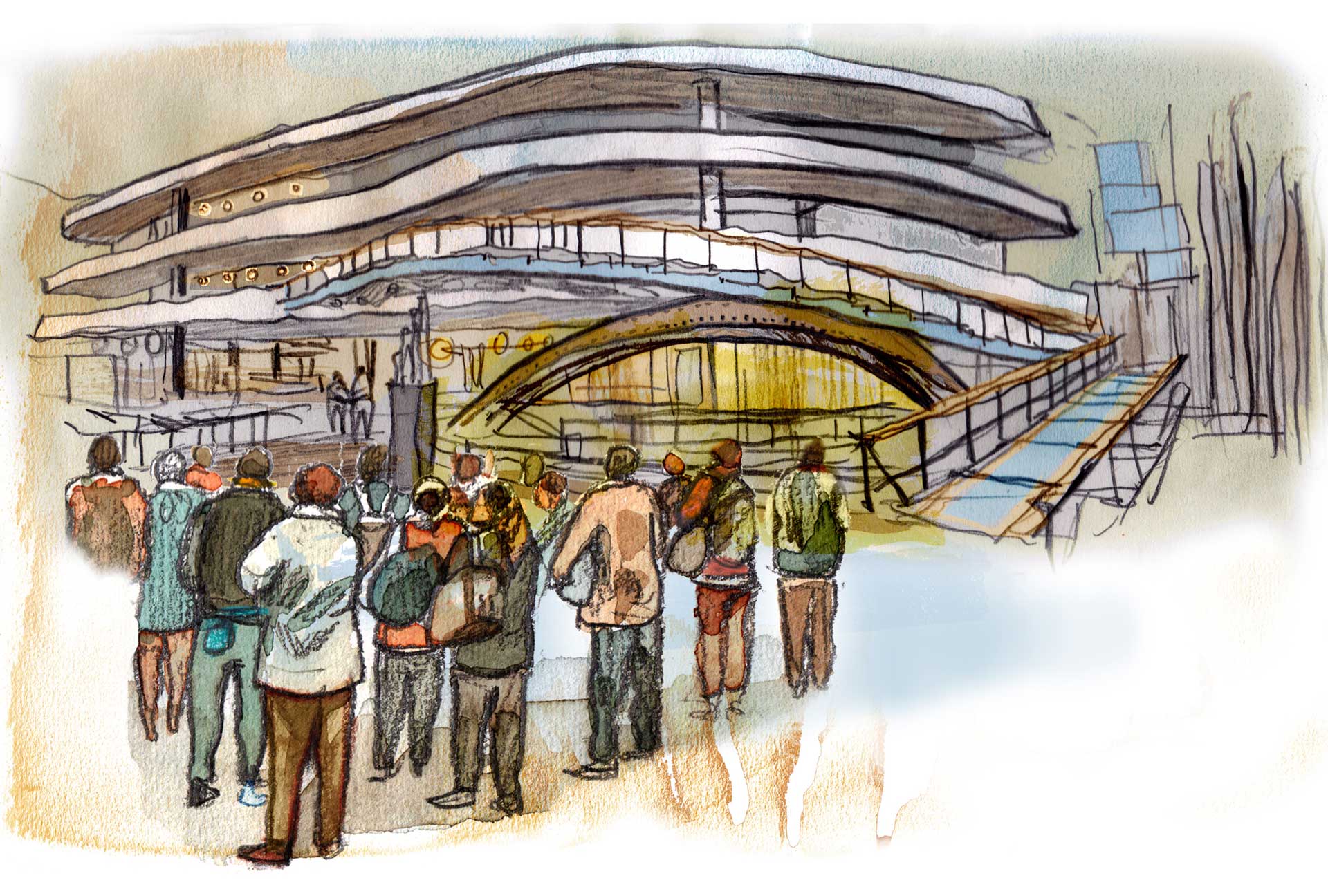
La faute des États contributeurs ?
Susanna Malcorra, cheffe de cabinet de Ban Ki-Moon, s’inquiète, dans un câble confidentiel du 9 juin 2011 que nous nous sommes procuré, d’investigations menées « avant même de prévenir les États membres, et que de telles allégations sont parfois non reportées avant d’être achevées par les missions ». Autrement dit l’ONU aurait mené des enquêtes de son côté sans prévenir l’État contributeur. Ce qui est parfaitement irrégulier. Plus grave encore : les enquêtes internes de l’ONU pouvant durer plusieurs mois (seize en moyenne), en ne prévenant pas les États, ceux-ci n’étaient donc pas en mesure de mettre les éventuels agresseurs hors d’état de nuire. Nous obtiendrons comme commentaire de la part du Département des opérations de maintien de la paix : « Dans notre procédure standard, nous faisons une évaluation avant de notifier les États membres, ce qui peut parfois être confondu avec une enquête par certaines personnes ».
L’organisation a-t-elle choisi de faire du zèle, pour faire le moins de bruit possible, ou pour éviter, en cas de faits avérés, le retrait des contingents impliqués ?
Ce nouvel aveu d’inaptitude à respecter les procédures contrarie la principale défense de l’organisation : elle aurait mains et poings liés et dépendrait uniquement du bon vouloir de ses États membres. Jack Christofides, haut fonctionnaire du Département des opérations de maintien de la paix, n’en démord pas :
« Même quand nous trouvons quelqu’un de coupable, il n’y a pas grand chose que nous puissions faire, car nous manquons de moyens dans le mécanisme de sanctions ».
Manque de moyens ou manque de volonté ? La « real politik » n’est pas absente des rangs onusiens, bien au contraire. Avec un besoin de plus en plus grand de troupes – le personnel de terrain a doublé en dix ans –, l’ONU tente de garder de bonnes relations avec les pays contributeurs. Ça a été le cas en Haïti en janvier 2012, quand des soldats pakistanais de la Minustah sont arrêtés à Gonaïves, pour le viol d’un jeune garçon de 13 ans, handicapé. Les autorités haïtiennes souhaitent lever l’immunité – décision que seul le secrétariat général de l’ONU peut prendre – et juger les accusés dans une cour martiale locale. Mais le garçon disparaît. Il est retrouvé peu de temps après. Une source haut placée du Bureau d’enquête interne nous a confié :
« Nous savions que le commandant de la mission de la paix avait donné lui-même l’ordre de kidnapper le garçon ».
Lors d’une réunion à laquelle assiste Hervé Ladsous, secrétaire général adjoint aux opérations de la paix, Ban Ki-Moon, en tapant du poing sur la table, aurait lancé : « Il nous faut plus que les soldats qui ont violé le garçon. Il nous faut atteindre le commandement qui a fermé les yeux, ou même qui a voulu détruire les preuves et se débarrasser du garçon ». Signe de dissensions internes dans la façon de gérer les affaires, cette source anonyme affirme qu’ « Hervé Ladsous a négocié lors d’un dîner, le soir-même, le rapatriement du commandant, afin qu’on ne puisse pas s’en occuper ». Le chef des missions de la paix aurait répondu, pour se justifier : « C’est politique ».
Hasard ? Le Pakistan, avec ses 7000 soldats, est le deuxième pays fournisseur de troupes onusiennes au niveau mondial. Ni Hervé Ladsous ni ses collègues n’ont aucun souvenir de cette rencontre. Si le service de communication des Opérations de la paix reconnaît bien un voyage en Haïti en janvier 2012, pour une visite de « familiarisation, son agenda n’indique aucun dîner de ce genre ». D’après les informations disponibles, en mars 2012, les Pakistanais impliqués sont jugés coupables par la Cour martiale. Les deux soldats ont été condamnés au pénal à un an de prison. Le commandant, qui aurait commandité l’enlèvement mais qui nie son implication, a pourtant été « interdit de participer à de futures missions de la paix », selon l’ONU.
Résultats : les coupables récoltent des peines symboliques ou inexistantes, comme dans la majorité des affaires qui ne voient presque jamais la couleur d’une cour de justice.
Officiellement, l’ONU compte donc sur les pays contributeurs pour sanctionner les agresseurs. Car une fois l’enquête réalisée, rien n’est joué. La mission doit décider du rapatriement de l’accusé, puis si son pays d’origine le poursuivra. Absence d’enquêteurs internationaux, preuves non admissibles dans des tribunaux nationaux, accès à un avocat quasi impossible pour les victimes, la mise en accusation des soldats fait face à de nombreux obstacles.
Cette impunité s’applique aussi au personnel civil des missions de la paix. Moins médiatisés, ces abus ne se révèlent pourtant pas plus rares. Le rapport d’évaluation du Bureau d’enquête (2015) confirme : « Les civils contribuent de façon disproportionnée aux allégations ». Alors pourquoi n’entend-on parler que des casques bleus ? Camille a une hypothèse : « C’est une autre façon de déplacer l’attention en disant : ce sont des militaires, on ne peut rien faire, ce sont aux États membres d’agir ». Jack Christofides dresse lui un constat de faiblesse, sans répondre à la question : « Si vous êtes un commandant, vous pouvez faire un certain nombre de choses pour améliorer le comportement de vos troupes. Mais pouvez-vous changer l’attitude de personnel civil international ? Pas si facile ». Non, pas si facile quand on sait que les certificats de validation de la formation obligatoire contre les violences sexuelles sont délivrés après quatre modules théoriques de quelques heures. Selon un rapport d’audit de la Monusco en 2015, il n’y avait « aucune trace pour prouver que 39 361 (84%) des 47 214 personnels civils et militaires avaient participé aux cours de formation et de perfectionnement » du groupe de déontologie et discipline. Pire, pour les militaires, la « Monusco n’a pas entraîné 90% des 18 000 militaires sur les violences sexuelles liées aux conflits ».
Que signifie aussi la distribution de 1 694 694 préservatifs rien que pour la RDC au personnel de l’ONU entre 2012 et 2013 ?
Censés être soumis à un filtrage (le Misconduct Tracking System), les militaires coupables de « mauvaises conduites » devraient systématiquement être écartés des futures missions. « Vous savez combien de personnes sont envoyées sur le terrain ? Il n’est tout simplement pas possible de faire une vérification sur une base individuelle », lâche pourtant Jack Christofides.
Ainsi retrouve-t-on en mission « un certain nombre d’anciens rebelles, qui ont été brassés et réintégrés dans des armées nationales [comme c’est le cas en RDC, ndlr], et qui ont commis des atrocités immondes chez eux », déplore Thierry.
« Ce phénomène est extrêmement minoritaire. C’est comme regarder un éléphant en ne s’intéressant qu’à son petit orteil ». En fin d’entretien, Jack Christofides lançait, un peu excédé des questions sur les violences sexuelles : « Jugez-nous sur la façon dont nous empêchons les abus et les punissons ». Dont acte. L’acharnement de l’ONU à préserver son image met les victimes de côté. Perdues dans un dispositif favorisant l’impunité, elles ne connaissent pas leurs droits. Même le Trust Fund, lancé en mars 2016, afin de renforcer l’aide de première urgence accordée aux survivants d’agressions sexuelles commises par des personnels onusiens, semble une chimère. « Ce n’est pas un fond de compensation, précise Sylvain Roy. Mais au moins, elles auront eu un peu d’aide, un peu de nourriture, un abri, des trucs comme ça (sic) ». Dans l’immense hall d’entrée du QG des Nations Unies, les portraits des secrétaires généraux- tous des hommes- nous observent. En nous raccompagnant vers la sortie, l’attaché de presse du département des opérations de maintien de la paix insiste sur les progrès de l’organisation en matière de communication : « On commente publiquement, de façon proactive les questions des violences sexuelles. On annonce les nouveaux cas et ce que nous allons en faire. Beaucoup des informations que vous avez, vous les médias, sont connues parce que c’est nous qui l’annonçons. Pour atteindre un meilleur niveau de confiance… »
Le lendemain, nous recevons un appel de sa collègue pour nous demander de relire et approuver les citations. Des mails font suite à un appel du service de presse qui nous demande de reconsidérer la publication des interviews pourtant accordées. Suivra un nouveau coup de téléphone et encore un email. On l’aura compris, à l’ONU, la transparence a ses limites.