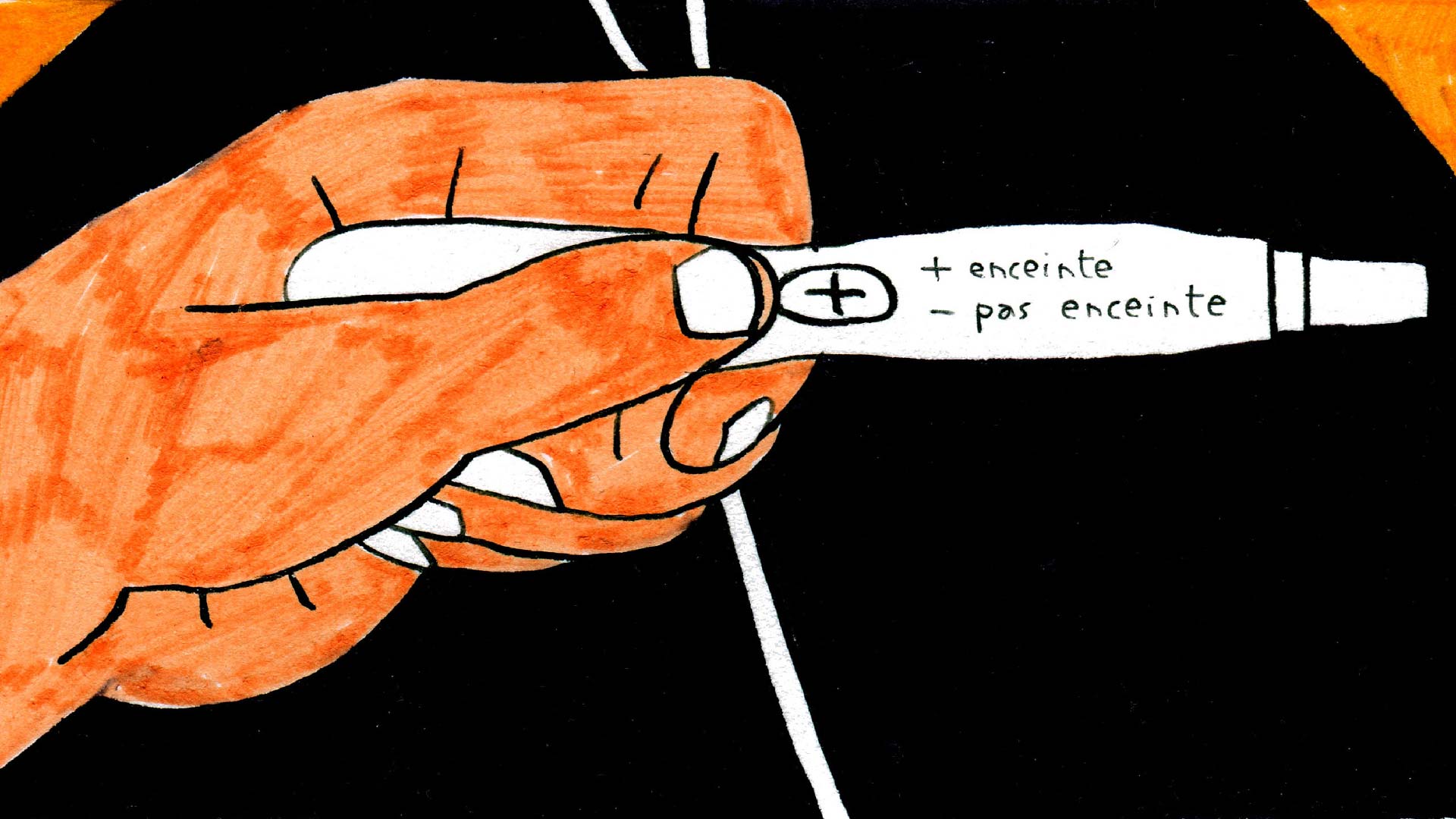Du gynécologue privé au planning familial
Nadia est avec son petit ami depuis quatre ans lorsqu’elle tombe enceinte pour la première fois. À 25 ans, cette femme pleine d’assurance se retrouve désemparée: “Je n’y connaissais rien, à cause de l’absence totale d’éducation sexuelle dans notre société” . “J’étais choquée, j’avais peur de ma famille aussi”, avoue-t-elle.
Nadia connaissait pourtant certains moyens de contraception, mais tout comme son petit ami, Anis*, elle ne savait pas réellement utiliser les préservatifs. “On n’est pas assez éduqué pour utiliser les moyens de contraception” , commente-t-elle. Ne se sentant pas capable d’assumer un enfant, le couple préfère prendre la décision d’avorter. Anis l’accompagne chez une gynécologue privée pour plus de discrétion. Il avait réussi à mettre une somme d’argent conséquente de côté en prévision de l’opération.
Une fois le rendez-vous pris, ils se rendent ensemble au cabinet. “La gynécologue m’a dit que ce n’était pas grave, que je n’étais qu’à deux mois de grossesse seulement”. Mais une fois l’examen médical commencé, la médecin comprend que le couple n’est pas marié. “A ce moment-là, son comportement a changé”, raconte Nadia.
"Elle m’a dit: ‘Non, ne fais pas ça. Essaye de te marier. Ce n’est pas normal.’"
“Sa réaction ne m’a pas plu, je lui ai dit que je n’étais pas prête à devenir mère, que je ne savais même pas si j’avais envie de faire ma vie avec mon petit ami” . La gynécologue refuse alors de la faire avorter et l’oriente vers le planning familial.
Nadia quitte le cabinet avec une lettre de recommandation pour l’espace jeunes du planning familial. Il est écrit qu’il faut lui faire une interruption volontaire de grossesse (IVG) le plus rapidement possible, car elle ne pourra bientôt plus en bénéficier.
Lors de son premier avortement, le psychologue que Nadia a rencontré a commencé à lui faire une leçon de morale, à lui dire que ce n’était pas bien d’avorter, qu’il valait mieux qu’elle épouse son petit ami et garde l’enfant.
Quand une femme souhaite subir une IVG au planning familial, elle doit rencontrer plusieurs personnes avant l’intervention : un psychologue, un gynécologue et des sages-femmes.
Les différents corps de métiers sont là pour s’assurer que la patiente souhaite réellement avorter et l’accompagner tout au long de la procédure.
“Quand une femme souhaite avorter, elle en parle avec le personnel soignant” , explique le Dr. Abderrazak Marzouk, gynécologue privé depuis une trentaine d’années à Tunis. “Elle culpabilise souvent déjà et cherche un soutien auprès du corps médical. Elle peut tomber dans un piège. Les soignants donnent parfois leur avis personnel sans penser à leur rôle médical” . Il ajoute “Le côté moralisateur, il y en a toujours eu un peu” .

“Cette fois, tu vas assumer tes responsabilités”
Quelque temps plus tard, Nadia se retrouve enceinte à la suite d’un accident de contraception, un préservatif qui s’est déchiré. Cette fois, elle se tourne directement vers le planning familial pour procéder à cette nouvelle IVG.
“C’était le même refrain. La psychologue était choquée que je lui demande d’avorter. Elle savait que j’avais déjà eu un avortement médicamenteux, un an auparavan” , raconte-t-elle. “Elle m’a dit: ‘Je ne parle plus avec toi, tu n’es pas une fille normale. Cette fois, tu vas assumer tes responsabilités, on va pratiquer l’avortement chirurgical’” . Idem pour le gynécologue.
“J’ai vécu cette annonce comme une sanction”, raconte Nadia. “Mais comme je ne pouvais pas assumer cet enfant, j’ai fait les analyses pour l’opération” . La jeune femme n’était qu’à un mois de grossesse, et pouvait donc tout à fait bénéficier d’une IVG par voie médicamenteuse.
“Je fais avorter les femmes avec les médicaments jusqu’à 7 semaines de grossesse dans mon cabinet, avec un délai d’une semaine de réflexion”, explique le Dr. Marzouk, qui pratique cette opération depuis plus de 20 ans. “L’avortement médicamenteux est beaucoup plus simple à pratiquer, il n’y a pas de risques. Avec l’avortement chirurgical, il peut y avoir des complications”, commente-t-il.
Sur l’avis d’un autre gynécologue du planning familial, Nadia a finalement bénéficié de l’avortement médicamenteux. “Il m’a dit : ‘C’est ton corps et tu es libre. Je vais te donner les médicaments pour l’avortement, tu es encore dans les délais, pas besoin de passer par la chirurgie’”, se souvient-elle.
Pour autant, les remarques désobligeantes n’ont pas cessé. Une infirmière a ainsi sous-entendu qu’elle était une fille facile, mais Nadia ne s’est pas laissée faire et l’a menacée de poursuites judiciaires.
"Je lui ai expliqué qu’elle n’avait pas le droit de me parler comme ça, que j’étais libre de disposer de mon corps et que j’allais porter plainte contre elle si elle continuait."
Une autre fois, lors de l’échographie de contrôle, on lui a demandé d’attendre trois semaines, que sa grossesse soit plus avancée pour procéder à l’IVG. Les sages femmes lui ont dit qu’elles ne savaient pas si la grossesse était normale ou extra-utérine. “Personnellement, je ne crois pas à cette histoire. Je voyais très bien le foetus, ce délai n’était qu’une punition”. Trois semaines plus tard, elle a pu bénéficier d’un avortement médicamenteux, après avoir eu droit à un nouveau discours moralisateur du personnel médical.
Après une IVG, une visite de contrôle est souvent demandée par les médecins. C’est l’occasion pour eux de discuter de la future contraception de la patiente. Lors de ses premières visites, le personnel médical n’avait rien prescrit à Nadia. Avec son niveau d’études et un emploi, elle ne correspondait pas au “stéréotype” de la femme qui avorte plusieurs fois. “Pour elles, je ne suis pas le genre de femme à qui ça arrive habituellement”.
Mais après ce dernier avortement, les médecins lui ont posé un implant, une moyen contraceptif de longue durée. Nadia a vécu cela comme une sanction. Inséré sous la peau, au niveau du bras, ce n’est pas le type de contraceptif que l’on peut arrêter à tout moment, comme la pilule ou le préservatif.
Pour les premières IVG, Anis, son petit ami, l’a accompagnée au planning familial. Le jeune homme a lui aussi eu droit à son lot de remontrances. “Ce n’est pas normal de faire ça”. “Vous tuez un foetus”. “Essayez de convaincre votre amie de le garder et essayez de vous marier”. “On va vous aider avec ce bébé”. En couple depuis quelques années, ils ne se sentaient simplement pas encore prêts à franchir ce cap.
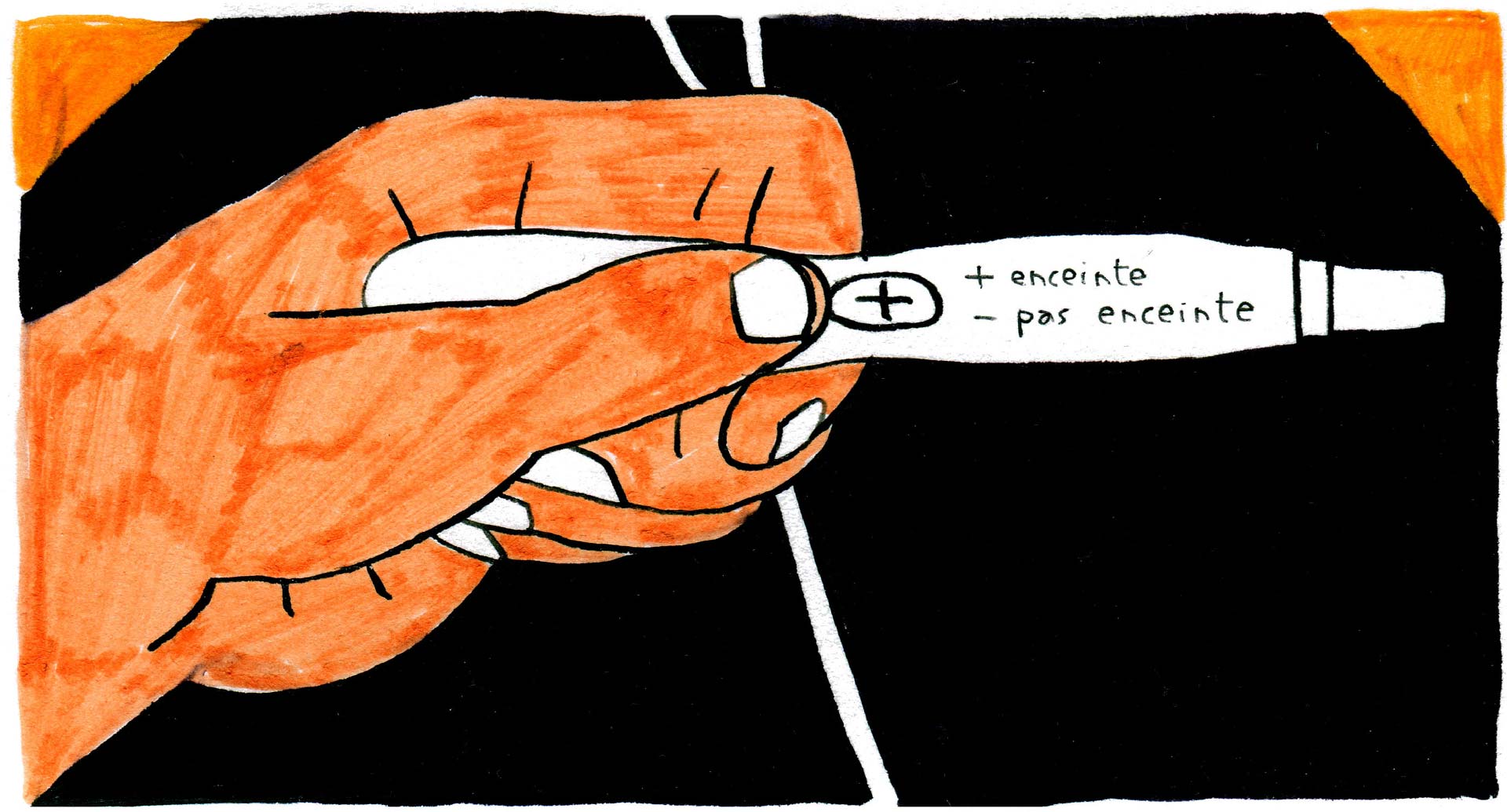
L’influence familiale
Avant de tomber enceinte pour la première fois, Nadia avait peur de perdre sa virginité, c’était un tabou. “Ma famille ne sait rien de tout cela. Et si l’un d’entre eux l’apprend, il va me faire des histoires”.
Nadia s’est finalement mariée avec Anis et, de nouveau enceinte après son union, elle a osé parler de son désir d’avorter à sa belle-mère. “Elle travaille dans un hôpital, et m’a dit qu’elle était prête à m’aider, même de manière illégale, pour que je puisse faire un avortement médicamenteux. Je devais seulement faire les analyses avant”, raconte Nadia.
“Entre-temps, mon père a remarqué ma grossesse. Il nous a mis la pression à mon mari et moi, pour que nous gardions l’enfant”. Sous les injonctions familiales, la jeune femme l’a finalement gardé.
Depuis que Nadia est mariée, le discours moralisateur s’est modéré. Mère d’un petit garçon d’un an, elle est retournée au planning familial pour interrompre une nouvelle grossesse, un vendredi. Que ce soit la gynécologue, la psychologue, ou la sage femme, « toute l’équipe s’est mobilisée pour essayer de me convaincre de le garder”, raconte Nadia.
"Ils me disaient que c’était normal d’avoir peur, que j’étais encore jeune, que les enfants, lorsqu’ils viennent au monde, Dieu leur donne tout ce qu’il leur faut, leur nourriture etc., que ce serait facile."
Nadia a dû se justifier pour défendre son choix d’avorter. Son bilan sanguin prouvant sa santé fragile, sa césarienne trop récente pour avoir un nouvel enfant, ses histoires de couple… “C’est ma vie privée, je ne devrais pas avoir à argumenter de la sorte”, s’emporte Nadia. Après quelques échanges, la gynécologue aurait fini par lui dire: “C’est vendredi et je ne fais pas des choses qui peuvent m’envoyer en enfer, c’est contre la religion”. C’était la phrase de trop pour Nadia. “Je lui ai répondu qu’elle n’avait pas le droit de me refuser ça sur la base de la religion”. “Je n’ai pas peur de la loi, seulement de Dieu” , aurait rétorqué la gynécologue, en lui fixant un rendez-vous pour l’opération le lundi suivant.

Absence d’éducation sexuelle
Si Nadia a vécu ce parcours-là, c’est en grande partie à cause du peu d’éducation sexuelle qu’elle a reçue. Universitaire de formation et issue de la classe moyenne, sa famille lui a toujours dit depuis qu’elle est enfant: “Tu es l’aînée de cette famille. Dans la vie tu dois t’occuper d’une chose: rester vierge avant le mariage” , le reste était tabou à la maison.
Pour le Dr. Marzouk, il n’y a pas assez d’informations sur la sexualité en milieu scolaire. Même si cet enseignement existe “théoriquement” , “il n’est pas toujours bien fait, car c’est dans le cadre des sciences naturelles” , déplore le médecin. “Normalement, on peut consulter les infirmiers et les sages-femmes présents dans l’établissement sur le sujet, mais souvent les femmes n’ont pas une connaissance suffisante des moyens de contraception,” précise-t-il.
“L’objectif de la contraception, c’est justement d’éviter l’avortement (mais) si je n’étais pas tombée enceinte, je n’aurais jamais su toutes ces choses-là”, confie Nadia.
Après une IVG, chaque patiente discute de contraception avec les médecins. “Au planning familial, ils peuvent imposer une contraception, comme la pilule injectable, qui fait effet trois mois” , raconte le gynécologue, “Dans le secteur privé, on peut seulement conseiller la patiente” .
“Normalement on aurait pu s’attendre à une baisse du nombre d’avortements depuis le développement des moyens de contraception, mais ce n’est pas le cas” , regrette le Dr. Abderrazak Marzouk. Le gynécologue estime entre 12 000 et 15 000 le nombre d’avortements effectués en Tunisie chaque année. Selon l’Organisation Nationale de la Famille et de la Population (ONFP), près de 16 000 femmes ont avorté en 2015.
Le cadre légal
Le droit à l’avortement, sans conditions, est défini par l’article 214 du code pénal, amendé en 1973:
« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. L’interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu’elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l’interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d’être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l’enfant à naître risquerait de souffrir d’une maladie ou d’une infirmité grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet. L’interruption visée à l’alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d’un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer la dite interruption. »