Article 1er de la loi n°88-95 du 2 août 1988 relative aux archives
Dans les recoins des Archives nationales à Tunis, parmi les innombrables pièces de tri des documents envoyés quotidiennement par les ministères et les administrations, ajoutés aux 20.000 kilomètres d’archives, deux jeunes, une fille et un garçon lisent en silence. Ils ne révisent pas un examen et ne planchent pas sur une thèse. En plein mois de juillet 2015, ces deux jeunes Tunisiens sont en train de consulter les archives du RCD, l’ancien parti du dictateur Ben Ali.

“Vous ne pouvez pas leur parler sans l’accord de l’IVD mais comme vous voyez, ils travaillent dur ”, chuchote Hedi Jalleb le directeur des Archives nationales. Dans une autre pièce, on apporte des cartons auprès d’autres jeunes qui ouvrent avec précaution les classeurs et dossiers. Sur l’un des paquets éventrés, on peut lire écrits en grosses lettres au stabilo noir “ATCE”, le nom de l’ancienne agence de propagande médiatique de Ben Ali. Pas le temps d’épier plus, la porte se referme, les trouvailles de ces recherches doivent servir à compléter, vérifier ou prouver les 16 500 dossiers (ndrl: chiffres mis à jour le 2 octobre) de plaintes déposés à l’Instance. Elles permettront aussi dans certains cas que l’IVD statue directement sur des affaires qui ne relèvent pas forcément du judiciaire (commission d’arbitrage par exemple). Le travail ne fait que commencer, il sera long et ardu.
“Aujourd’hui il faut tout consulter, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin pour reconstituer le puzzle de la dictature. L’IVD travaille avec l’aide des archivistes des Archives nationales mais après il faut recouper les informations, une archive n’est pas la preuve écrite noir sur blanc d’un crime ou d’une corruption” commente Hédi Jalleb.
Pour Narges Dabech en charge du service des archives à l’IVD, le plus dur pour l’instant reste la période temporelle que l’IVD doit couvrir, plus d’un demi-siècle sur un mandat de 4 ans.
“Les archives produites durant cette période qui dépasse les 58 ans représentent des kilomètres de documents. Ce qu’il faut noter c’est aussi le désordre de ces archives, un désordre voulu par les producteurs afin de camoufler des réalités et c’est aussi cet élément qui rend la tâche difficile.”

La question des archives de la police politique
C’est pourtant bien ce travail minutieux qui pose l’un des piliers du travail de mémoire et de justice en Tunisie. Pour comprendre le chantier des archives de la dictature en Tunisie, il faut remonter quatre ans en arrière quelque temps après la révolution où, dans l’espace clos du théâtre El Teatro à Tunis, Farah Hached présidente de l’association le Labo démocratique, organise une rencontre inédite sur la question des archives et notamment celle des archives de la police politique.
A l’époque, dans cet espace feutré aux airs de salle de cinéma, on parle de la police politique comme d’un des grands mystères non résolus de la dictature. Des invités, militaires et représentants des droits de l’homme comme Mokhtar Trifi côtoient d’anciens ministres tels que Lazhar Akremi et Taieb Baccouche, aujourd’hui au sein du gouvernement.
Chacun échange librement sur le sujet, les langues se délient pour la première fois. Mais les archives sont impalpables, personne ne sait ou ne veut révéler l’endroit où elles se trouvent, personne ne connaît leur ampleur. Elles symbolisent l’un des rouages du fonctionnement du régime de Ben Ali et surtout le système parallèle mis en place pour espionner et harceler ses opposants.
“Nous avions réalisé un film documentaire pour ouvrir le débat et à l’époque déjà, nous n’avions aucune base de référence pour parler de cette question, il fallait que les personnes interviewées, militants politiques ou associatifs, expliquent concrètement ce qu’était la police politique” témoigne le journaliste Thameur Mekki, co-réalisateur de Memory at risk, un film produit par le labo démocratique pour le débat.
Ce sont d’ailleurs les mots de Fahrat Rajhi ancien ministre de l’Intérieur qui ouvrent le documentaire et définissent la police politique:
"Ce qu’on appelle police politique sont les agents de sûreté qui se chargent d’enquêter sur les affaires à caractère politique. Ceux qui commettent des crimes de droit commun sont jugés selon le code pénal et ceux qui sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’état ou au régime qui gouverne le pays. C’est ce qui lui donne un aspect politique et c’est pour ça qu’on appelle les agents qui s’en chargent de police politique."
A l’époque, le plus important n’était pas le contenu des archives mais leur préservation et leur traitement via un cadre juridique.
"Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a plusieurs types d’archives tout comme il y a deux types de réseaux d’informateurs sous Ben Ali : la chaîne d’informateurs du parti et la chaîne d’informateurs de l’appareil étatique qui remonte jusqu’au président. Il y a un fantasme de l’état-parti qui s’est construit par exemple alors que les deux étaient assez distincts. Ben Ali compartimentait à l’extrême car il avait peur de la prédominance du parti et il centralisait tout. Le modèle est un peu celui d’une toile d’araignée", commente Farah Hached.

Outre le travail en cours de l’IVD, l’association de Farah Hached travaille depuis trois ans sur la mémoire et la sensibilisation du citoyen à la question. Le Labo’ démocratique a ainsi publié un recueil de trois volumes intitulés Révolution tunisienne et défis sécuritaires. Trois livres pour vulgariser la notion de police politique et montrer comment fonctionnait le système sécuritaire tunisien sous la dictature.
"Nous savons qu’il y a des archives mais nous n’avons pas demandé à les regarder individuellement, je suis contre cette idée, il faut que tout soit cadré."
Dans le premier tome consacré aux archives, les auteurs établissent un classement et une définition:
"Archives de la Présidence de la République, archives du ministère de l’Intérieur, les archives du RCD, de l’administration ou encore des structures informelles. Parmi ces archives , les "archives de la dictature" sont définies comme des "documents ayant servi la stratégie consistant à installer, renforcer et perpétuer la dictature". Par exemple, les archives sécuritaires qui en démocratie sont supposés garantir la sécurité humaine, prennent une autre ampleur sous la dictature et servent d’instrument de chantage ou de répression: écoutes téléphoniques, espionnage, etc.", (p.33 du livre).

Les livres sont également des recommandations avec des axes de réforme en coopération avec le ministère de l’Intérieur et d’autres institutions à l’époque où le magistrat Lotfi Ben Jeddou était en fonction. Le ministère de l’Intérieur a accepté d’envoyer une délégation d’une douzaine de personnes de tous les services du Ministère dont les services spéciaux pour collaborer. “Il n’y a pas eu de réticence à venir nous parler mais nous n’avons pas abordé des questions de secret défense”, ajoute Farah Hached.
Faute de pouvoir réellement étudier le contenu de ces archives, la recherche d’un cadre juridique est alors mis en place, mais en parallèle, la transition commence et la question des archives revient dans le débat public et surtout politique.

La question des archives dites “sensibles”
Après le 14 janvier 2011, les archives de la présidence ont été pillées de même que le local Botzaris, du RCD en France. Sans compter les différents locaux rcdistes qui ont été brûlés ou encore les cartons emmenés pendant la nuit hors de certains tribunaux.
“Il y a eu aussi 13 tribunaux et des locaux des recettes des finances brûlés, 300 postes de polices et des municipalités incendiées. Mais dans ces endroits, il n’y a pas vraiment eu de pertes notables au niveau des archives puisque tout était regroupé dans les ministères et centralisé.”
Pour Hédi Jalleb, le plus difficile aujourd’hui est de définir ce qu’est une archive de la police politique. “Une archive est ce qui est produit par un fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction, la plupart des surveillances, des actes de corruption ou même les dérives policières n’étaient pas “enregistrées” à proprement parler ou écrites tel quel sur des papiers.”
Sur ce point, les versions divergent. Certains survivants de la torture comme Rached Jaidane ont souvent témoigné des méthodes de leurs bourreaux. “Un médecin faisait un faux acte de décès, attestant de notre propre mort, c’était une méthode de pression.” Que sont devenus ces papiers? Y-avait-il un inventaire de ces registres et autres documents attestant de la torture en Tunisie? Difficile de le savoir encore aujourd’hui.
L’autre exemple de “preuve” de l’existence d’archives de la police politique reste la vidéo de l’ancien ministre de l’Intérieur nahdaoui Ali Larrayedh fuitée sur internet en janvier 2012 alors qu’il était en poste. Cette vidéo filmée en 1991 pendant qu‘il était en prison en train d’avoir une relation homosexuelle avec un prisonnier. Ce genre de vidéo était produite par le régime puis envoyée à plusieurs personnes pour discréditer les opposants politiques et ensuite, elles étaient volontairement fuitées dans des journaux de propagande pour créer le scandale.

Selon un ancien opposant de Ben Ali, Ahmed Manai, il s’agissait d’une “politique du porno” orchestrée par la propagande.
La diffusion de cette vidéo 20 ans après, au moment où Ali Larrayedh menaçait certains caciques du Ministère de l’intérieur d’arrestations, a montré l’existence d’une “base” d’archives de la police politique, volontairement conservée comme moyen de pression ou de chantage politique.
Il faut aussi remonter à l’affaire Samir Feriani, un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur arrêté en mai 2011 après avoir révélé dans un article de presse les agissements de certains cadres du ministère dans les premiers mois de la révolution. 29 chefs d’inculpation, plus de cinq mois de prison et un procès très médiatisé pour l’une des premières personnes à avoir brisé l’omerta du ministère de l’Intérieur. Il avait aussi déclaré que “certaines archives ont été brûlées” et que certains cadres du ministère avaient volontairement brûlé les archives de l’OLP.
A Paris, en juillet 2011, une avocate et un activiste disaient avoir récupéré également des documents attestant de la mise sous surveillance de journalistes et d’opposants politiques à Ben Ali. Ils prétendaient avoir récupéré les archives dans le local de Botzaris sans vouloir dévoiler leur contenu. Que sont devenus ces documents aujourd’hui tout comme l’avocate et l’activiste qui semblent avoir disparu dans la nature?
En décembre 2013, Moncef Marzouki, alors Président de la République décide de publier un livre noir donnant des noms, d’après les archives de la présidence, de personnes impliquées dans la dictature et dans sa propagande.
Le procédé qui prend des allures de règlements de comptes remet au centre du débat public, la question de la justice transitionnelle. Aujourd’hui, malgré la promulgation d’une loi et la mise en place d’une instance, l’ouverture des archives “sensibles” se fait attendre.
Dans ce contexte rien n’a garanti la préservation des archives de la dictature, le débat porte donc sur l’urgence d’ouvrir celles encore existantes afin de faire la lumière sur les crimes du passé et de rétablir une certaine vérité.
Avec la loi sur la justice transitionnelle votée en 2013, l’Instance devait pouvoir prendre en charge ce dossier épineux. Or, la résistance se fait sentir au sein des Ministères et de la Présidence qui aurait en sa possession plus de 15.000 archives.

Un accès restreint pour le citoyen
Cette résistance politique au traitement des archives est aussi due à une méconnaissance de leur importance par l’élite politicienne mais aussi par les citoyens.
Si la Tunisie était l’un des pays précurseurs dans le monde arabe en matière de systématisation et de collectes des documents dans un but d’archivage (1874), le système se délite dans les années 70 avec un manque de compétences et d’archivistes qualifiés selon l’historienne Houda Ben Hamouda.
Ce n’est qu’en 1998, après le lancement d’une politique nationale autour des archives qu’un bâtiment, naît boulevard du 9 avril, remplaçant la salle de Dar-El Bey à la Kasbah avec une réelle organisation de l’archivage en Tunisie. Elle faisait même l’objet d’une propagande du régime pour vanter ses mérites à préserver une mémoire collective.
Comme en témoigne l’historienne, en tant que chercheuse et citoyenne, elle est souvent confrontée lors de ses demandes d’accès aux archives, soit à une méconnaissance du règlement soit à une confusion. “ En 2011, la réponse fut unanime: il n’ était pas possible dans l’état actuel des choses de consulter des archives récentes”, une réponse infirmée par le directeur des archives lui-même qui lui déclare que les archives postérieurs à 1956 sont accessibles. “Or une fois arrivée sur place, le personnel de la salle de consultation me tient le discours connu, selon lequel il n’y a pas d’archives postérieures à l’indépendance.”
L’absurdité du décalage entre le discours du directeur et des employés montre bien le manque de sensibilisation des citoyens à l’utilisation et à la consultation des archives publiques. Ce problème perdure encore aujourd’hui avec les archives de la dictature, comme en témoigne Hedi Jalleb:
“Elles ne seront de toute façon jamais libres d’accès pour le citoyen lambda surtout en ce qui concerne la sécurité intérieure ou d’autres sujets de ce genre, ce ne sont pas comme les archives de la STASI en Allemagne. Nous ne sommes pas dans un régime comme celui de l’ Allemagne de l’est, ici l’ état n’a pas disparu ou en tout cas le système qui régissait tout cela et la loi n’a pas changé. Donc la seule instance apte à y avoir accès, c’est l’IVD”, ajoute Hedi Jalleb.
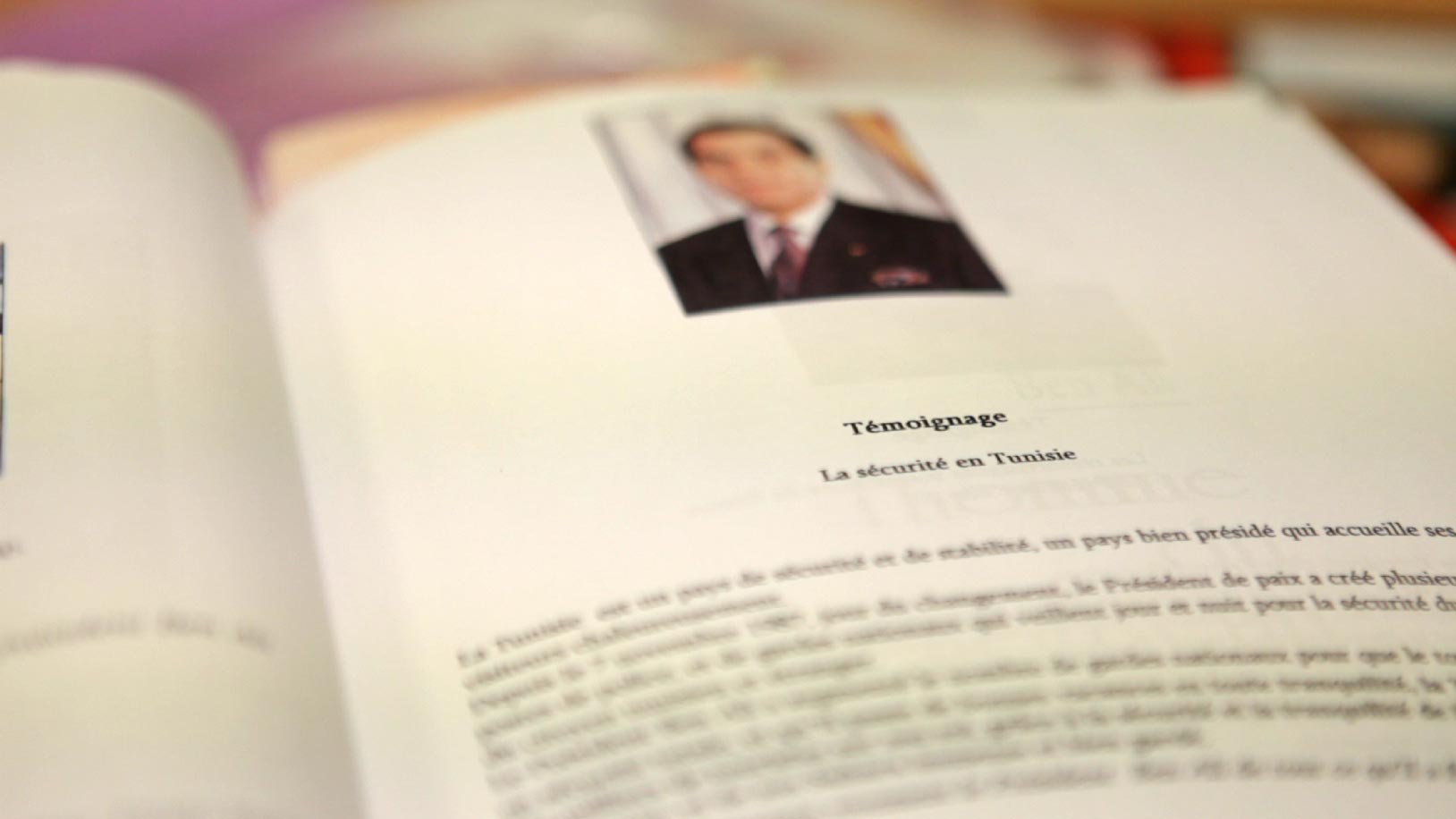
Dans la loi du 2 août 1988 relative aux archives, il est en effet dit que la communication des archives publiques ne peut se faire qu’au bout de trente, voire soixante ans.
“Jusqu’à aujourd’hui encore par exemple, nous ne pouvons pas consulter les archives de la sûreté nationale de la période de l’indépendance” conclue Hédi Jalleb.
L’Instance elle par contre, peut travailler en toute liberté selon l’article 40 de la loi sur la justice transitionnelle. “Pour s’acquitter de sa mission, l’Instance est dotée des attributions suivantes : – Accéder aux archives publiques et privées, abstraction faite de toutes les interdictions prévues par la législation en vigueur.”
Mais la légitimité de l’IVD dans la loi n’est pas suffisante pour contourner les résistances de certains. Dans un dossier sur la justice transitionnelle, Sihem Ben Sedrine avait confié avoir encore des difficultés avec certains ministères:
“Avec le nouveau ministre de l’Intérieur, la porte est complètement fermée. L’argument de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme est le prétexte pour fermer l’accès à tout.”
Pour Narges Dabech, l’accès aux documents des archives nationales constituent déjà un atout suffisant pour commencer les recherches : “ Les violations des droits de l’Homme ne concernent pas seulement la torture ou les viols, cela concerne aussi les violations du droit à l’expression, du droit au savoir, du droit de la propriété, C’est pour cela qu’on peut trouver ce qu’on cherche dans des archives autres que les archives du Ministère de l’Intérieur.”
Hedi Jalleb confirme aussi ne pas toujours recevoir tous les documents aux archives nationales: “Le Ministère de la justice verse des choses comme les registres des notaires ou d’état civil mais pas sur les affaires politiques. Tout comme le Ministère de l’Intérieur qui nous envoie des archives administratives mais rien d’autre.”
Le risque d’instrumentalisation
Ces difficultés s’ajoutent à une actualité tunisienne, tourmentée entre le besoin de tirer un trait sur le passé avec un projet de loi sur la réconciliation et la nécessité d’une justice. Pour Thameur Mekki, le problème n’est pas tant de sensibiliser mais aussi de faire attention à l’instrumentalisation des archives:
“On a vu que ce soit avec le livre noir de Marzouki tout comme avec les personnes interviewées pour Memory at risk, que les traces de la dictatures étaient parfois de fausses archives manipulées pour organiser de “fausses fuites” sur telle ou telle personne, donc le travail de vérification et de recoupage est très important et pas forcément acquis dans les médias tunisiens.”

D’autres organismes comme l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI) ne livreront quant à elles peut-être jamais leurs secrets puisque la cybersurveillance n’était pas à proprement parler “archivée”. L’autre grand possesseur des archives reste la télévision nationale qui détient tous les droits sur les journaux TV et autres émissions diffusées depuis sa création.
L’enjeu des archives reste donc important en Tunisie à l’instar de pays comme la Pologne ou l’Allemagne qui ont mis en place des procédés afin d’utiliser les archives soit pour mieux faire connaître au public les mécanismes de l’ancienne police secrète (Allemagne) soit pour informer sur le passé d’un citoyen qui souhaite se présenter dans un parti par exemple, via le procédé de la lustration (Pologne). D’autres pays comme le Guatemala ou le Paraguay ont obtenu l’ouverture de leurs archives grâce à des actions citoyennes et activistes.
En Tunisie, l’une des seules avancées dans ce sens, à part la mise en place de l’IVD reste l’article 32 de la constitution et le décret N° 41 du 26 mai 2011 relatif à l’accès à l’information. Mais ce décret est en partie remis en cause dans le nouveau projet de loi sur l’accès à l’information en cours de discussion à l’assemblée (discutée en commission de mars 2015 à juin 2015) notamment dans les nombreuses exceptions prévues par la loi où ce droit ne s’applique pas.
"La question qui se pose aujourd’hui mis à part l’analyse des archives par l’IVD: est-ce qu’un citoyen tunisien peut demander à accéder à son dossier des services spéciaux de l’époque de l’ancien régime si les informations qui y sont contenus ne concernent pas la sécurité nationale? En cas de refus ou d’absence de réponse, peut-il utiliser le décret-loi sur l’accès à l’information à l’appui d’un recours auprès du tribunal administratif pour accéder à son dossier? Quelle serait la décision du tribunal? Pour l’instant, ces questions restent ouvertes", conclut Farah Hached.
Cinq ans après la révolution, l’ouverture des archives semble encore un sujet tabou en Tunisie.D’autres croient au processus de justice transitionnelle comme la famille de Salah Karker l’un des fondateurs d’Ennahdha qui s’est exilé en France pendant plus de 20 ans.
La famille de Salah Karker, décédé en 2012, a préparé un dossier pour l’IVD. Pour son fils Amin, qui réside en France, l’accès aux archives est un des points importants pour la mémoire :
"Nous avons tenu à déposer un dossier car nous pensons que le cas de notre père est un dossier symbolique qui se devait d’être traité, pour honorer sa mémoire, mais aussi pour les milliers de victimes qui n’auraient pas pu déposer un dossier ou dont le dossier n’aura malheureusement jamais de suite. Car c’est bien le but de cestravaux, conserver une mémoire nationale et faire en sorte que ces horreurs de la dictature que ces milliers de victimes ont subies du fait de leur opinion politique ne se reproduisent plus à l’avenir".




