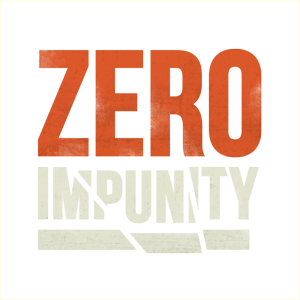Les récits de viols et de tortures sont lus à haute voix, le 29 août, devant le cabinet des ministres de Kiev, par des activistes et victimes de la guerre qui n'ont jamais obtenu justice. Oleksandra Matviychuk est leader du Center for Civil Liberties et de Euromaidan SOS, association qui documente les exactions commises depuis 2014.
Sur le même sujet
Elle se tient debout, six autres manifestant·es à ses côtés. Pancartes dans les mains, pieds ancrés dans le sol, ils et elles se tiennent face aux journalistes et dos à l’imposant bâtiment blanc dans lequel leur proposition de réforme du Code Criminel est coincé depuis plus d’un an. Oleksandra Matviychuk s'impatiente.
“Ça fait cinq ans que le conflit dure et on ne peut toujours pas condamner les crimes de guerre. Des milliers de victimes attendent cette loi, elle peut amener la justice !
Ce texte, rédigé par des expert·es de la loi internationale, pourrait donner des outils et un cadre juridique efficace pour condamner ces crimes de guerre. Car le problème, explique Nataliya Pylypiv, coordinatrice au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (OHCHR), c'est qu' “il y a trop de vides juridiques dans le Code Criminel Ukrainien (CCU) actuel. C’est toujours celui du temps soviétique, même s’il a été amendé plusieurs fois, il ne l’a jamais été au point de s’adapter à la réalité d’un conflit armé”.
Des vides juridiques qui font que, depuis 2014, début du conflit entre les pro-russes et les pro-ukrainien·nes, l'Ukraine se montre incapable de condamner les crimes de guerre qui s'accumulent. Dans cette nouvelle version du Code Criminel Ukrainien (CCU), inspirée du code criminel international, les crimes de guerre seront clairement définis, ils comprendront les violences sexuelles, et les crimes contre l’humanité seront reconnus.
“Le 25 août, une source interne au ministère de la Justice nous a dit que notre projet de loi allait enfin passer au cabinet des ministres le lendemain pour être évalué”, reprend Oleksandra Matviychuk. “Mais plus tard dans la journée, cette même source nous a dit que ça allait encore une fois être reporté !” Lassée d'attendre, en l'espace d'une nuit, l’activiste réunit victimes, proches de victimes et activistes pour se faire entendre par le cabinet des ministres.
Cette manifestation a lieu un an après le dépôt de leur projet de loi, une réforme du Code Criminel qui permettra de condamner les crimes de guerre correctement. Elle fait suite à la publication des articles de Zero Impunity, qui a mis la lumière sur les crimes sexuels dans le conflit Ukrainien en 2017. En collaboration avec Oleksandra, l'équipe de Zero Impunity a mis en ligne une pétition, signée par 38.307 personnes, pour que le Code criminel ukrainien (CCU) soit réformé.
Les réalisateurs Stéphane Hueber-Blies et Nicolas Blies, porteurs et créateurs du projet Zero Impunity, accompagnés de l’artiste-vidéaste Olivier Crouzel, Oleksandra Matvietchuk et son équipe ont aussi projeté des vidéos de témoignages de victimes de violences sexuelles sur plusieurs bâtiments, à Kiev, et dans d'autres villes en Ukraine, pour attirer l'attention des politiques.
La manifestation fait suite, aussi, à des années de réécriture du CCU par des juristes expert·es du droit international, et à des années de négociations avec les ministères de la Justice, puis des Affaires étrangères, pour faire avancer les choses et mettre en place un cadre légal fonctionnel. Mais toujours, les changements se font attendre.

Crimes de guerre en toute impunité
Cinq ans après le début du conflit armé, la coordinatrice au OHCHR Nataliya Pylypiv, voit toujours des victimes lui dire qu’elles n’ont pu obtenir justice, malgré leurs plaintes déposées à la police.
Et pourtant, “depuis 2014, la situation n’a pas changé. Des civils sont toujours emprisonnés et torturés. Il y en a moins, mais le pourcentage des personnes atteintes de violences sexuelles reste le même”, explique Anna Mokrousova. Elle travaille à l’association Blue Bird, qui apporte de l’aide psychologique aux victimes du conflit Ukrainien.
Depuis 2014, la guerre entre les forces ukrainiennes et les républiques séparatistes pro-russes a fait plus de 10.300 mort·es.
Entre 2014 et 2016, quand le conflit était le plus violent, l’association recevait entre une et quinze victimes par jour. Maintenant que les républiques séparatistes sont plus stables, que les forces armées mieux organisées, “c’est plutôt une à deux personnes par semaine”, dit Anna Mokrousova, mais les faits restent identiques.
Menaces de viols, viols, électrocution des parties génitales, les violences sexuelles comme arme de guerre, envers les civil·es ou les dissident·es, sont toujours utilisées dans les lieux de détention des deux côtés de la ligne de front. D’après le dossier “ War without rules : Gender-Based Violence in the Context of the Armed Conflict in Eastern Ukraine”, fait par la Coalition for Peace and Justice in Donbas en 2017, une personne sur quatre qui sort de détention a subi des violences sexuelles.
L'OHCHR a lui aussi consacré un rapport à ce sujet la même année, il arrive au même constat. “La majorité des cas documentés par l’OHCHR montrent que les violences sexuelles ont été utilisées comme méthode de torture et de mauvais traitements dans le contexte de détention liée au conflit armé dans l'est de l'Ukraine, ainsi que dans la République autonome de Crimée”, explique le rapport.
Nataliya Pylypiv, qui l’a coordonné, ajoute qu’en plus de ces violences en détention, ces exactions arrivent aussi dans d’autres contextes, plus difficiles à documenter : aux check points, et le long de la ligne de front, dans les zones où les civil·es et les militaires cohabitent.
En cause, pointent les activistes, les vides juridiques dans le Code criminel ukrainien, qui n'englobe pas les violences sexuelles ni les crimes de guerre, et empêche les enquêtes et poursuites judiciaires. La définition actuelle des crimes de guerre, dans les articles 437 et 438 du CCU, est extrêmement vague et ne comprend pas les violences sexuelles.
En ce qui concerne les crimes contre l’humanité et selon l’article 7 du statut de Rome, des crimes commis sur ordre et “dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile”, ils sont simplement inexistants.
Alors, “les rares cas qui passent en justice sont traités comme des viols ou des tortures ordinaires, pas comme des crimes de guerre”, explique l’activiste Oleksandra Matviychuk.
Or, enquêter sur les violences sexuelles en Ukraine en temps de paix n'est déjà pas une tâche évidente. En effet, l’article 152 du CCU, définissant le viol, ne considère ce crime qu’entre personnes de deux sexes différents, si un corps étranger (non objet) est introduit de manière forcée par voie vaginale.
Entre personnes de même sexe, ou si le viol est commis par voie anale, ce n’est plus considéré comme un viol, le crime tombe sous l’article 153, “satisfaction forcée d’un désir sexuel de manière non naturelle”.
Depuis, une nouvelle version est désormais en vigueur. L’article 152 prend désormais en compte comme viol tous types de pénétrations, aussi entre personnes de même sexe et avec des objets. Et en ce qui concerne les violences sexuelles au sens plus large, comme les menaces à caractères sexuels ou le harcèlement, continue la coordinatrice de l’OHCHR, “elles n’existent pas”.
Maxim Komarnitsky est procureur au département des crimes de guerre au bureau du procureur général militaire. La majorité des cas qu’il traite sont des exactions commises par des criminel·les séparatistes dans les Républiques de Donetsk (DNR) et de Lugansk (LNR).
Si c’est déjà compliqué d’enquêter sur la torture par manque d’accès à ces territoires, dit-il, “c’est au moins dix fois plus difficile de poursuivre pour violences sexuelles. S’il n’y a pas de déchirure au niveau génital, c’est presque impossible.”
En cas de torture physique, les marques restent sur le corps plus longtemps, permettent donc un examen médical au retour des ex-détenu·es sur le territoire contrôlé par le gouvernement.
Mais en cas de poursuites pour viol, il faut deux éléments. Prouver, par un test physique, qu’il y a eu pénétration par un examen médical fait au maximum 36 heures après les faits. “En cas de détention, c’est impossible : la victime n’a aucun accès à un médecin et le temps qu’elle rentre sur le territoire pro-gouvernemental, c’est généralement trop tard pour trouver des traces”, continue Maxim Komarnitsky.
Le deuxième élément requis est la preuve physique du non consentement et du caractère “impuissant” de la victime. En pratique, ça veut dire que “seulement les bleus ou les traces physiques vont pouvoir prouver que la victime s’est débattue”, reprend Nataliya Pylypiv.
“Mais en temps de guerre ça n’est pas adapté. Si une arme est braquée sur la victime, ou qu’elle est entourée par plusieurs agresseurs, elle ne va pas forcément se débattre, car elle est consciente que ça pourrait empirer sa situation”.
Pour mieux pouvoir condamner, l’OHCHR recommande de faire remplacer la notion de “situation d’impuissance de la victime” par “situation vulnérable”, ce qui dispenserait de la nécessité de ces preuves matérielles. Une technique qui fonctionne dans le droit international et permet de constituer un dossier d’enquête à partir de témoignages.
“Mais quand on parle de ça à un ukrainien, il ne comprend pas. Il répond que rien n’est possible sans ces deux preuves matérielles”, se désole la coordinatrice de l’OHCHR. Les résultats se traduisent en chiffres. Selon les données fournies par le bureau du Procureur général d'Ukraine, les nombre de criminel·les jugés sous les articles 152 et 153 n’ont que peu évolué ces dernières années.
En 2017, il y a eu respectivement 174 et 156 cas passés en justice, 65 et 335 entre janvier et juillet 2018, contre 155 et 120 en 2015. En ce qui concerne les crimes de guerre, articles 437 et 438 du CCU, le bureau du procureur général répond qu’ ”il n’y a pas de statistiques concernant les personnes ayant commis un crime sous [c]es articles […], y compris en combinaison avec un autre article. Il est donc impossible de fournir ces informations”.
En guerre depuis cinq ans, le parquet a gardé ses habitudes de travail en temps de paix. À tel point que “je n’ai entendu parler que d’un seul cas dans lequel un juge a condamné pour crime de guerre”, lance Anton Korynevych, juriste spécialiste du droit international qui a contribué à l’écriture d’un projet de réforme du CCU. Il s’agit d’un cas traité au tribunal de Slaviansk, en juin 2017, qui concerne la participation d’un·e citoyen·ne ukrainien à la DNR.
Comme la notion de crime de guerre est floue dans le CCU actuel, “le jugement est flou. Le parquet essaye mais ne sait pas comment s’y prendre, c’est nouveau pour eux”.“Dans le projet de loi que nous avons déposé, inspiré de l’article 8 du statut de Rome, nous détaillons les différents crimes de guerre, qui comprennent les viols. Ça en facilitera la poursuite et la condamnation”, reprend Anton Korynevytch, l’un des juristes ayant participé à la rédaction du nouveau texte de loi.
Dans cette nouvelle version du CCU, les viols et violences sexuelles apparaissent dans l'article 438, qui définit et détaille les crimes de guerre. Les problèmes liés au manque de preuves matérielles de non-consentement seraient, également, contournées.
En effet, l'article ajouterait à la violence physique présente dans la définition du viol : “la menace de son utilisation ou de sa contrainte, […] la pression psychologique ou l'abus de pouvoir en ce qui concerne la victime et/ou une autre personne, ou commis dans un environnement dans lequel la personne est incapable d'exprimer sa volonté réelle”.

Blocages de la réforme
Aux yeux d’Oleksandra Matviychuk, “il n’y a simplement pas de volonté politique”. Anton Korynevych confirme: “ce texte, ce n’est pas du business, c’est pas sexy, c’est peut être simplement pas une priorité”. D'autant plus avec la préparation des campagnes pour les élections présidentielles de mars 2019 et les élections parlementaires la même année.
Autour de l'image des soldats ukrainiens, il y a un réel enjeu politique. “Le procès de Tornado est un parfait exemple”, continue Anton Korynevych. Le bataillon Tornado est un des rares cas en justice qui traite de violences sexuelles dans le cadre du conflit. Formé en 2014 et parti au front, le groupe de combattants a été démantelé en juin 2015 pour pillage.
Douze de ses membres sont inculpés pour, entre autres, crimes en bande organisée, enlèvements, tortures et satisfaction forcée de désirs sexuels de manière non naturelle. Ils ont été jugés pour des sévices sur plus de 10 civil·es, dont au moins deux victimes de viols. Vladimir Yakimov, un des avocats de la défense, s’amuse : “même Yuri Karmazin a rejoint la défense !”
Yuri Karmazin, à la fois avocat et leader du parti politique ‘Motherland Defender’s Party’, ex-candidat aux présidentielles en 1999, et aux parlementaires en 2002 puis en 2006. Car ici, l’esprit nationaliste et la volonté de protection de l’image du combattant est un enjeu politique.
Jugé à huis clos, de nombreuses audiences ont dû être reportées à cause des manifestations qui voulaient que les membres du bataillon soient libérés. Le procureur Maxim Komarnitsky se souvient que “certains manifestants avaient vu les vidéos du viol, elles sont horribles, le crime est indéniable. Et ils venaient quand même nous dire que les membres du bataillon étaient innocents ! C’est absurde”. L’an dernier, le verdict est tombé : huit anciens combattants ont écopé de peines allant de 8 à 11 ans de prison, et quatre membres à 5 ans avec sursis.
“Ils ont été jugés comme des criminels classiques, pas comme des criminels de guerre. Les condamnations sont donc moindres”, reprend Anton Korynevych. Pour onze d’entre eux, le jugement est parti en cour d’appel.
Un article paru dans la presse ukrainienne en juillet 2017 dénonce la l’utilisation récurrente de la participation dans la zone d’opérations anti-terroristes (ATO) en tant que circonstance atténuante, pour alléger les peines des combattants. “Quelque chose qui n’existe pas dans la loi, mais qui est utilisé par les juges.”

C’est ce qui est arrivé à Diana. En 2015, à l’âge de 16 ans, elle a été violée par voie anale par un soldat, dans la région de Kiev, ce qui a pu être confirmé par un examen médical. Son agresseur, Nikolay Vasyanovich, était poursuivi sous l’article 153 pour “satisfaction forcée de désir sexuel de manière non naturelle”, il encourait une peine de trois à sept ans de prison.
Il en est sorti avec deux ans de probation et une indemnité pour dommage moral de 3000 hrivnas, l'équivalent de 90 euros. Une des raisons citées comme circonstance atténuante, sa participation à la zone d’opérations anti-terroriste (ATO).
Jugé en appel en février 2017, sa peine a été réévaluée à 4 ans avec sursis et à une indemnité de 100.000 hrivnas, soit 3000 euros environ. “Et on n’a encore jamais vu la couleur de cet argent.”
Dépitée, la mère de Diana, qui voulait voir le soldat derrière les barreaux, a finalement baissé les bras. “Ma fille ne veut plus y penser, elle veut laisser ça derrière elle. Moi non plus je ne souhaite plus en parler.”
Si bien qu’ “aujourd’hui en Ukraine, il n’y a que les ONG qui documentent les violences sexuelles comme crime de guerre”, selon Mykola Gnatovsky, juriste ukrainien et président du Comité européen pour la prévention contre la torture. Au niveau de ces deux types d’exactions, “il y a un manque de compréhension. Le parquet n’est pas formé et ne comprend pas de quoi il s’agit”.
Pourtant, il remarque que de plus en plus de juges et de procureur·es lui demandent comment correctement traduire les criminel·les de guerre en justice. Récemment, la vice-présidente de l’École nationale des juges a écrit à Kateryna Levchenko, commissaire du gouvernement pour l’égalité des genres, pour lui demander de l’aider à mettre en place une formation sur les violences sexuelles en zone de conflit. “ D’après moi”, conclut Mykola Gnatovsky, “ce n’est pas la volonté du parquet qui est à remettre en question. Mais pour les former, il nous faut de l'aide de l'international.”
Le Danemark finance depuis 2015 un plan de formation de procureur·es et de juges aux crimes de guerre, mises en place par le Conseil de l’Union Européenne. Mais les actions entreprises par les autres membres de l'UE, pour condamner les crimes de guerre, sont maigres.
En France, “nous sommes prêts et nous voulons vous aider, mais nous n'y sommes pas obligés et ne résoudrons pas les problèmes ukrainiens à la place de l'Ukraine", expliquait dans un entretien Valéria Faure-Muntian, née en Ukraine, députée En Marche et présidente du groupe d’amitié France-Ukraine.
Interrogée par rapport à cette intervention, elle explique : “L’Ukraine doit d'abord décider ce qu'elle veut pour elle, avant de demander de l'aide à l'international. Car je pense qu'il y a une schizophrénie”. D’un côté, la bonne élève, qui signe la majorité des accords internationaux sur les droits de l’homme, des femmes, et s’engage contre la corruption.
De l’autre, les vieilles habitudes difficiles à oublier qui freinent les changements. “Kiev est coincée entre sa culture soviétique et ses aspirations européennes.” En ce qui concerne la condamnation des crimes de guerre, et la ratification du statut de Rome, d’après Valéria Faure-Muntian, “l’Ukraine se réforme après 27 ans d’immobilisme, ses dirigeants sont dans l’obligation de prioriser. Tant que ça ne sera pas dans les premiers objectifs fixés par les internationaux, l’Ukraine ne pourra pas en faire une priorité”.
Pourtant, le secrétariat de la députée, contacté par l’équipe de Zero Impunity en juin, avait refusé un entretien avec Oleksandra Matviychuk. Le cabinet explique que “nous traversions une période compliquée concernant l’emploi du temps de Madame la Députée. Bien sûr nous allons prendre attache avec Madame Oleksandra Matviychuk afin de pouvoir la rencontrer car son combat est très important à nos yeux”.
Stephane Hueber-Blies, Nicolas Blies et Oleksandra Matviychuk ont finalement obtenu un rendez-vous la députée le 14 novembre dernier.

Lumières au bout du tunnel
Parmi les réformes en cours, il y a “une lumière au bout du tunnel”, dit Nataliya Pylypiv, qui pourrait bientôt résoudre certains problèmes autour de l'impunité. Le State Bureau of Investigation (SBI), une cellule d’enquête indépendante qui a commencé à opérer fin novembre, spécialisée pour investiguer les crimes importants tels que la corruption à haut niveau ou les crimes de guerre.
Pourtant, quelques mois avant sa mise en place, Maxim Komarnitsky s'inquiétait : “quand le SBI commencera à opérer, les militaires pourront s’en sortir encore plus facilement”. Les ancien·nes enquêteurs et enquêtrices, au bureau du procureur général militaire, avaient le droit d’accéder aux bases et aux documents des forces armées. Les enquêteurs et enquêtrices du SBI ayant le statut de civil, “ils n’auront pas les accès, ne pourront pas enquêter sur eux”.
Depuis mars, quand la compétence a été retirée du bureau du procureur général militaire, “on n’a plus de forces de l’ordre capables d’enquêter”. D’ici le moment où le SBI commencera à fonctionner, en novembre, ce sont les services de sécurité (SBU) et la police nationale qui travaillent sur les 7000 enquêtes en cours.
“Mais ils ne sont pas formés à ça. Aucune nouvelle enquête n’a été ouverte alors que les crimes continuent”, reprend Maxim Komarnitsky.
Alors, depuis quelques mois, quand il finit sa journée de travail en tant que procureur, il va aider les policier·es lorsqu’ils et elles n’ont pas accès aux documents, ou aux endroits. “Je vais sur le terrain, je mène des interrogatoires. C’est très dur, je pense pouvoir continuer comme ça encore un an. Mais dans mon service, j’ai peur que des gens craquent, avec la quantité de travail que ça nous ajoute”.
Au niveau législatif, Maxim pointe un autre problème, qui apparaît au moment où le SBI commence à opérer : “on ne pourra plus juger les criminels séparatistes qui ne sont pas sur le territoire contrôlé par le gouvernement”.
Depuis 2016, l’Ukraine peut faire un tribunal “in absentia” pour les criminel·les qui sont en zone séparatiste, dans deux cas de figure : si le ou la criminel·le a un mandat d’arrêt par la police internationale Interpol, ou s’il ou elle se cache depuis plus de 6 mois en territoire occupé.
Sauf que, quand le State Bureau of Investigation commence à fonctionner, cette dernière condition disparaît. Et comme Interpol refuse de poursuivre les séparatistes, qu’ils considèrent comme des criminel·les politiques, “à partir de là”, regrette le procureur Maxim Komarnitsky, “on ne pourra plus rien faire”.
Certaines avancées sont tout de même perçues. Les articles 152 et 153, qui concernent le viol et les violences sexuelles ont été amendés en 2016, les changements entreront en vigueur en janvier 2019. En 2016, la Constitution Ukrainienne a été amendée afin de la rendre compatible avec le traité de Rome, pour pouvoir à terme le ratifier, mais le changement dans la Constitution ne sera appliqué qu’en 2019.
Pour ce qui est de la ratification du traité de Rome en soi, la question ne s’est pas encore posée mais le combat s’annonce difficile, explique Oleksandra Matviychuk. “Les membres du Parlement ont peur, ils pensent que la Cour pénale internationale (CPI) sera utilisée par la Russie pour emprisonner des Ukrainiens. Mais la CPI, ce n’est pas un média, ils vérifient tous les dossiers !”
En ce qui concerne le projet de loi soutenu par Oleksandra Matviychuk, il y a enfin une évolution. Après des années de négociations, de manifestations et de pressions des activistes, le bureau des ministres a enfin donné son accord et validé le texte de loi, le 20 décembre. Il a été transmis à la Rada, le Parlement ukrainien, où il doit être débattu puis voté.
Les activistes prévoient déjà les difficultés liées au manque de connaissances en droit international des membres du Parlement. Le juriste Anton Korynevych renchérit, “certains confondent ce texte de loi avec la ratification du traité de Rome, ça n’a pourtant rien à voir”.
Oleksandra Matviychuk est bien au fait de ces difficultés mais ne se décourage pas. Elle compte tourner les campagnes électorales à son avantage, en profiter pour demander publiquement aux futur·es candidat·es, de mettre, dans leur programme, la ratification du statut de Rome et la réforme du Code Criminel.
Car elle le sait, “sans action publique, rien n'avance. C’est un long combat, on avance doucement. Au bureau des ministres, ils avaient d'abord des objections, mais après des années de négociation, ils n'en voient plus. Aujourd'hui, au parlement, c'est un autre combat qui commence. Il ne va pas être facile”. D'autant qu'elle est déterminée à faire passer la loi avant le mois d'octobre 2019. Car l’Ukraine aura non seulement un nouveau gouvernement et président·e en mars, mais aussi de nouveaux membres du parlement à l'automne.
Si la Rada ne vote pas cette loi avant cette échéance, le texte devra retourner au cabinet des ministres, être validé par le nouveau gouvernement, pour passer une seconde fois au nouveau Parlement.
Oleksandra Matviychuk, quand on lui demande si elle a de l'espoir de voir le texte voté avant l'automne, répond, déterminée: "Ça va être très difficile, mais on travaille pour rendre ça possible". Malgré les cernes qui se dessinent sous ses yeux, elle redouble d'efforts pour éviter de voir ce texte de loi retourner à la case départ.