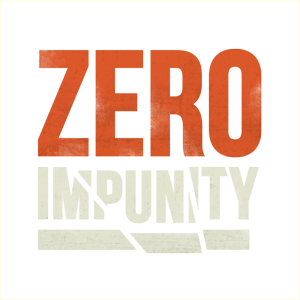Le lendemain, toujours privée d’eau et de nourriture, la jeune journaliste hurle encore. Son garde la frappe encore. De temps en temps, il la saisit pour lui faire une injection. Elle transpire alors à grosses gouttes et “perd la notion du temps”. Quand elle n’est pas harcelée, Léna réfléchit, refait l’histoire. Elle se dit qu’elle aurait dû écouter ses amis.
Ces derniers l’avaient pourtant avertie. Donetsk, situé en zone séparatiste pro-russe, est devenu un endroit dangereux pour une journaliste, surtout venant de Kiev.
“Si personne ne va là-bas, le monde ne saura pas ce qu’il s’y passe”, leur avait-elle répondu. C’était en mai 2014. Depuis, il ne se passe pas un jour sans qu’elle ne regrette sa décision.
Nous rencontrons Léna pour la première fois lors d’une conversation vidéo sur Skype. La jeune femme, yeux assortis à ses cheveux châtain clair, a quitté l’Ukraine et trouvé refuge en Allemagne. Lorsque la discussion débute et que l’ancienne prisonnière apparaît devant un simple mur blanc, nous ignorons tout de l’histoire qu’elle va nous livrer.
C’est son avocate, qui défend d’autres ex-détenues, qui nous a donné son numéro. Sa détention, Léna ne l’a jamais racontée en détail – ni aux activistes des droits humains, ni aux médecins qui jugeaient son cas déjà “suffisamment compliqué”. Mais ce 24 octobre 2016, protégée derrière son écran d’ordinateur, nerveuse, la jeune femme a décidé de parler.
Après quelques jours passés ligotée dans la cave, elle subit son premier “interrogatoire”. Quand ceux qui la questionnent découvrent dans son appareil photo des images de la révolution de Maïdan – ce mouvement de contestation né à Kiev, qui a abouti à la fuite du président Ianoukovitch début 2014 – le huit-clos se tend encore. Les gardes se muent progressivement en tortionnaires et la frappent… sur la tête et sur le ventre, pas seulement avec leurs poings, mais aussi avec son appareil.
Le message est clair : voilà le prix à payer pour avoir photographié. Et comme cela ne suffit pas à faire parler Léna – qui n’a pas grand chose à avouer -, ils font venir un autre détenu: “Si tu ne réponds pas, c’est lui qui prend!”. Les coups pleuvent, chaque fois deux ou trois heures durant.
Plus que les coups reçus pendant ses interrogatoires, c’est la peur du viol qui l’angoisse. Les premières caresses la pétrifient:
“Dans la cellule, les gardes me touchaient les cheveux, me tripotaient. Ils me disaient parfois ‘Viens, on va jouer!’. Pendant un interrogatoire, un homme a ouvert ma chemise, a mis sa main sur ma joue, une autre sur mon corps. J’étais terrifiée”.
Deux semaines ont presque passé quand un matin, elle se réveille sans bandeau sur les yeux. Des gardes viennent la chercher. Ils l’emmènent dans une chambre qu’elle ne connaît pas. Au centre, un matelas. Un des chefs est là, allongé. Les soldats la jettent dans la pièce : “Tiens, voilà une femme pour ton divertissement”. Léna les supplie de ne pas la toucher. Inutile. Ils s’y mettent à trois ou quatre pour la déshabiller :
“Et puis ils ont commencé à me violer. D’abord les hommes en noir, les chefs. Puis les hommes en vert”.
De l’autre côté de l’écran, Léna s’arrête, prend une gorgée d’eau puis une grande respiration. Quand elle reprend, son récit devient plus saccadé. “Sur la journée, au moins huit ont fait ça. Plusieurs fois j’ai perdu connaissance. Ils me balançaient des seaux d’eau froide au visage pour me réveiller”.
Les hommes en noir sont, d’après elle, des Russes et des Tchétchènes, dont elle reconnaît l’accent. En uniforme vert, des Ukrainiens. “Ils rentraient, ils sortaient, ils me soufflaient de la fumée de cannabis au visage pour me réveiller. Ils rigolaient, écoutaient de la musique…”. Lassés, ses violeurs finissent par l’abandonner, à moitié nue, son corps meurtri étalé sur le sol froid de la salle vide. Ils lui apportent de la nourriture, qu’elle ne mange pas, et des vêtements, qu’elle ne met pas. Quand ils la ramènent dans sa chambre, le soleil s’est couché. Léna est libérée le lendemain.
Pourquoi avoir attendu le dernier jour pour la violer? Dans sa tête, une phrase prononcée par l’un de ses bourreaux tourne en boucle:
“Ils m’ont dit que personne ne voulait payer pour ma libération: ni ma famille, ni l’État. Je n’avais rien qui les intéressait, ni informations, ni argent…”.
Ses geôliers ont-ils voulu se rémunérer autrement? Les miliciens séparatistes ont-ils voulu la “briser” avant de la relâcher? S’assurer qu’elle ne retourne plus, appareil photo au poing, témoigner de ce qu’il se passe côté séparatiste? Presque trois ans plus tard, la journaliste utopiste n’est plus que l’ombre d’elle-même, elle ignore si un jour elle aura réponses à ses questions.

Violences sexuelles utilisées à des fins de renseignements
Le cas de Léna n’est pas isolé. En Ukraine – où depuis près de trois ans Kiev affronte dans l’Est les rebelles pro-russes appuyés ou, pour certains, envoyés par Moscou, qui ne reconnaît toutefois pas l’implication de troupes régulières – le nombre des violences sexuelles a, semble-t-il, fortement augmenté.
D’après le rapport Douleur silencieuse, publié en février dernier par la coalition d’ONG “Justice pour la paix dans le Donbass”, une des rares organisations à s’être penchée sur la question, un tiers des interviewés (essentiellement civils et soldats détenus) mentionnent des faits de violences sexuelles.
“La violence atteint des niveaux de gravité insupportable” mais “elle demeure peu signalée et négligée par les autorités”, dénonce le rapport.
Ces agressions, surtout commises entre le printemps 2014 et l’été 2015, toucheraient autant les hommes que les femmes et atteignent parfois un degré de violence extrême. Les auteurs ont ainsi recueilli le témoignage de deux femmes dont la poitrine a été transpercée à l’aide de tournevis et celui d’un homme violé avec une perceuse.
Menaces, nudité forcée, électrocution des organes génitaux, mutilations ou viols, dans l’Ukraine en guerre, la réalité des violences sexuelles est multiple. D’après notre enquête et les premiers rapports publiés, elles se déroulent souvent dans des lieux de détention irréguliers (anciennes prisons, bâtiments militaires ou administratifs, maisons ou usines réquisitionnées, mais aussi dans des écoles et caves).
Le profil des victimes? Combattants, opposants avérés ou soupçonnés de sympathies pour l’autre camp, journalistes, jusqu’aux minorités ethniques, religieuses et sexuelles. Mais certaines se sont simplement trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Rares sont celles – et encore plus rares sont ceux – à oser témoigner:
“Il est trop tôt pour la plupart des victimes, qui refusent d’aborder le sujet”, analyse Anna Mokrousova, psychologue au sein d’une ONG de soutien aux anciens détenus, L’Oiseau Bleu, après avoir mené des entretiens auprès de plus de 300 civils ex-détenus.
Pour Anna, elle-même menacée de viol en détention, la société ukrainienne marquée par la guerre n’est « pas prête » à entendre leurs récits : “C’est compliqué d’accepter ceux qui sont encore plus traumatisés que soi”. Dans ce contexte, poursuit-elle, les seuls cas qui attirent l’attention “sont ceux mis en avant par la propagande, pas les vrais”.
Car ce conflit ukrainien se joue presque autant dans les journaux que sur le front. Pour gagner la guerre des esprits, les médias des deux camps, n’hésitent pas à brandir le viol comme une arme de la guerre utilisée par l’ennemi. Narrés avec force détails, les sites d’informations pro-russes et ukrainiens relatent des cas de tortures sexuelles, de viols de masse ou de viols sur mineures, photos d’illustration du plus mauvais goût et faux-témoignages dûment monnayés à l’appui.
Une propagande diffusée largement sur les réseaux sociaux aussi, en particulier par une armée de trolls au service de Moscou, qui sème la haine autant que le discrédit sur les paroles des véritables victimes. Car derrière les affabulations, se cache une réalité qui n’a parfois rien à envier aux récits propagandistes. Et si les viols dénoncés semblent plus nombreux dans les territoires séparatistes, de l’autre côté du front, dans l’Ukraine contrôlée par les forces de Kiev, les pires exactions ont également lieu.
Rongé par la culpabilité
Nous rencontrons Vadim * le 7 octobre 2016 dans le recoin sombre d’un pub désert, à quelques encablures du centre de la capitale ukrainienne. Crâne rasé et teint pâle, ce vétéran d’un bataillon pro-Kiev boit nerveusement son café crème. L’entretien n’a pas été évident à organiser: le trentenaire fluet a très peur des représailles de ses anciens camarades de bataillon. Près de trois ans après, il ne se remet toujours pas des scènes de violences auxquelles il a assisté.
Vadim, révolté par l’annexion de la Crimée par les Russes, rejoint le front comme volontaire au début de l’été 2014. Après un court séjour dans une unité “trop violente”, il s’enrôle à Aïdar, un bataillon de volontaires pro-Kiev à la réputation sulfureuse. A ce moment-là, les bataillons de volontaires constituent bien plus que l’armée régulière sous-équipée, en sous-effectif et corrompue, l’essentiel de la défense ukrainienne.
Il débarque près de Shchastya, à quelques kilomètres de la ligne de front. Cette fois, la guerre est bien là. Vadim est affecté à la surveillance des bâtiments de la base – une ancienne école de police – où sont retenus les prisonniers. De là, il observe un manège inquiétant:
“Lorsque les soldats reviennent du front, en état de choc et très souvent bourrés, ils descendent souvent dans les caves pour ‘se défouler’ sur les détenus”.
Vadim enchaîne les tours de garde et assiste, impuissant, à ce déchaînement de violences. De l’autre côté de la porte, il perçoit les cris et des bruits de coups. Mais il y a un cri qu’il n’oubliera jamais. Un jour, le volontaire est affecté seul à la surveillance d’un bâtiment dans lequel, lui a-t-on dit, est enfermée une femme soupçonnée d’être une sniper séparatiste car “elle portait une cagoule” (NB: La femme tireuse d’élite est un mythe courant dans les conflits de l’espace post-soviétique, et qui légitime souvent l’usage du viol en guise de vengeance).
Un des commandants entre dans le bloc. Avant de raconter la suite, l’ancien soldat se racle la gorge.
“Quelques minutes après, j’ai entendu la femme crier: ‘Non, non! Ne fais pas ça’!”. Les autres sons qui s’échappent de l’intérieur laissent peu de place au doute. “Pour moi, elle était en train de se faire violer”. Vadim la croise le lendemain et remarque qu’elle “marche difficilement”.
Rongé par la culpabilité depuis deux ans, il repense à ce qu’il aurait dû faire pour empêcher ce qu’il a entendu. Pour se racheter, il envisage de donner un jour des éléments clés de cette histoire – noms, lieux, détails – à un éventuel tribunal international. Une cour de justice qui ne devra pas se pencher seulement sur les crimes commis en détention. Dans la zone de conflit, les checkpoints notamment, cristallisent aussi les pressions exercées sur les femmes. Aux barrières, des soldats proposent aux femmes de les laisser passer en échange de services sexuels, d’après plusieurs témoignages que nous avons recueillis.
En février 2017, un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les violences sexuelles en Ukraine rapporte notamment le viol collectif subi par une habitante de Donetsk, ville emblématique de la rébellion pro-russe, stoppée par les membres du bataillon séparatiste Vostok à un checkpoint pour avoir brisé le couvre-feu:
“Elle a été conduite en voiture dans ce qu’elle croit être un poste de police occupé par le bataillon. Pendant trois heures, elle a été battue à coups de barre de fer et violée par plusieurs hommes du bataillon”. Ils la relâcheront le jour d’après.
Prostitution de mineures
Près de Donetsk justement, se trouve la petite ville de Krasnohorivka, sur le territoire contrôlé par les forces de Kiev, à 3 kilomètres des lignes séparatistes. Vitres brisées, toits défoncés, impacts de balles: ici, les traces de la guerre sont visibles partout. Au loin des sifflements, des tirs se font entendre. Ici, les soldats sont chez eux.
Ce matin de la mi-octobre 2016, une équipe de bénévoles est venue apporter un peu de gaieté aux adolescents. Un peu à l’écart, l’une des volontaires, Elena Kosinova, reconnaît à mi-voix que dans la ville, des femmes sont contraintes de se prostituer auprès des soldats.
En particulier “des mères esseulées qui ont une vie dure désormais”, ou “des filles ou des femmes de ‘mauvaises familles’ qui ne cherchent pas forcément de l’argent, mais de la nourriture”. Elena s’empresse toutefois de préciser que cette prostitution de misère se déroule “sans violence”.
Près d’une autre école du village, nous croisons Génia, 16 ans. En tirant fort sur sa cigarette, capuche rose sur ses cheveux décolorés et maquillage déjà soutenu, elle se défend de faire partie de “ces filles qui vont voir les soldats”.
Pour désigner des échanges sexuels, tarifés ou pas, elle parle de “fausses histoires d’amour” entre les militaires et des filles du coin, mais “ne veut pas être mêlée à ça”.
Entre deux bouffées, elle finit par lâcher qu’au moins trois de ses amies “fréquentent” des soldats. Génia ajoute qu’elle a eu vent d’une “vingtaine” d’autres relations des filles de son âge qui se sont rendues aux checkpoints pour y “rencontrer” ces soldats en recherche constante “de filles mineures”.
Pour Ilya Bogdanov, un ex du FSB (les services secrets russes) passé à l’ennemi, dans les rangs du groupe paramilitaire ultranationaliste Pravy Sektor et que nous rencontrons dans un parc de Kiev, ces dérives proviennent de l’alcoolisme répandu sur le front. Dans ces zones que l’ancien soldat qualifie – dans un franc-parler contrastant avec son apparence de blondinet juvénile – de “poubelle biologique”, où des filles de 13 ou 14 ans boivent avec les soldats. Et finissent souvent par “baiser avec eux”. “Alors que ce sont encore des enfants”, ajoute Ilya. À sa connaissance, “les commandants ne disaient rien”.
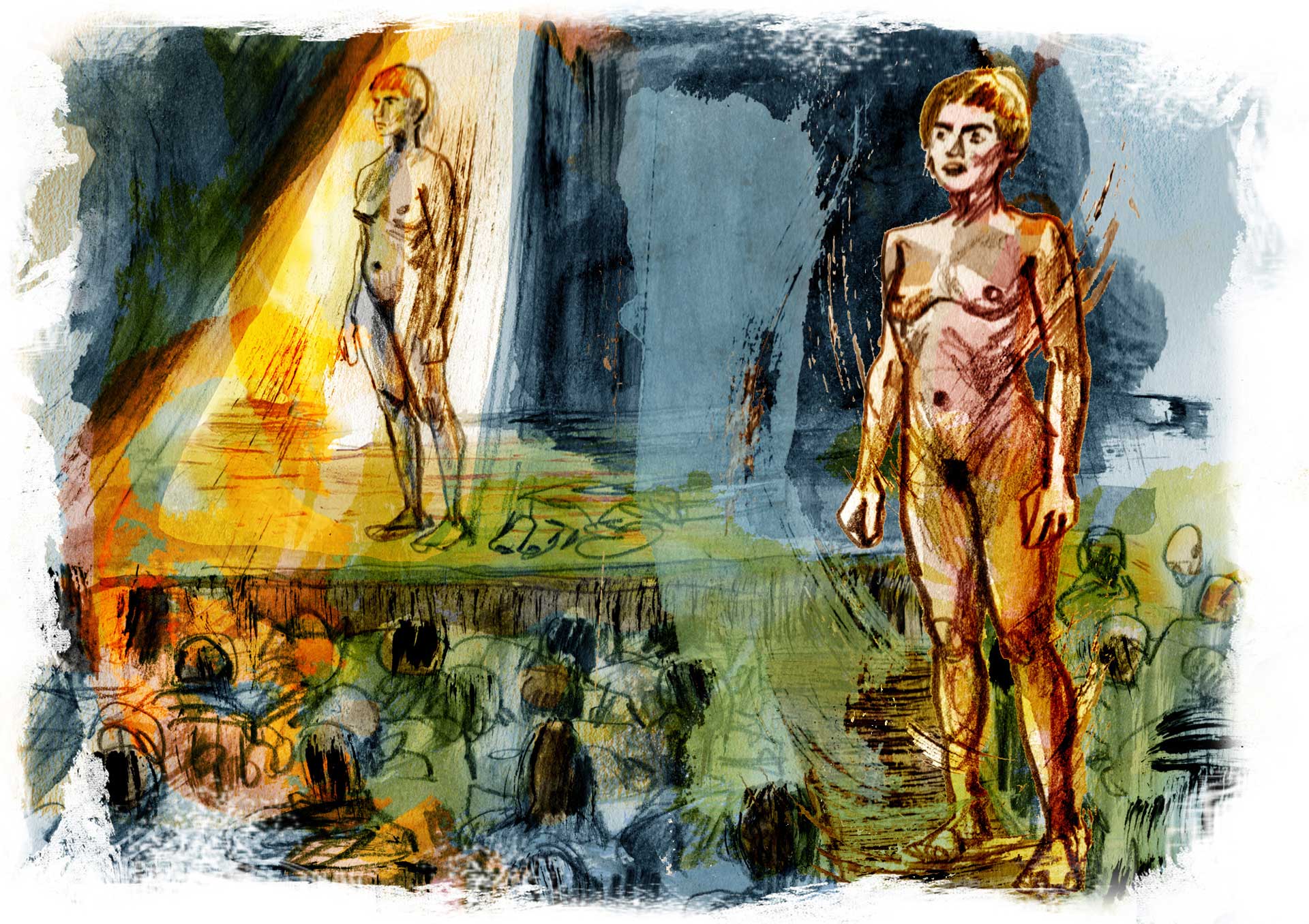
Le tabou social
Côté ukrainien, dans les zones situées près du front, en 2016, seulement 30% des forces de police étaient encore opérationnelle**. Mais pour ces jeunes filles de Krasnohorivka, comme pour la plupart des victimes de violences sexuelles en Ukraine, la peur des représailles et la honte sont les plus fortes, elles n’envisagent pas de déposer plainte. Même avant le début du conflit, les survivantes du viol étaient déjà bâillonnées :
“Ici, il y a une forte culture de la culpabilisation des victimes: on te dit que c’est de ta faute, que tu n’avais pas à t’habiller de telle manière, à trop boire”, regrette Nastya Melnychenko.
Cette trentenaire, elle-même victime d’agression sexuelle il y a plusieurs années, a lancé en 2016 sur les réseaux sociaux en Ukraine et en Russie une campagne “#Jenaipaspeurdeledire” afin de libérer la parole. Pourtant, le constat de l’activiste est désespéré:
“Ici, le seul moyen d’éviter les risques de viol et d’agression sexuelle, c’est de ne pas naître femme”.
Quant à celles qui trouvent le courage de s’adresser à la police, leur dépôt de plainte tourne souvent au cauchemar. Non seulement la police elle-même se rend parfois coupables de violences sexuelles, mais des pressions sont aussi exercées, par les officiers ou les soldats accusés, pour que les victimes retirent leurs plaintes.
Au commissariat, côté séparatiste, rien n’a été fait pour inciter Léna, la journaliste ukrainienne dont nous avons raconté l’histoire en début d’article, à se confier. Elle qui avait pourtant “réuni toutes [ses] forces pour décrire ce qui [lui] était arrivé, excepté le viol” se voit rabrouée par le lieutenant d’un sourire méprisant : “On ne peut rien faire pour toi”. Quand elle demande un téléphone pour contacter ses proches, on lui refuse en lui indiquant la sortie. C’était à Donetsk, au printemps 2014. Depuis, peu de changements ont été constatés dans ces zones contrôlées officiellement par les rebelles – et officieusement par Moscou. L’espoir semble toujours aussi faible pour les victimes de violences sexuelles d’obtenir réparation.
Dans les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL), les structures ukrainiennes n’opèrent plus et ont progressivement fait place à une justice parallèle, déficitaire en personnel, sous-financée et opaque. Un chaos qui explique pour certains activistes le fait que ces violences, même si elles ont été perpétrées des deux côtés de la ligne de front, auraient été plus nombreuses côté séparatiste:
“Le territoire n’est contrôlé que par les armes et les criminels, alors que côté Kiev, il y a quand même toujours eu un Etat et des procureurs. La torture, y compris les violences sexuelles, ont fait partie là-bas d’une politique pour menacer la population”, analyse ainsi Volodymyr Shcherbachenko, coordinateur du rapport Douleur silencieuse.
Demandé pour les besoins de cette enquête, l’accès en RPD et RPL nous a été refusé, sans plus d’explication.
Soldat, circonstance atténuante
Et dans les régions contrôlées par Kiev? L’impunité est moindre, mais le pouvoir n’est pas vraiment en mesure d’offrir aux survivantes de réelles perspectives de justice. Surtout quand les bourreaux sont leurs propres hommes. C’était le cas du violeur d’Anna *, 17 ans.
La jeune fille, teint cristallin et longs cheveux blonds, se sent trahie. Nous la rencontrons à l’abri de la pluie dans une voiture garée en bas de sa résidence étudiante, en banlieue industrielle de Kiev. Anna ne comprend toujours pas la sentence prononcée par un juge d’Ivankiv, une ville de la région de Kiev.
Deux ans de probation et 100 euros d’amende pour un viol par sodomie. La sodomie n’est pas considérée comme un viol en droit ukrainien, la peine prévue par le code pénal est donc de 3 à 7 ans de prison contre 7 à 12 ans pour un viol sur mineur. L’homme en question, un militaire d’une unité de protection des frontières, était au moment des faits en caserne à Mlachivka – le village d’origine d’Anna, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev – mais avait pris part aux combats dans l’Est.
Dans le verdict daté du 10 juin 2016, on peut lire parmi les circonstances atténuantes : “Participation aux opérations anti-terroristes dans l’Est” (le nom donné par Kiev pour désigner le conflit à l’Est). Une décision en forme de droit de cuissage accordé à ceux que Kiev considère comme des héros.
“L’esprit nationaliste est très fort [en Ukraine]", analyse Simon Papuashvili, coordinateur de projet de l’ONG ‘Partenariat International pour les Droits de L’homme’. "Dans des situations comme celles-ci, où le pays est attaqué par un pays voisin, ceux qui défendent la patrie sont vus comme des héros”.
Le parquet a fait appel mais la dernière décision n’a fait que confirmer la probation de deux ans, l’amende, elle, est passée à 3500 euros de dommages. La famille d’Anna voudrait trouver la force de contester de nouveau la décision “Nous sommes épuisés, ma fille n’en peut plus de tout ce processus judiciaire”, nous confie la mère d’Anna début mars. Joint le 13 octobre 2016, le juge qui a prononcé la décision controversée n’a pas souhaité commenter sa décision.
Et les autorités de Kiev – qui ont pourtant adopté en février 2016 un plan d’action national pour améliorer la protection et la prise en compte des femmes dans le cadre du conflit – ne semblent pas plus sévères lorsque les crimes ont lieu dans la zone de conflit.
Les statistiques fournies en novembre 2016 par le bureau du procureur général parlent d’elles-mêmes : seulement sept enquêtes ont été ouvertes pour violences sexuelles en lien avec le conflit, dont 3 ont été closes pour manque de preuves. De son côté la coalition d’ONG “Justice pour la paix dans le Donbass” a recensé plus de 200 victimes.
Sollicité, le bureau du procureur général confirme qu’une nouvelle enquête préliminaire est en cours depuis le 7 février 2017, à l’encontre d’“un soldat de l’unité C”, notamment pour viol.
Peut-être les autorités ukrainiennes n’ont-elles pas intérêt à enquêter davantage? Il semblerait en effet que même leurs propres services secrets soient impliqués. C’est en tout cas ce qu’il ressort du témoignage d’un ancien détenu passé par les geôles du SBU (services de renseignements ukrainiens) que nous avons pu recueillir.
Le récent rapport de l’ONU signale également que des violences sexuelles ont été “le plus souvent perpétrées contre des individus, des hommes surtout, détenus par les services secrets ukrainiens (SBU) et les bataillons de volontaires”.
De l’autre côté de la ligne de front, les services secrets – russes notamment – ne sont pas en reste, comme nous l’a confirmé un ancien détenu des séparatistes évoquant la présence parmi le commandement de “membres du FSB” dans ce lieu où “des violences sexuelles se produisaient” et où “ils exploitaient des prostituées”.

Le faux espoir d’une justice internationale
Dans ce quasi désert judiciaire, une seule lueur d’optimisme à l’horizon: celle de la justice internationale. Un espoir porté par Alisa, jeune réalisatrice de documentaire, violée à Kramatorsk il y a trois ans par un homme qui s’est présenté comme un ex-officier russe, et que nous avons rencontrée le 9 octobre dernier dans son appartement, à Kiev.
Démarche d’un courage rare dans l’Ukraine d’aujourd’hui: Alisa veut que tout le monde sache. La jeune femme devrait pouvoir se tourner vers la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
“Si je le fais, ce n’est pas par revanche personnelle. C’est plutôt par rapport à toutes les autres filles comme moi”, assure-t-elle.
Sur les 3000 procédures pour atteintes aux droits humains actuellement en cours auprès de la CEDH pour l’Ukraine, aucune ne concerne les violences sexuelles. Alisa pourrait donc être la première. La CEDH n’a pas le pouvoir d’arrêter les coupables, en revanche les victimes peuvent obtenir réparation.
La Cour pénale internationale (CPI) est la seule à pouvoir condamner des criminels de guerre lorsque ceux-ci ne peuvent être jugés dans leurs pays. Pour Alisa, un procès international d’ampleur “est le seul recours”, jure-t-elle. Le seul, sans doute – étant donné l’état de la justice en Ukraine et l’accès impossible des autorités aux zones séparatistes. Le bon, cela reste à vérifier.
Même si l’Ukraine n’a pas encore ratifié le Statut de Rome (qui a créé la CPI), la CPI a tout de même compétence pour enquêter sur les crimes commis dans tout le pays y compris les territoires séparatistes, quelles que soient la nationalité des criminels présumés : Ukrainiens, Russes ou autre.
Dans cette perspective, plusieurs activistes recueillent depuis des mois des témoignages de victimes de violences sexuelles et ont commencé à les transmettre à la CPI, qui affirme dans un e-mail en date du 9 mars n’avoir pas été à ce stade en mesure de “porter de conclusions basées sur des faits en ce qui concerne les cas qui leur ont été communiqués”.
Les chances d’arriver à un procès sont très faibles, d’autant plus que les délais s’avèrent extrêmement longs – une dizaine d’années environ minimum jusqu’à d’éventuels procès.
“Cela va prendre beaucoup de temps, peut-être une ou deux décennies. Si tout va bien, nous pourrions obtenir un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité”, s’enthousiasme Simon Papuashvili.
Il a déjà fait remonter à la Cour environ 300 cas de tortures dans le cadre du conflit (pas de violences sexuelles) et en prépare 400 autres.
“Mais le problème, c’est que la Russie, en tant qu’Etat non-partie (à la CPI), n’est pas obligée de coopérer avec la Cour, donc si des citoyens russes font l’objet de mandat d’arrêt, la Russie refusera très probablement de livrer ses citoyens à la Cour et là, la Cour n’aura aucun droit d’intervenir”.
Pour Olexandr Pavlichenko, un des co-auteurs du rapport Douleur Silencieuse, la Russie serait de toute façon déjà en train de faire le ménage : de plus en plus de chefs de guerre disparaissent dans “de mystérieux assassinats”, qui sont pour lui des “manoeuvres à peine déguisées de la Russie pour nettoyer la mémoire”. Il craint que d’ici un à deux ans, ces criminels auront disparu “et avec eux toute chance d’obtenir la vérité”.
Alisa n’est pas découragée, elle a décidé d’agir. Pour briser le silence autour de ces violences, elle a monté une performance théâtrale – présentée deux fois en Ukraine et une fois à Berlin. Elle y interprète sa propre détention, y compris son viol, allant jusqu’à se mettre nue sur scène. L’expérience est intense… Pas seulement pour elle: “Certains spectateurs pleurent pendant que l’on joue. À force, la violence de notre guerre devient statistique. Là, ils la ressentent en direct”.
Le procès exemplaire ?
Le dossier d’Anna n’est pas le seul à se trouver entre les mains des juges ukrainiens.
L’affaire Tornado est l’une des plus médiatiques en Ukraine aujourd’hui. Le bataillon Tornado – dont près d’un tiers des membres disposait d’un casier judiciaire au moment de sa formation au printemps 2014 – est démantelé et douze de ses membres sont inculpés pour, entre autres, crimes en bandes organisées, tortures et violences sexuelles. Des violences sexuelles qui sont au coeur de la communication du procureur militaire qui veut faire de ce procès un exemple.
Mais la tâche ne sera pas aisée: pour faire pression sur les juges, les audiences impliquant les bataillons sont souvent perturbées par des manifestations. Tornado ne fait pas exception.
D’après le procureur général, ils seraient responsables de sévices sur plus de 10 civils, dont au moins deux victimes de viols. Deux des détenus auraient notamment été “forcés de violer un autre détenu attaché nu à un cheval d’arçons”, relatait le procureur militaire Anatolii Matios, en direct à la télévision en juin 2015.
Fait suffisamment exceptionnel pour être remarqué, cet été, dans une affaire parallèle, près de Lougansk, une cour a condamné un membre du même bataillon à 6 ans de prison pour viol. Le début d’une volonté sincère de rendre justice aux victimes de violences sexuelles ?
Pour l’avocat principal de Tornado, Vladimir Yakimov, “Il n’y a pas de réelles preuves de torture et encore moins de violences sexuelles”, c’est un “prétexte” pour que “le procès se tienne à huis clos”.
En vain, des vidéos ont été mises en ligne sur internet par le parquet lui-même, avec reconstitutions et extraits d’audiences du procès, y compris traitant les violences sexuelles, malgré ce huis-clos… L’avocat de la défense crie au faux procès organisé “parce que les membres de ce bataillon gênaient la contrebande depuis les territoires séparatistes”.
Pour nombre d’avocats et activistes qui ont suivi de près ce dossier, s’il y a peu de doutes sur le haut niveau de violence de ce bataillon – qui semble avoir semé la terreur dans le village qui lui a servi de base – les intentions réelles du gouvernement ne sont pas claires: difficile de savoir si ce procès vise réellement à condamner des criminels pour ce qu’ils ont fait, ou à se débarrasser d’un bataillon qui devenait trop dérangeant pour les autorités.