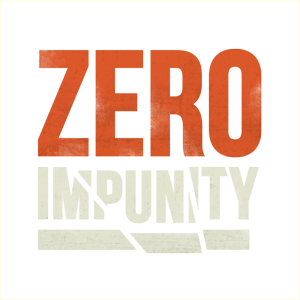Qu’importe que le document porte principalement sur les abus commis par des troupes gabonaises et burundaises. Qu’importe qu’il ne remette pas en cause les accusations concernant les viols sur mineurs dont se seraient rendus coupables des soldats français en bordure du camp de réfugiés Mpoko, à Bangui, la capitale de République centrafricaine. Qu’importe que ces « incitations financières » désignent certainement des aides fournies par des organisations humanitaires. Le doute est semé. Et le ministère de la Défense français a beau jeu de souligner la « légèreté » de l’UNICEF, qui a réuni les témoignages accusateurs.

Des doutes, pourtant, il en subsiste peu pour qui se donne la peine de mener l’enquête jusqu’à Boda. À 190 kilomètres de Bangui, la ville déploie son ambiance de petite cité minière. La route qui y mène est plutôt bien entretenue : nous sommes dans la région natale du président-fondateur de la République centrafricaine Barthélémy Boganda et de l’empereur autoproclamé Jean-Bedel Bokassa. L’artère la plus animée est un étroit ruban de terre battue qui part du rond-point où se postent les moto-taxis. Là, la station de carburant Total a été reconvertie en bar. À la tombée de la nuit, les creuseurs de diamants quittent leur carré minier pour y consommer en bières leurs éventuelles trouvailles. C’est là-bas, dans un bout de forêt équatoriale, que se trouve la preuve potentielle qu’une atteinte sexuelle sur mineur a été commise par un soldat français.
La famille Pazoukou habite une maison de briques en terre cuite, à 200 mètres de l’ex-station Total. L’entrée est barrée d’une porte sans serrure. Le jeune Elie* égaie souvent la cour de ses chahuts. Il a un an et cinq mois, et aime envoyer balader la bouillie qu’on lui sert au petit-déjeuner.
Il a le teint clair. Dans le voisinage, on l’appelle « le Français ».

15 000 francs CFA
Lorsque les soldats tricolores de la force Sangaris arrivent à Boda en février 2014, ils installent leur base en plein centre-ville. Ils tentent de s’interposer entre groupes anti-balaka – qui se sont érigés en défenseurs des chrétiens de la ville – et groupes « d’autodéfense » musulmans. Les tueries ont alors déjà fait des centaines de victimes.
Noella Pazoukou, l’une des filles de la famille, commence à vendre des tomates aux « Sangaris », sur un petit étal en face de leur base. Ses cheveux tirés en tresses découvrent un visage adolescent. Un jour de l’été 2014, un militaire français la remarque. Grâce à un intermédiaire, un jeune du coin prénommé Alban, il lui glisse quelques mots doux et lui donne rendez-vous un soir à 18h. L’adolescente accepte ses avances.
« Il m’a fait entrer dans une petite maison qui se trouve sur leur camp. Nous avons fait l’amour. C’était ma première fois. À la fin, il m’a remis 15 000 francs CFA [23€]. Mais sur la route du retour, des anti-balaka en patrouille me les ont pris » raconte Noella dans sa langue maternelle, le sango, d’une voix hésitante.
La jeune femme ne parle pas français – elle a arrêté ses études en primaire. Une méningite contractée à l’âge de sept ans lui a laissé des séquelles : elle a longtemps perdu l’usage de la parole et a toujours des difficultés d’audition. Rencontrée chez elle les 13 et 14 octobre 2016, elle livre son récit par bribes, allant et venant sous l’auvent qui sert de cuisine pour entretenir le feu :
« Nous nous sommes revus une autre fois, au même endroit. Nous avons eu une autre relation sexuelle. Et puis un jour, il est reparti, avec toute son équipe. Je n’ai plus jamais eu de nouvelles. »

Probablement mineure au moment des faits
Début octobre 2014, les soldats français stationnés à Boda passent le relais aux casques bleus de la MINUSCA, la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique, et repartent en France. Noella, elle, est rattrapée par la guerre. Avec sa mère et ses sept frères et sœurs, elle doit quitter la maison familiale :
« À cause des massacres en ville, on a fui pour aller en brousse. J’étais déjà enceinte. C’est en rentrant chez nous que j’ai dit à ma mère que je ne me sentais pas bien. »
Cette dernière – dont le mari est mort alors que Noella était encore enfant – tente de faire vivre la famille en vendant feuilles de koko et chenilles grillées. Lorsque sa fille lui explique qu’elle est tombée enceinte d’un soldat français, Solange Pazoukou peine à y croire. Jusqu’au jour de la naissance et de la découverte de la peau, presque blanche, du nouveau-né.
Quatre mois après sa naissance, en août 2015, Solange Pazoukou porte plainte auprès des autorités centrafricaines – après « avoir entendu à la radio une émission sur les abus sexuels ». Son dossier fait depuis le 4 septembre 2015 l’objet d’une enquête pour « viol commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions », confirme-t-on au Parquet de Paris. Si la contrainte physique ou la violence n’est pas démontrée, l’auteur restera passible d’atteintes sexuelles sur mineure de plus de 15 ans par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions (article 227-27 du Code pénal), et violation de consignes. Car Noella était très probablement mineure au moment des faits. Elle avait dix-sept ans, selon les premières conclusions des enquêteurs français. Seize ans, nous assurent sa mère ainsi que le Procureur de Boda, Olivier Mbombo Mossito.

Cinq mois pour se rendre à Boda
La famille Pazoukou n’a aucune chance de voir un procès se tenir dans son pays : en vertu d’un accord conclu entre le gouvernement français et le gouvernement centrafricain le 18 décembre 2013 – quelques jours après le déploiement de l’opération Sangaris –, les militaires français qui se rendraient coupables de crimes ou délits au cours de leur mission ne peuvent être jugés que par la justice française. C’est une formation spécifique de la gendarmerie nationale, la gendarmerie prévôtale, qui est chargée des enquêtes visant les militaires en opérations extérieures.
Saisi de l’affaire en septembre 2015, le Parquet de Paris met huit mois à adresser aux autorités centrafricaines une demande d’entraide pénale internationale – que nous avons pu consulter – afin, entre autres, de « faire procéder à l’audition de tout témoin susceptible d’apporter des éléments sur les faits ou leurs circonstances » . Il faudra attendre encore cinq mois pour que les gendarmes français se rendent à Boda pour soumettre à Noella des photos de militaires, afin d’identifier le père.
Le calendrier ne joue pas en la faveur de la famille Pazoukou : entre-temps, le principal témoin, Alban – qui aurait joué le rôle « d’intermédiaire » –, a quitté Boda pour Bangui. Quant à Noella, on lui demande d’identifier sur des photos un homme qu’elle a vu pour la dernière fois il y a deux ans – et qu’elle a rencontré en tout et pour tout deux fois.

Un problème logistique
La sortie du mémo de l’ONU suggérant que des victimes centrafricaines auraient pu recevoir de l’argent en échange de témoignages accusant les troupes internationales a concentré l’attention médiatique et politique sur la question de la crédibilité du témoignage des mineurs.
Mais paradoxalement, la seule affaire où une preuve matérielle pourrait attester qu’il y a eu abus, celle de Boda, semble recueillir une attention limitée, y compris de la part des enquêteurs chargés de traiter le dossier.
Alors qu’à l’époque des faits l’homme avait le crâne rasé, ce n’était pas le cas sur certaines des photos présentées à Noella. Alors qu’ils ont pu rencontrer l’enfant, les enquêteurs français n’ont pas fait procéder à un test ADN. Ils ont simplement demandé à sa famille son groupe sanguin – qu’elle ne connaissait pas.
Quant à l’audition tardive de la victime présumée, elle est due, si l’on en croit deux sources proches du dossier à un problème de… transport. Les gendarmes ont en effet attendu plusieurs mois que l’opération Sangaris puisse mettre un hélicoptère à leur disposition pour se rendre à Boda. Interrogé sur ces lenteurs, le ministère de la Défense affirme pourtant que « le ministère coopère pleinement avec les autorités judiciaires. »
Une anecdote qui pose la question du statut et de l’indépendance des gendarmes prévôtaux, ces militaires chargés d’enquêter sur les affaires mettant en cause des militaires avec les moyens des militaires. « La prévôtale s’appuie sur la force armée avec laquelle elle est déployée. Ils ont des moyens de gendarmerie (leurs armes, des moyens de police technique), mais ils dépendent vraiment de la force pour les appuyer, confirme la vice-procureure en charge des affaires pénales militaires au Tribunal de grande instance de Paris, Sandrine Guillon. Et si on a besoin des moyens militaires pour la mission militaire, il est évident que ça passera toujours avant une enquête de la prévôtale ».
Le désengagement progressif des moyens de Sangaris aurait été, selon la magistrate, la cause des lenteurs de ces enquêteurs. L’opération arrivant à son terme à la fin octobre, on peut légitimement se demander si des hélicoptères vont continuer de décoller pour Boda.

Plusieurs vagues d’accusations
À la fin du mois d’octobre 2016, la plainte déposée par la jeune fille de Boda avait rejoint sur le bureau du Procureur de Paris plus d’une dizaine de dénonciations pour viols et atteintes sexuelles visant déjà les soldats de Sangaris. Depuis avril 2015 et la révélation par le quotidien britannique The Guardian d’un rapport interne de l’ONU dénonçant des viols sur quatre enfants (ayant pris la forme, selon les victimes, d’un échange de fellations contre argent ou nourriture), la liste des accusations visant les soldats tricolores s’est encore allongée. Officiellement, le parquet de Paris, chargé des instructions, ne souhaite « pas se prononcer » sur un chiffre, préférant « raisonner en nombre d’enquêtes clôturées, et non faire de la prospective ».
Après la première vague d’accusations émanant d’enfants du camp de déplacés Mpoko, à Bangui, la justice a en effet été saisie (en 2016) d’un rapport de l’UNICEF faisant état d’une centaine de viols qui auraient été commis dans la région de Dékoa, au centre du pays. Le rapport vise principalement des soldats des contingents burundais et gabonais, mais cite également, à la marge, les forces françaises. Il faut y ajouter les quelques témoignages recueillis en sus par les enquêteurs centrafricains – qui ont identifié et auditionné une douzaine de victimes concernant l’affaire de Mpoko (toutes ne désignant pas des militaires français), indique celui qui dirigeait à l’époque la Section de recherches et d’investigation de la gendarmerie centrafricaine, le lieutenant Kossi, rencontré le 18 octobre à Bangui. Plus récemment enfin, une association centrafricaine a déposé une plainte pour un viol collectif qui aurait été perpétré par des Sangaris près du Pont Jackson, toujours à Bangui.

Traces de ligotage
Interrogée, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) affirme par ailleurs, certificats médicaux à l’appui, avoir signalé trois nouveaux cas de viols sur mineurs à la justice française – un frère et une sœur de 7 et 9 ans, ainsi qu’une fillette de 13 ans. Les dossiers et certificats médicaux établis par l’ONG confirmeraient des traces de violences sexuelles ainsi que des traces de ligotage sur l’une des victimes.
Le ministère de la Défense lui-même semble admettre que des viols ou abus sexuels ont bien été commis par des soldats français en Centrafrique.
Interrogé par e-mail le 20 décembre 2016, le ministère rappelle que concernant ce type de cas, « chaque fois que les faits étaient avérés et les auteurs identifiés », les « militaires mis en cause » ont été « éloignés du théâtre » et ont subi des « sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation des cadres ou la résiliation de contrat. » Invité à préciser le nombre de cas avérés, le ministère n’a pas donné pas suite.
Les cas qui sont arrivés sur le bureau du Procureur, à Paris, sont-ils la partie émergée de l’iceberg ? Selon des documents et des récits recueillis en RCA et en France auprès d’anciens de l’opération, des militaires français ont bien négocié les faveurs sexuelles de civil(e)s, aussi bien majeur(e)s que mineur(e)s. Des faits que les juges français pourraient un jour qualifier de viol sur mineur(e)s ou d’atteinte sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. Cette « prostitution de survie » a semble-t-il été tolérée par le commandement militaire à Bangui, y compris après l’arrivée de la première vague de dénonciations (les enfants de Mpoko) sur le bureau du ministère de la Défense, en juillet 2014. Les hauts gradés avaient en effet été alertés de la conduite à risque de leurs subordonnés.

Signalements écrits à l’Inspection générale des armées
Le 3 août 2014, huit mois après le début de l’opération, plusieurs gradés français présents à Bangui signalent par écrit au général L., de l’Inspection générale des armées, les dysfonctionnements relatifs au campement Sangaris qui se trouve aux abords du camp de déplacés de Mpoko. Dans ces documents internes à l’armée, intitulés « Compte-rendus concernant la protection de la force » que nous avons pu consulter, des sous-officiers et un officier supérieur – un colonel – alertent leur commandement.
Ils parlent du camp français comme d’un « véritable gruyère » au sein duquel il est difficile d’éviter « les vols et les intrusions ». Un caporal-chef demande par ailleurs à ce que l’entrée à l’aéroport soit renforcée par des barbelés car « les gens peuvent y pénétrer sans être préalablement contrôlés au checkpoint, ce qui rend donc le travail des forces armées quasi inutile ». Il ajoute : « Le camp de réfugiés (qui est collé au camp militaire, ndlr) devrait être mieux fermé, car il est la cause de nombreux soucis, notamment la demande de rations aux soldats par ces mêmes réfugiés. Il donne aussi une certaine facilité de s’infiltrer (sic) à un réseau de prostitution qui fait office tard dans la nuit. »
Un colonel ajoute : « Cette proximité avec les locaux donne lieu au développement des propositions concernant alcool, drogues, prostitution ». Un sergent demande instamment à « augmenter la prévention concernant la prostitution qui pourrait être utilisée contre l’image de la force ».
Il évoque par ailleurs l’« utilisation d’enfants pour perturber le travail des sentinelles et des patrouilles ». Un autre sous-officier signale enfin que les militaires rencontrent « des problèmes de prostitution à la nuit tombée à l’entrée des check-point et de l’APOD [Air Point of Debarquement] ». Quelles mesures ont été prises par le commandement de l’opération suite à ces signalements ? Interrogé, le ministère de la Défense ne répond pas, mais indique que « la France met en œuvre une stricte politique de « tolérance zéro » en matière d’exploitation et d’abus sexuels ».
Élément supplémentaire accréditant la thèse d’un camp aux allées et venues mal contrôlées : d’après une source proche du dossier, « parmi les documents déclassifiés [secret défense dans le cadre de l’enquête judiciaire] figure un rapport non-manuscrit faisant état des mêmes problèmes » de porosité du camp et de prostitution.
Jules*, officier déployé onze mois en RCA (en 2013 et 2014), a eu le temps d’être confronté à plusieurs reprises à cette prostitution de misère teintée d’abus d’autorité.
Une première fois, se souvient-il, un soldat de garde n’appartenant pas à son unité avait été pris sur le fait par son supérieur alors qu’il se « faisait sucer à travers la grille » du camp français, à Bangui – il ne précise pas s’il s’agissait d’une mineure ou d’une majeure.
Une autre fois, l’un de ses camarades, qui avait eu recours aux services d’une prostituée, a dû être rapatrié pour raisons médicales (probablement pour l’administration d’antirétroviraux). Motif : le préservatif aurait craqué.
À une autre occasion, le gradé aurait été averti qu’une mère de famille aurait vendu les services sexuels de sa fille à plusieurs soldats. « C’était un groupe de combat, des gamins, qui avaient entre 18 et 25 ans, grand maximum ». Jules demande confirmation à leur chef :
« Il était en colère. Il m’a répondu : ‘P*****n ! Ils m’emmerdent ! Je ne sais pas où ça s’est passé, mais a priori, oui, c’est ça [qui s’est produit]’ ».
Vérification faite, cette affaire n’est jamais arrivée jusqu’au Parquet de Paris.

Sangaris refuse de répondre à des experts mandatés par l’ONU
À la même période, entre avril et novembre 2014, une Commission d’enquête internationale sur la Centrafrique est mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU pour enquêter sur les violations des droits de l’Homme. Cette dernière reçoit « plusieurs allégations de viols et abus sexuels, émanant de victimes et d’ONG et visant les casques bleus de la MINUSCA, les casques bleus africains de la MISCA et Sangaris », se rappelle un des trois enquêteurs de la Commission, l’avocate mauritanienne Fatimata M’Baye, qui a accepté de nous répondre. « On nous avait effectivement dit que certains Sangaris entretenaient des relations avec des mineurs, avec des filles mineures. »
Les enquêteurs se rendent alors « à plusieurs reprises » au quartier général de Sangaris pour « discuter avec le commandement » : « Il fallait notamment qu’on sache quelle équipe était à tel endroit. Mais il y avait blocage. C’était une question assez sensible, ils n’ont pas voulu en discuter avec nous. On a compris que ça n’était pas la première fois que ces accusations étaient portées contre eux ».
En l’absence de réponse et pour éviter « un rapport à charge », la Commission se concentre sur les autres forces armées visées. Dans le document, publié le 6 décembre 2014 – cinq mois avant la révélation du Guardian –, elle glisse toutefois cette petite phrase : « La Commission a reçu des allégations sur des violations [des droits de l’homme et du droit international humanitaire] commises par les forces de la MISCA, de la MINUSCA et de Sangaris. » Mais elle argue alors de « ressources limitées » pour justifier l’absence d’enquête sur les accusations visant spécifiquement les Français.
Invité à confirmer la tenue de ces rencontres avec les experts des Nations unies et à expliquer la raison de ce « blocage » décrit par l’avocate mauritanienne, le ministère de la Défense ne nous a pas adressé de réponse.
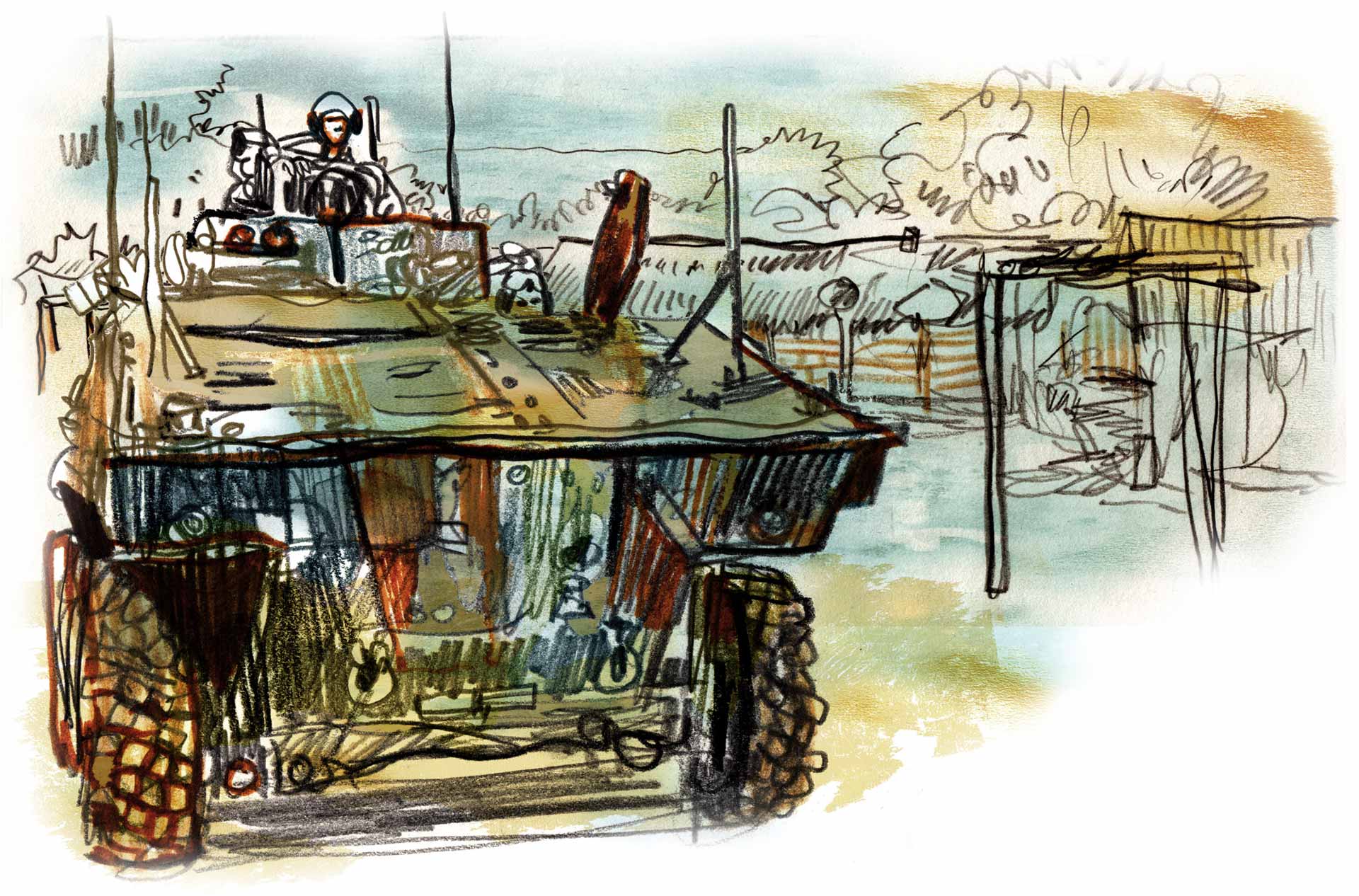
« Très peu d’intimité propice à des actes sexuels »
Le commandement de Sangaris voulait-il réserver la primeur de ses déclarations à la prévôtale ? À la lecture du PV de synthèse de l’enquête des gendarmes français (daté du 5 mai 2015), que nous avons consulté, il est permis d’en douter. Entendus entre les 2 et 9 août 2014, deux officiers français – l’un détaché au sein des forces européennes EUFOR, l’autre du 152e régiment de Colmar – se déclarent « stupéfaits par les accusations » de viols. « De par la proximité physique de leurs hommes », les « faits de cette nature auraient été difficilement réalisables en toute discrétion et auraient par conséquent nécessité la complicité de nombreux personnels » répondent-ils.
Des déclarations pour le moins surprenantes quand on sait qu’au même moment, le 3 août, plusieurs de leurs subordonnés faisaient parvenir à l’Inspection générale des armées à Paris leurs compte-rendus alertant sur la porosité du camp, la présence prostitutionnelle forte et la présence d’enfants autour des postes de gardes et de patrouille. Une salve de documents rédigés par les sous-officiers qu’ils commandent, dont on imagine mal comment ils ont pu ignorer le contenu et l’existence.
Les réponses des officiers supérieurs de Sangaris auront en tout cas l’effet escompté. Dans la synthèse de leur enquête, les prévôtaux concluront qu’il n’y a « sur ‘le terrain’ que très peu d’intimité propice à des actes sexuels ».
*Les prénoms ont été modifiés dans un soucis d'anonymat.